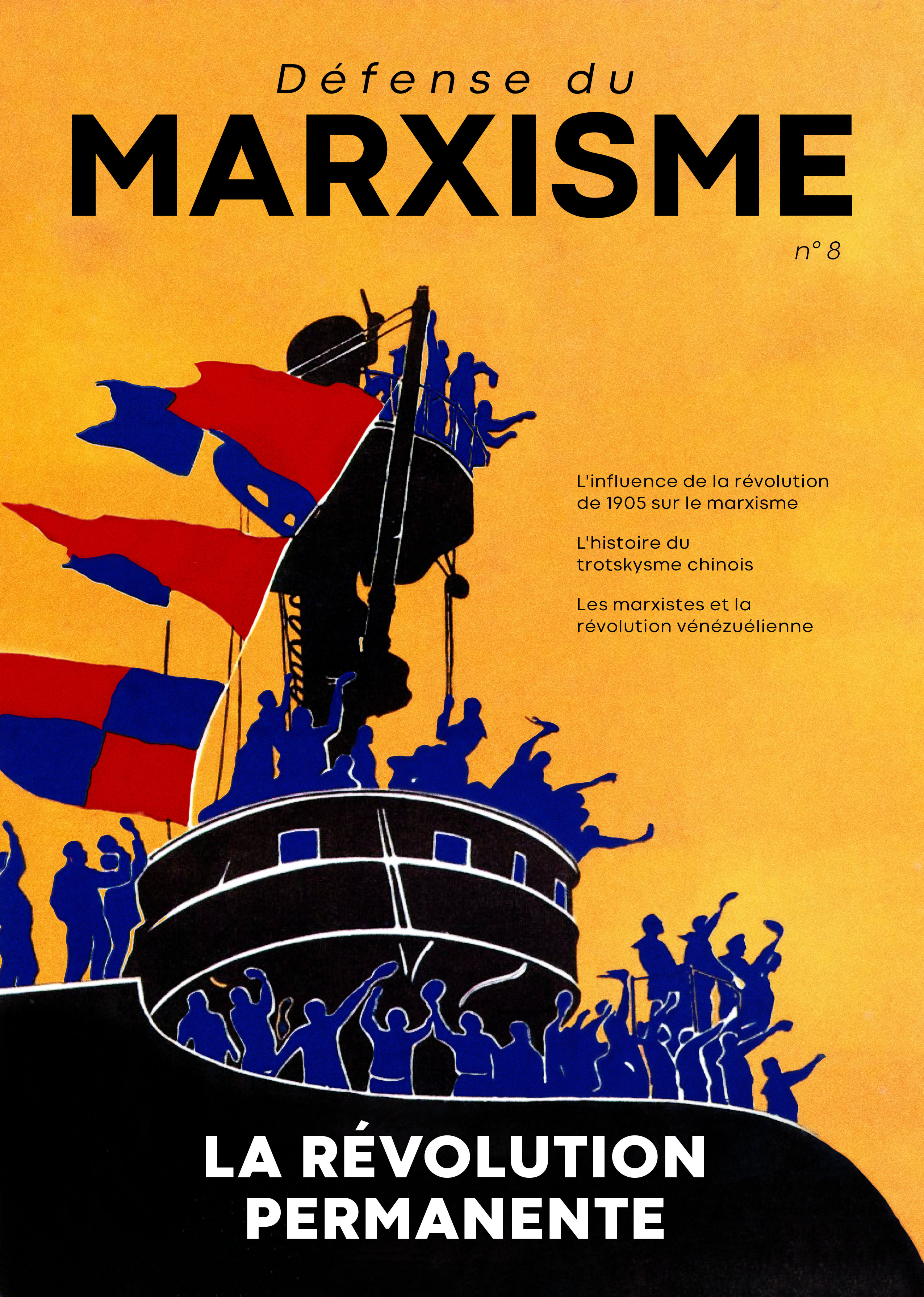La Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant fondamental de l’histoire. Elle a eu un impact sur toutes les sphères de la société, y compris la production artistique. Dans cet article, Daniel Morley aborde la façon dont la guerre a précipité le développement du cinéma néoréaliste italien, ainsi que son influence sur d’autres réalisateurs de cette époque.
Le cinéma néoréaliste italien est apparu avec la première chute de Mussolini en Italie, en 1943. Eu égard non seulement au style et au sujet de ses films, mais aussi aux conditions de son émergence, il exprimait à la fois le potentiel révolutionnaire de l’époque et une profonde rupture avec le passé.
Ce mouvement est né soudainement à partir de son opposé : le cinéma du régime fasciste de Mussolini. Ce dernier n’était qu’évasions et artifices reluisants, conformément à ce qu’exigeait le régime.
Du jour au lendemain, les cinéastes italiens ont été libérés d’une censure totalitaire. Par ailleurs, les studios liés à cette censure ont été détruits par les bombardements. Tout favorisait l’esprit du « printemps italien », la libération de toute la créativité refoulée par le fascisme, la création de nouveaux studios, de nouvelles méthodes et de nouvelles idées.
C’est pourquoi le néoréalisme italien ne reflète pas seulement des pressions et des idéaux politiques différents ; il est différent à tous points de vue. Ses films se déroulent au sein de la classe ouvrière ; ils sont tournés in situ, par nécessité ; ils font appel à des acteurs non professionnels issus des communautés en lutte dont ils parlent. Cela en fait non seulement de grands films, mais aussi des documentaires sur une période exceptionnelle de l’histoire.
Rome, ville ouverte
Rome, ville ouverte a été projeté pour la première fois en septembre 1945, à peine 15 mois après que Rome a été libérée des nazis et quatre mois après la fin de la guerre en Europe. Ce film extraordinaire, qui se déroule dans une Rome occupée par les nazis, a été qualifié par Martin Scorsese de « moment le plus précieux de l’histoire du cinéma. » [1]
Cette œuvre a été écrite par le génial Federico Fellini, entre autres, et réalisée par Roberto Rossellini dans le cadre de sa célèbre trilogie néoréaliste. Il dépeint avec un remarquable réalisme la résistance, face aux nazis, d’une communauté locale d’Italiens ordinaires. Pour interpréter les rôles, Rossellini a largement fait appel à des travailleurs romains, plutôt qu’à des acteurs professionnels.
Le film a été tourné en janvier 1945, alors que la guerre faisait toujours rage en Allemagne et dans le nord de l’Italie – et sept mois seulement après la défaite des nazis à Rome. Pendant le tournage, un habitant de la ville a sorti son arme : il croyait que les événements mis en scène étaient réels !
Rossellini lui-même n’était pas en phase, politiquement, avec la classe ouvrière. Il avait même réalisé des films pour la dictature fasciste de Mussolini. Mais il se consacrait à sa démarche réaliste, qu’il décrivait comme « rien d’autre que la forme artistique de la vérité » [2]. Le fait est que Rome, ville ouverte restitue fidèlement l’intensité de la lutte contre l’occupation nazie – la solidarité, le courage et la gaité stoïque de ses protagonistes.
Comme le dit le personnage de Francesco :
« [La guerre] prendra fin, Pina, et le printemps reviendra, plus beau que jamais, parce que nous serons libres. Nous devons y croire et le vouloir. Nous ne devons pas avoir peur, ni maintenant ni à l’avenir, car nous sommes sur la bonne voie. Tu comprends, Pina ? [...] Nous nous battons pour quelque chose qui doit être, qui ne peut pas ne pas venir. La route peut être longue et difficile, mais nous y arriverons et nous verrons un monde meilleur. Et nos enfants surtout le verront. »
Rome, ville ouverte a entamé son parcours comme un documentaire et, par moments, on a encore l’impression que c’en est un. Grâce à son réalisme et au fait qu’il a été tourné sur place juste après la fin de la guerre, il constitue un trésor historique inestimable, une fenêtre ouverte sur un bref moment de l’histoire où l’Europe était à l’aube d’une révolution.
Lorsque, dans le film, le militant communiste que les nazis recherchent est finalement capturé, un indice évoque intelligemment le potentiel gâché de cette situation révolutionnaire. L’officier allemand, dont les méthodes de torture échouent à faire parler le partisan, passe à une technique plus psychologique et politique :
« Tu es un communiste. Ton parti a conclu un pacte avec les forces réactionnaires. Vous travaillez tous ensemble contre nous pour l’instant. Mais demain, quand Rome sera occupée, ou “libérée”, comme vous dites, ces officiers monarchistes seront-ils encore tes alliés ? Je te propose la solution à ce problème : donne-moi les noms des généraux de Badoglio ».
Le révolutionnaire tient bon et refuse de trahir les « alliés » libéraux et monarchistes de son parti. Il le paie de sa vie. Que Rossellini l’ait voulu ou non, cela symbolise brillamment la tragédie du sacrifice de la révolution par ses dirigeants « communistes », pour complaire aux alliés impérialistes de Staline.
Au début du film, l’un des habitants demande à un autre : « Tu penses que ces Américains existent vraiment ? » Cette question reflète l’impatience de voir la guerre se terminer, mais aussi une certaine méfiance vis-à-vis d’Américains qui, sans doute, ont leurs propres intérêts. Cette perspective semble confirmée par la réponse d’un autre habitant, qui regarde un bâtiment bombardé et dit : « ça a l’air d’être le cas ».
Les bombardements alliés sur les villes italiennes se sont intensifiés au cours de la seconde partie de la guerre. Ils ont fait de nombreuses victimes civiles. Ils ont détruit des usines, des infrastructures et des quartiers ouvriers entiers.
C’est le type de libération dont Rome écopa à l’initiative de Staline et de Togliatti, le chef du Parti Communiste Italien : ils ont tenu en bride les partisans communistes qui auraient pu libérer Rome par eux-mêmes.
La lutte pour la survie
Rome, ville ouverte exprime clairement et puissamment la vie de la communauté sur laquelle se penche Rossellini. En regardant le film, on a l’impression d’être l’un des locataires de cet immeuble exigu, d’y écouter leurs conversations et de participer à leurs efforts pour combattre les nazis. On ressent le chaos organisé de la vie réelle, des gens qui vivent les uns sur les autres, qui veillent les uns sur les autres, mais qui s’agacent aussi les uns les autres.
Se plaignant des difficultés de la vie en temps de guerre et de l’occupation nazie, un personnage soupire : « La grippe est la seule chose qu’il y a en abondance, de nos jours ». Un autre dit sans fierté, avec une honte désespérée : « On a pris d’assaut une boulangerie ce matin, la deuxième de la semaine ».
Du fait de leur réalisme, les films de Rossellini sont souvent caractérisés comme froids et dénués de sentiments. Lorsque des personnages importants se font abattre, c’est montré de manière objective : telle est la réalité de la vie. La guerre est une lutte pour la survie ; elle n’est ni chaleureuse ni sentimentale. Cependant, cela ne signifie pas que les gens ordinaires, qui souffrent de la guerre, sont eux-mêmes froids et insensibles – ce que Rossellini montre très bien.
Rome, ville ouverte a beau avoir été tourné sans ornements sentimentaux, il reste un film chaleureux : il parle de personnes réelles et de leurs luttes réelles, pleines d’héroïsme, de solidarité et de sacrifices.
Cependant, ces Romains ne sont pas dépeints comme des révolutionnaires abstraits et surhumains. Lorsque deux d’entre eux sont arrêtés par les nazis, ils attendent leur inévitable torture avec une peur terrible, en essayant de se préparer mutuellement à rester silencieux, sans être sûrs d’y parvenir.
Lorsque le chalumeau apparaît, nous voyons la stupidité de l’officier nazi : il pense qu’il suffit d’appliquer des méthodes brutales pour obtenir les réponses souhaitées. Mais un autre officier nazi a un moment de clairvoyance et met en doute ces méthodes violentes :
« Nous avons parsemé l’Europe de cadavres. De leurs tombes s’élève une haine inextinguible. La haine, la haine partout ! »
Allemagne, année zéro
Les conséquences de l’occupation et du pillage de l’Europe par les nazis forment le thème d’un autre chef-d’œuvre néoréaliste de Rossellini : Allemagne, année zéro. Tourné à Berlin et à Rome, en 1947, ce film est peut-être encore plus remarquable comme témoignage du désespoir et de l’extrême dénuement des Allemands ordinaires au lendemain de la guerre.
La politique des Alliés victorieux, à la fin de la guerre, a été résumée comme suit : « le désarmement complet, la démilitarisation et le démembrement de l’Allemagne dans la mesure où ils le jugent nécessaire pour la paix et la sécurité futures » [3]. En outre, l’Allemagne devait payer pour toutes les pertes subies pendant la guerre.
Au nom de la « démilitarisation » et des « réparations », une partie de l’industrie et des infrastructures allemandes a été littéralement démantelée et transférée aux puissances victorieuses, tandis qu’un lourd tribut était imposé sur ce qui restait du produit national allemand. Dans le même temps, des millions de travailleurs allemands ont été enrôlés dans le travail forcé par les Alliés.
Le mythe de la « culpabilité collective » du peuple allemand est venu se greffer sur ce programme de pillage pur et simple. Les forces d’occupation alliées ont lancé une campagne de propagande massive dans toute l’Allemagne, qui comprenait des affiches montrant des images de camps de concentration – avec comme slogan : « Ces atrocités, c’est votre faute ! »
Des initiatives spontanées de la classe ouvrière allemande ont éclaté lorsque le talon de fer du fascisme a été levé, mais elles ont été immédiatement réprimées par les forces d’occupation alliées, avec le soutien des dirigeants sociaux-démocrates et staliniens.
Pendant ce temps, dans les zones occupées par l’Occident, non seulement les grands capitalistes ayant collaboré avec le régime nazi n’ont pas été inquiétés, mais ils ont même conservé leurs biens. Quant aux fonctionnaires nazis encartés, ils ont rempli ce qui allait devenir l’appareil d’Etat ouest-allemand. En 1957, 77 % des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice de l’Allemagne de l’Ouest étaient d’anciens membres du Parti National-Socialiste. Même sous le Troisième Reich, ce ministère ne comptait pas autant de nazis encartés !
La « honte nationale » de l’Allemagne n’était rien d’autre que le transfert de la culpabilité de la classe dirigeante sur les épaules de millions d’hommes, de femmes et d’enfants de la classe ouvrière qui, en 1947, étaient en proie à la faim, à l’insécurité et à la pénurie de logements.
La souffrance d’un peuple vaincu et humilié est illustrée de manière saisissante dans Allemagne, année zéro, à travers l’histoire tragique d’une famille berlinoise qui lutte pour sa survie au milieu des ruines de sa ville. Comme le film a été tourné sur place moins de trois ans après la prise de Berlin par l’Armée rouge, la décimation que montre ce film est tout à fait réelle. Berlin est parsemé de collines de décombres, et chaque bâtiment semble être une ruine.
Le film commence par une discussion entre des ouvriers qui se demandent quelle section de la ville – américaine, britannique, française ou soviétique – a le plus de nourriture. La rumeur dit qu’il y a de la confiture dans le secteur soviétique. Que font ces travailleurs pendant qu’ils discutent ? Ils creusent des tombes. On suppose qu’elles seront remplies par les innombrables victimes de la guerre.
Le personnage principal, Edmund, un garçon d’environ 12 ans, est renvoyé de ce travail de fossoyeur parce qu’il est trop jeune et trop faible. Il n’est pas interprété par un acteur professionnel, mais par un Berlinois que Rossellini a trouvé dans un cirque.
Des temps désespérés
La famille d’Edmund est désespérée. Elle discute avec beaucoup d’angoisse de la façon dont elle peut obtenir davantage de nourriture.
Le fils aîné est aux prises avec son passé. Il n’a pas réclamé sa carte de rationnement car, pour cela, il devrait s’enregistrer. Sa sœur insiste pour qu’il le fasse dans l’intérêt de la famille ; elle lui dit : « c’était la guerre, tu faisais ton devoir de soldat ». Mais il redoute que la campagne de dénazification le vise, car son unité s’est battue jusqu’au bout. En conséquence, il n’est qu’une bouche de plus à nourrir, un fardeau pour la famille.
La situation de ce personnage résume l’état d’esprit du film, si différent de Rome, ville ouverte. L’Italie était pauvre à la fin de la guerre, mais le peuple a mené une lutte victorieuse contre le fascisme. En revanche, pour le frère d’Edmund, en Allemagne, la fin de la guerre n’est pas vécue comme une libération ; il ne peut pas profiter de la nouvelle période de paix. Ayant participé aux crimes du parti vaincu, il est coincé dans l’ombre de la guerre. Une atmosphère de découragement imprègne l’ensemble du film.
Toute la pression qui pèse sur cette famille repose sur les épaules du jeune Edmund. Sa famille l’envoie errer dans les rues et y vendre, pour quelques marks, le peu de biens qui leur restent. On lui demande d’obtenir au moins 300 marks pour la balance de la famille. Mais il se fait facilement escroquer par un homme bien plus âgé que lui et qui profite de son ignorance et de sa naïveté – avant de monter dans une belle voiture. En ces temps désespérés, les forts deviennent plus forts et les faibles plus faibles.
Edmund tombe alors sur un homme très effrayant, Herr Henning, qui pousse l’exploitation de l’enfant encore plus loin. Il gagne la confiance d’Edmund en prétendant être son ami ; il le cajole ; il lui raconte qu’il n’est plus employé comme enseignant car « les autorités et moi n’étions pas d’accord ».
Il s’avère qu’il était – et qu’il est toujours – un nazi. Il discute avec un homme qui travaille à la pelle sur des monceaux de gravats, et se plaint : c’est un « travail d’esclave ». L’homme explique : « avant, nous étions encore des hommes. Des nationaux-socialistes. Maintenant, nous ne sommes plus que des nazis ». Henning acquiesce.
Loin de l’optimisme de Rome, ville ouverte, qui évoque la lutte collective pour une grande cause, Allemagne, année zéro est implacablement sombre.
L’atmosphère qui règne, tout au long du film, est celle de la survie du plus fort, du chacun pour soi. Un personnage déclare : « Je ne crois pas à l’entraide. Aujourd’hui, tout le monde doit s’aider soi-même ».
Tout le monde arnaque tout le monde. Le langage est cru, offensant : une fille est décrite par un garçon comme « un matelas qui distribue des cigarettes ». L’ensemble est résumé par l’exploiteur Herr Henning, qui dit à Edmund : « il faut avoir le courage de laisser mourir les faibles », avec des conséquences effroyables et tragiques.
Un tel niveau de désespoir a fini par inquiéter les impérialistes eux-mêmes. Ils craignaient que cela finisse par pousser l’Allemagne occupée par l’Occident – puis le reste de l’Europe – dans le giron de l’Union soviétique. Aussi, en avril 1948, peu avant la sortie d’Allemagne, année zéro, le président Truman promulgua le « plan Marshall », qui renversa totalement la politique des Alliés à l’égard de l’Allemagne occupée : des milliards de dollars furent alloués à la reconstruction de son économie.
Le film de Rossellini capte donc un tournant de l’histoire, entre la fin d’un ordre mondial et le début d’un nouvel ordre – ainsi que l’hypocrisie et la brutalité sans bornes dont les impérialistes sont capables.
Le Troisième Homme
Le Troisième Homme, tourné en 1948 et sorti en 1949, est souvent considéré comme le plus grand film britannique jamais réalisé. Situé dans la Vienne de l’après-guerre, il a été écrit par le célèbre romancier Graham Greene et réalisé par Carol Reed.
Bien qu’il ne soit pas à strictement parler un film néoréaliste, on peut affirmer qu’il n’aurait pas existé, du moins pas sous cette forme, sans le Rome, ville ouverte de Rossellini. Ce dernier a inspiré Alexander Korda, le producteur du Troisième Homme, qui expliquait : « Les prises de vue en extérieur, l’utilisation d’acteurs non professionnels et l’exploitation des rythmes organiques de Rome avaient donné aux films italiens une immédiateté et une personnalité honnête » [4]. C’est pourquoi il a envoyé Graham Greene faire des recherches à Vienne et Rome, en février 1948.
L’atmosphère cynique, dépressive et opportuniste d’Allemagne, année zéro est peut-être encore plus nette dans le chef-d’œuvre de Carol Reed. Moins documentaire et plus stylisé, il n’en reflète pas moins la vérité d’une époque oubliée, du simple fait d’avoir été tourné dans la Vienne de 1948.
Après la guerre, Vienne a été occupée par les « Alliés », tout comme Berlin, mais seulement jusqu’en 1955. Les Etats-Unis ont conclu un accord avec la classe dirigeante autrichienne pour présenter le pays comme la première victime des nazis. Or, le Troisième Homme dément cette affirmation, car les Autrichiens n’y semblent guère libérés et reconnaissants, mais plutôt rancuniers, traumatisés et méfiants.
A un moment donné, la propriétaire d’un appartement fouillé par les autorités britanniques leur crie dessus en allemand. Lorsqu’on lui demande ce qu’elle dit, un personnage autrichien répond : « Elle se plaint seulement de la façon dont ils se comportent dans sa maison ».
Cela peut résumer toute l’histoire : vaincus et appauvris, les Autrichiens doivent endurer l’humiliation d’étrangers grossiers et exploiteurs « dans leur maison ».
Le film s’ouvre sur une narration du réalisateur, qui présente l’histoire :
« Je n’ai jamais connu Vienne avant la guerre, avec son charme facile et son glamour. Je l’ai connue à l’époque classique du marché noir. Nous vendions n’importe quoi si des gens en voulaient et avaient de quoi payer. »
Comme Berlin à la même époque, Vienne est dépeinte comme une ville jonchée de décombres et de splendides bâtiments en ruine.
Les pénuries alimentaires étaient très sévères. En 1947, un an avant le tournage du film, les récoltes de pommes de terre étaient tombées à moins de 30 % des niveaux d’avant-guerre, et le gouvernement n’était pas en mesure de distribuer des rations alimentaires. Il y eut de nombreuses grèves et émeutes de la faim. L’Amérique a alors commencé à fournir une aide alimentaire d’urgence, de peur que les pénuries ne fassent tomber le pays aux mains des Soviétiques. Lorsque cette aide a été retirée, en 1950, une série de grèves générales a secoué le pays.
Les capitalistes qui avaient collaboré avec les nazis ont fui, abandonnant leurs usines. Jusqu’en 1950 environ, de nombreuses usines autrichiennes ont été reconstruites et ont fonctionné sous le contrôle des travailleurs.
La CIA coordonnait l’aile droite des syndicats autrichiens, qui a veillé à ce que la vague de grèves générales de 1950 se solde par une défaite. Dans la foulée, la CIA a organisé des hooligans pour briser le contrôle des usines par les travailleurs et accélérer leur restitution aux capitalistes. Le potentiel révolutionnaire de cette situation d’après-guerre a été étouffé.
Tout ceci se déroulait avant que la guerre froide ne commence vraiment. L’avenir de la société autrichienne était très incertain. Qui serait le maître : les capitalistes ou les travailleurs ? Quelle puissance déciderait du sort de l’Autriche : les Etats-Unis ou l’URSS ?
Un programme de dénazification a été lancé, mais il a été interrompu sur la base du mythe selon lequel les Autrichiens auraient été les premières victimes des nazis. Une grande partie de la bourgeoisie autrichienne préférait oublier son passé ; elle ne savait pas exactement comment ses crimes passés, ou son association à des crimes, seraient traités s’ils étaient découverts. De très nombreux petits commerçants avaient acquis leurs biens au moyen de vols commandités par les nazis, les commerces en question ayant appartenu à des Juifs. Ces petits-bourgeois autrichiens ne savaient pas s’ils allaient pouvoir conserver leurs biens acquis de cette manière.
Pour toutes ces raisons, il régnait une atmosphère de cynisme, de tromperie et d’opportunisme. Beaucoup de gens se disposaient à s’adapter à n’importe quelle situation.
Louche
Tout ceci constituait le cadre idéal pour un « film noir », ce qu’est précisément Le Troisième Homme. L’intrigue est la suivante : un Américain, Holly Martins, se rend à Vienne où vit son ami Harry Limes, qui lui a promis un travail. Mais à son arrivée, Holly Martins découvre que son ami est mort dans un accident de la route.
Quantité de détails relatifs à cet accident sont si étranges que Holly décide de rester à Vienne pour y mener sa propre enquête. Il relève qu’un grand nombre d’associés de Harry semblent avoir été témoins de l’accident, ce qui est pour le moins suspect. Ce qui ne l’est pas moins, c’est le fait que deux associés de Harry étaient sur place pour transporter immédiatement son corps, après l’accident. Pire encore : différentes personnes lui donnent différentes versions des événements. Certains affirment que Harry est mort sur le coup ; d’autres qu’il leur a parlé avant de mourir. Et certains lui disent qu’un mystérieux « troisième homme » a participé au transport du corps.
Un chef de la police britannique bouleverse alors la perception que Holly avait de son ami en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un trafiquant notoire. Son affaire consistait à voler de la pénicilline, qui faisait cruellement défaut, à la mélanger à d’autres substances et à revendre le tout à ceux qui en avaient besoin. Cela a entraîné de nombreux décès, et en particulier des décès d’enfants.
Cette affaire, dans le film, n’est pas seulement une métaphore de la pauvreté générale et des graves pénuries auxquelles ont été confrontés les Autrichiens après la guerre. C’est plus ou moins ce qui s’est passé dans la réalité.
La pénicilline a été mise au point par les Américains pendant la guerre, et ils ont donc contrôlé l’approvisionnement de l’Autriche. En 1946, l’Amérique a permis à l’Autriche d’y avoir accès, mais elle lui en a procuré pour à peine 20 patients ! Selon Susanne Krejsa MacManus, « le marché noir a prospéré. Les journaux des années 1945 à 1949 rapportent des vols dans les hôpitaux américains, des contrefaçons, des dilutions avec des substances dangereuses, et des chantages » [5]. Une bouteille de pénicilline se vendait 10 000 dollars.
Il est remarquable que, dans le film, l’individu responsable de cette escroquerie soit un Américain et non un Autrichien, un Allemand ou un Russe. Cela laisse clairement entendre que les nouveaux occupants et maîtres de l’Europe ne sont pas vraiment des libérateurs, mais des escrocs bourgeois qui jouent avec le destin d’un continent à genoux.
L’énigme de la mort de Harry Limes peut aussi être interprétée comme une allusion à l’idée qu’on ne peut pas entièrement se fier à l’anéantissement du nazisme par les Etats-Unis. De fait, leur programme de dénazification s’est avéré très limité, car ils ont décidé qu’il fallait intégrer les bureaucrates et généraux nazis à l’appareil d’Etat, pour servir de rempart contre le communisme.
Le film pose la question de ce qui est vraiment arrivé au sinistre Harry Limes et à son horrible trafic – tout comme nous pourrions poser la question : que sont devenus tous les anciens nazis et leurs biens mal acquis ?
Le directeur de la photographie, Robert Krasker, utilise magistralement les ombres projetées par les lampadaires, la nuit, pour accentuer l’impression que des choses louches nous sont cachées – et, peut-être, pour insinuer que les principaux personnages sont moralement douteux. C’est particulièrement frappant lors des séquences de poursuite où ne sont montrées que des ombres gigantesques projetées sur les murs, dans le style du célèbre film d’horreur vampirique Nosferatu (1922), de Murnau.
Une scène de poursuite se termine dans les égouts de Vienne, surnommés les « canaux du choléra » et construits dans les années 1830. Ici, personne ne peut savoir où il va, s’il est toujours en chasse ou s’il a perdu son homme dans l’une des très nombreuses alcôves.
Un aperçu de l’histoire réelle
Ces films magnifiques saisissent les aspects contradictoires d’un moment décisif, mais largement oublié, de l’histoire européenne.
Rome, ville ouverte montre que les nazis ont été combattus avec succès par des partisans et des gens ordinaires, dont beaucoup étaient des communistes, et qui auraient pu transformer la défaite des nazis en une puissante révolution abolissant le capitalisme dans toute l’Europe.
Allemagne, année zéro et Le Troisième Homme donnent un aperçu de la destruction quasi totale à laquelle Hitler et la classe dirigeante allemande ont conduit l’Allemagne et l’Autriche. Mais ils laissent aussi entendre que la domination de l’impérialisme américain sur l’Europe de l’Ouest, après la guerre, n’avait rien à voir avec la liberté ; il s’agissait seulement, pour les Etats-Unis, de dominer le marché mondial.
De nos jours, il n’y a tout simplement plus de films aussi réalistes et aussi étroitement liés à de grands événements historiques. Sauf exception, aucun film ne décrit les luttes et l’organisation de la classe ouvrière comme l’ont fait les chefs-d’œuvre néoréalistes de Rossellini.
L’Europe, cependant, s’oriente à nouveau vers une crise révolutionnaire. Ses gouvernements et ses vieux partis sont massivement rejetés, car ils n’ont pas d’autre programme que l’austérité permanente. Une nouvelle génération est sans voix. Elle la trouvera au cours des événements révolutionnaires qui s’annoncent – et qui verront aussi l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes audacieux.
[1] My Voyage to Italy (1999), [Film] Dir. Martin Scorsese, USA : Miramax Films [Traduction libre].
[2] Gallagher, Tag (Winter 1988). « NR = MC2: Rossellini, 'Neo-Realism', and Croce ». Film History. 2 (1). Indiana University Press, p. 87–97 [Traduction libre].
[3] R F Fenno (ed.), « The Crimea (Yalta) Conference; Protocol of Proceedings’, The Yalta Conference, D.C. Heath and Co., 1955, p. 35 [Traduction libre].
[4] https://theconversation.com/the-third-man-at-75-how-a-bombed-out-vienna-helped-create-a-gripping-post-war-thriller-243509 [Traduction libre].
[5] S K MacManus, « The Third Man was true – Penicillin in Post-War Austria », British Society for the History of Medicine, 4 April 2022 [Traduction libre].