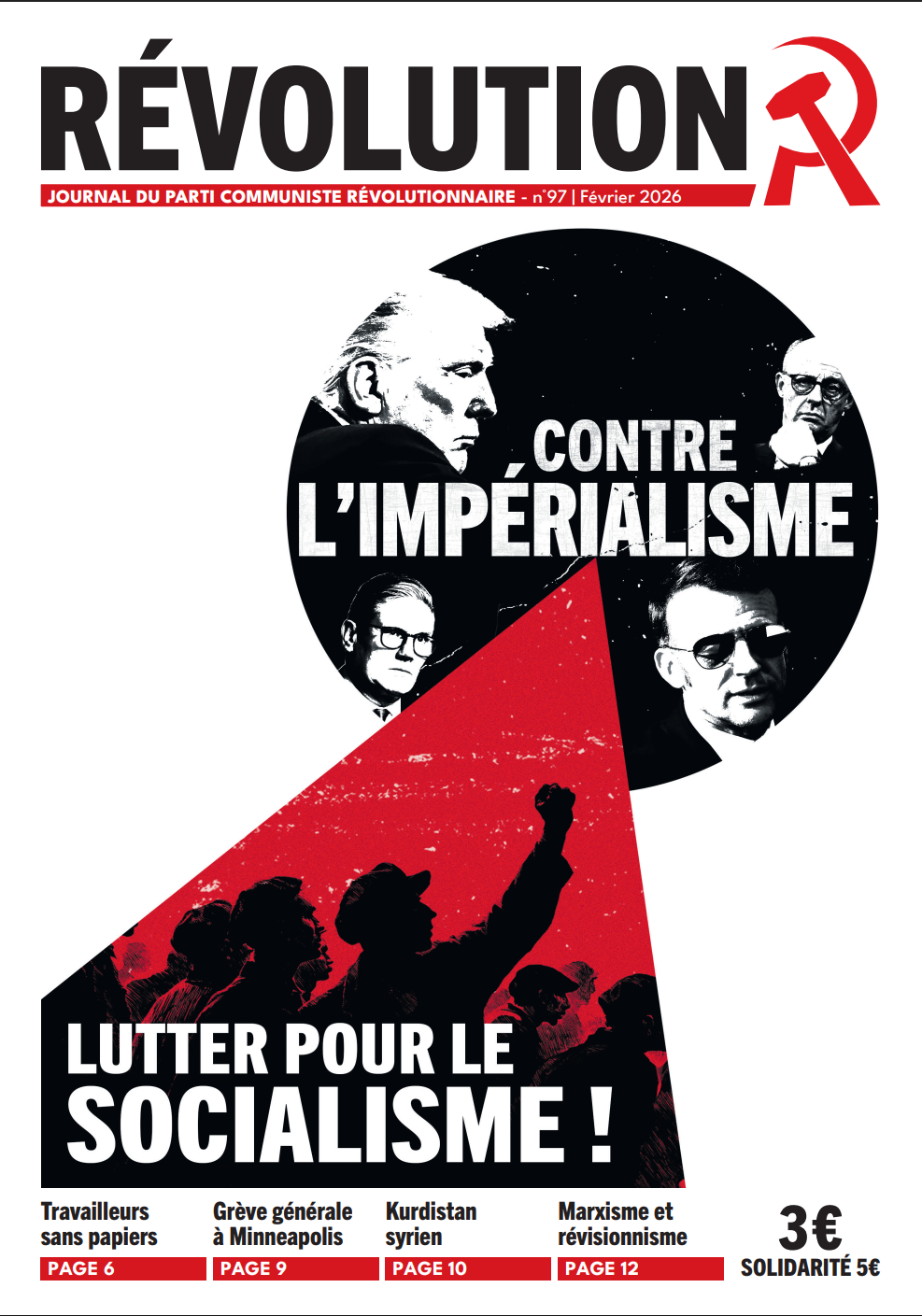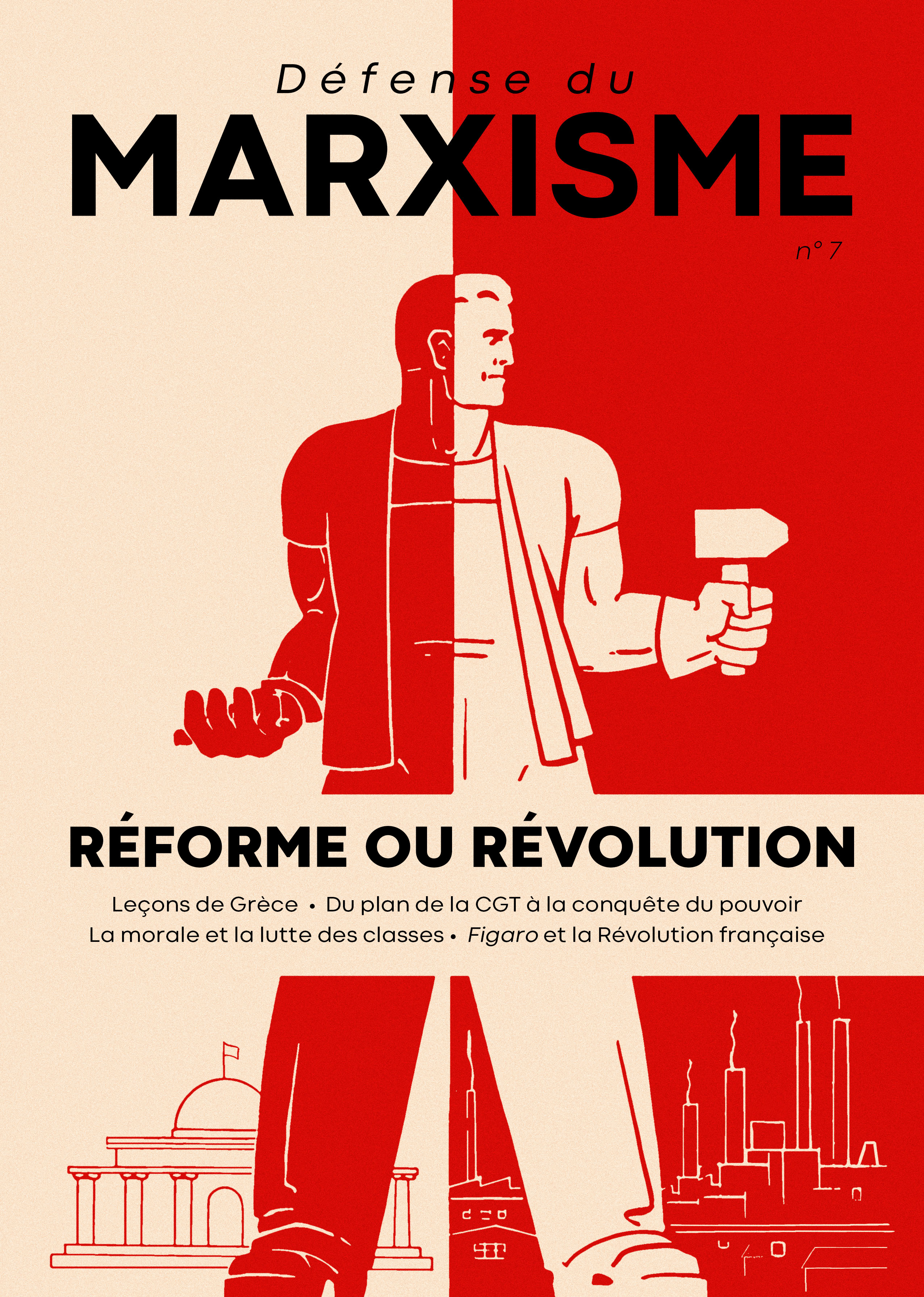La mobilisation du 18 septembre a été massive : plus d’un million de manifestants, de nombreux blocages et des taux de grévistes importants dans les transports, l’Education nationale et d’autres services publics. Quant aux hordes de « casseurs » prophétisées par Bruno Retailleau, elles n’étaient pas au rendez-vous.
Si on ne considère que les chiffres bruts, le 18 septembre n’a certes pas atteint le niveau des plus fortes mobilisations du mouvement contre la réforme des retraites, en 2023. Plusieurs « journées d’action » avaient alors franchi la barre des 3 millions de manifestants. Mais d’une part, en 2023, il a fallu plusieurs journées d’action pour atteindre le pic de la mobilisation. D’autre part et surtout, la mobilisation d’hier était encore plus radicale, dans son état d’esprit, que ne l’était celle de 2023. Ces deux dernières années, la colère a continué de s’accumuler dans les profondeurs de la société, sur fond de dégradation constante des conditions de vie, de génocide des Gazaouis et d’une crise de régime qui voit se succéder, à Matignon, un Père Fouettard après l’autre.
La présence massive de la jeunesse – surtout dans les grandes villes – est un élément central du mouvement qui a commencé le 10 septembre. La plupart de ces jeunes n’attendent strictement rien, à juste titre, des soi-disant « concertations » organisées par Lecornu, dont le seul objectif est de retarder sa chute – et auxquelles participent les dirigeants du PS, du PCF, des Verts et des confédérations syndicales. La jeunesse mobilisée exige la chute du gouvernement, la démission de Macron et, dans la foulée, une rupture radicale avec toutes les politiques anti-sociales de ces dernières années. Dans ce contexte, le mot d’ordre de notre parti – « Pour un gouvernement des travailleurs ! » – rencontre un écho très favorable chez beaucoup de jeunes avec lesquels nous discutons.
Cependant, ces mêmes jeunes se demandent : où va le mouvement ? Cette interrogation était générale, hier, sur les manifestations. Ce matin, l’intersyndicale des directions confédérales y a répondu dans un communiqué qui lance un « ultimatum » au gouvernement : « Si d’ici au 24 septembre il n’a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d’une nouvelle journée de grève et de manifestations. » Les « revendications » en question consistent notamment dans l’abandon de toutes les mesures du « plan Bayrou », mais aussi dans « l’abandon du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans » et dans « des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics ».
Cette stratégie de l’intersyndicale ne peut que susciter la déception et l’incompréhension dans de larges couches de la jeunesse et du salariat. Chez les plus conscients et les plus mobilisés, elle va même susciter de la frustration et de la colère. Au lieu de s’appuyer sur la combativité qui s’est exprimée, les 10 et 18 septembre, pour passer à la vitesse supérieure, l’intersyndicale suspend le mouvement au bon vouloir de Macron et Lecornu, auxquels elle donne cinq jours pour se demander s’ils vont renoncer à leur politique réactionnaire au profit d’une politique sociale.
Qui peut croire un instant que l’Elysée et Matignon vont répondre à l’« ultimatum » de l’intersyndicale en cédant sur ses revendications ? Au mieux, Lecornu annoncera quelques mesures symboliques et un allègement minimal de la charge austéritaire. C’est une question de rapport de forces entre les classes, étant entendu que Macron et Lecornu représentent la grande bourgeoisie, qui a objectivement et urgemment besoin de contre-réformes et de coupes drastiques dans les budgets sociaux : il y va de la compétitivité du capitalisme français, dont le déclin relatif s’est accéléré ces dernières années.
Le 10 et le 18 septembre ont confirmé la colère et la combativité croissantes de notre classe. Mais à elles seules, ces deux mobilisations ne peuvent pas contraindre le gouvernement à céder sur les revendications – pourtant très limitées – de l’intersyndicale. En 2023, sur la réforme des retraites, Macron n’a pas cédé d’un pouce face à quatorze « journées d’action », dont plusieurs ont dépassé les 3 millions de manifestants. Et pourtant, l’intersyndicale fait mine de croire que sur la base du 18 septembre et de la menace d’une autre « journée d’action » (et rien de plus), Macron et sa clique pourraient sérieusement reculer, cette fois-ci.
La vérité, c’est que les directions confédérales redoutent que la mobilisation n’échappe à leur contrôle. Le soi-disant « ultimatum » n’est qu’un prétexte pour renvoyer la prochaine mobilisation aux alentours de la fin du mois de septembre (ou même plus tard ?). Beaucoup de jeunes et de travailleurs le comprennent, dont beaucoup de militants politiques et syndicaux. Dès lors, ils ne peuvent pas laisser la conduite du mouvement entre les mains d’une intersyndicale qui s’efforce de le canaliser et de le délayer.
Tout ceci place une grande responsabilité sur les épaules des organisations les plus massives et les plus combatives du mouvement ouvrier. Comme nous l’écrivions le 15 septembre : « En appelant à la "grève générale", Mélenchon a frappé juste. Mais la construction d’une grève générale et, surtout, d’un vaste mouvement de grèves reconductibles, qui seul peut créer les conditions d’une victoire décisive de notre camp, suppose un énorme travail d’agitation et d’organisation – secteur par secteur, entreprise par entreprise.
« Plusieurs fédérations et structures locales de la CGT poussent dans cette direction, contre la volonté de leur direction confédérale. La FI doit se ranger aux côtés de l’aile gauche de la CGT et engager avec elle une vaste campagne pour construire un "blocage" durable du pays. Ce faisant, les travailleurs démontreront à tous – et d’abord à eux-mêmes – qu’ils sont la force décisive de la société, celle qui doit prendre le pouvoir et réorganiser l’économie sur de nouvelles bases : des bases socialistes. »