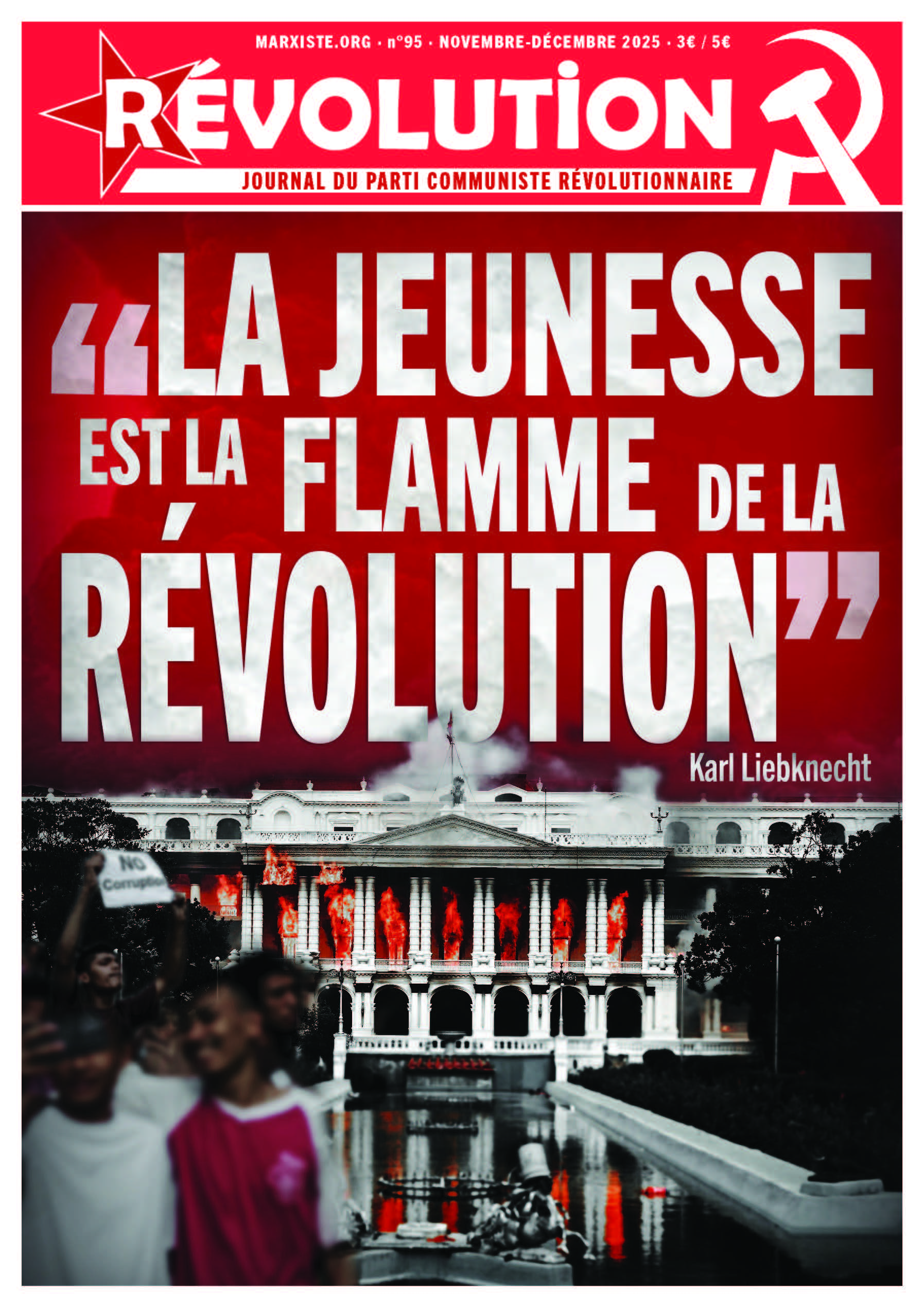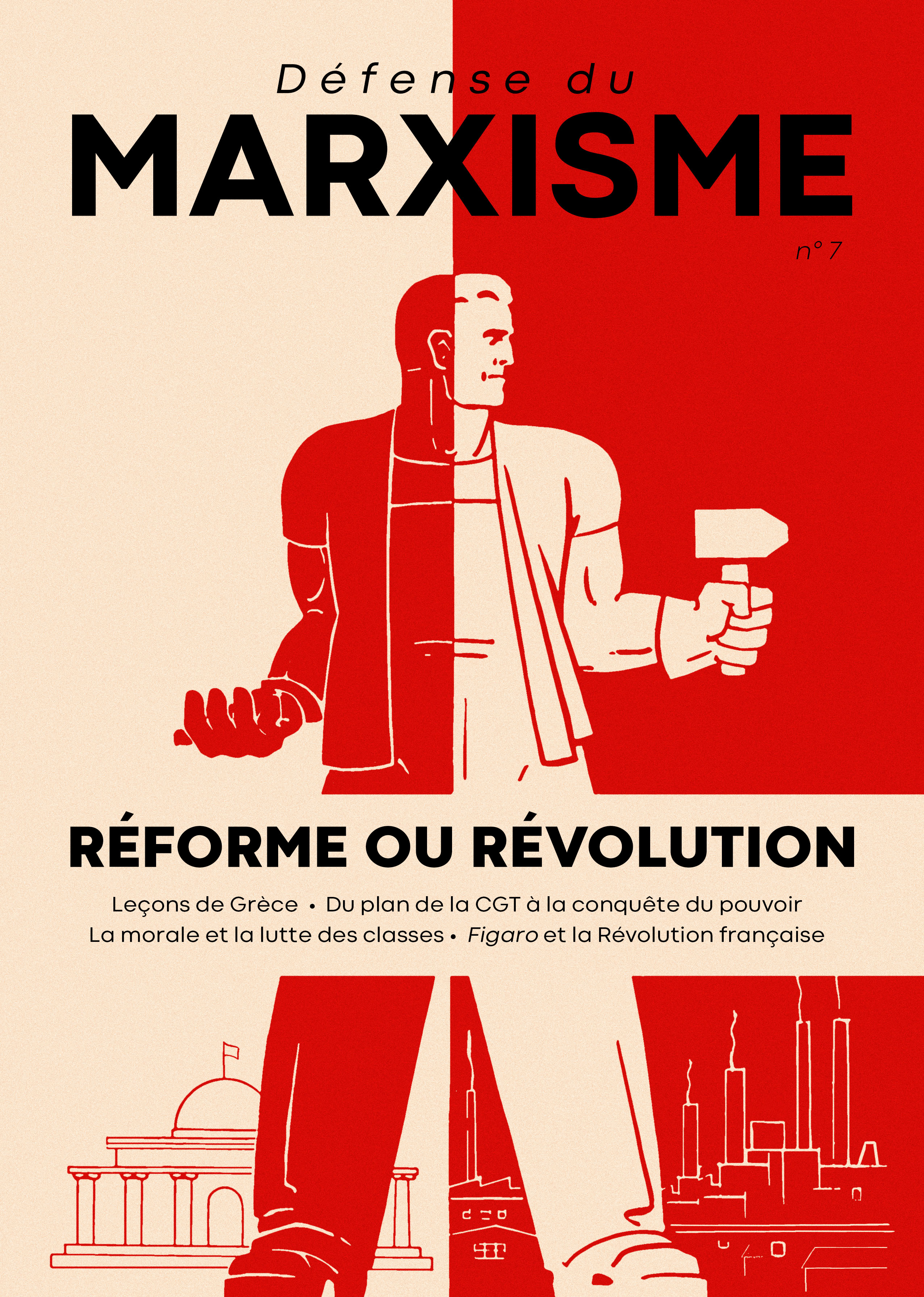Peux-tu nous présenter le métier de gardien de troupeaux ?
Je tiens d'abord à préciser que nous choisissons d'utiliser le terme « gardiens de troupeaux » car il nous permet de parler à la fois des bergers, des vachers et des chevriers. Bien sûr, la garde de chaque espèce présente des spécificités. Mais du point de vue des conditions de travail, nos situations sont identiques. Les qualifications de base pour exercer sont également similaires.
Nous sommes salariés par un ou plusieurs éleveurs, propriétaires des animaux que nous gardons et des chiens de protection qui les accompagnent. Cela peut se passer sur le lieu de l'exploitation agricole ou bien dans le cadre de transhumances estivales ou hivernales. L'image d'Épinal du berger en montagne est bien réductrice : elle évacue les autres contextes de garde, en plaine ou en collines, où les conditions de travail et d'hébergement sont tout aussi déplorables – voire pires.
Comme beaucoup de saisonniers agricoles, nous travaillons généralement dans le cadre de CDD saisonniers ou de contrats TESA (Titres Emplois Saisonniers Agricoles). Ces contrats très précaires peuvent être renouvelés indéfiniment et ne nous donnent pas droit à la prime de précarité. Les réformes successives de l'assurance chômage précarisent toujours plus notre situation en dehors des périodes sous contrat.
Peux-tu nous parler de tes conditions de travail ?
Elles sont difficiles. On part plusieurs mois, entre trois et six, souvent loin de chez nous. Sur le papier, on a droit à un jour de repos par semaine. Mais dans les faits, c’est loin d’être toujours respecté. Beaucoup de collègues font encore des saisons « non-stop », sans être rémunérés davantage.
Nos contrats sont de 35 ou 42 heures hebdomadaires selon les départements, pour un salaire horaire qui tourne souvent autour du SMIC. Mais en réalité, on travaille plutôt entre 60 et 80 heures par semaine !
Comme pour tous les travailleurs agricoles, la question du travail gratuit représente un véritable enjeu. Nous militons pour que notre droit au repos soit respecté. Nous revendiquons aussi des contrats qui prennent en compte l’ensemble du travail, y compris celui réalisé en dehors de la présence des animaux : repérages, installation des cabanes (normalement à la charge des employeurs, mais qu’ils délèguent souvent), installation de clôtures, approvisionnement, transport de matériel (héliportage et muletage…). Le travail gratuit doit cesser ! Il nous faut des jours de récupération, intégrés officiellement aux contrats.
Avec la montée de la prédation – loups, ours – les doubles voire triples postes de gardiens de troupeaux ont été développés, car ils sont subventionnés par l'Etat. Mais là encore, quand des salariés sont en repos (s’ils ont la « chance » d’en avoir un), ils ne sont pas remplacés. Dès que l’un manque, on se retrouve seul à tout gérer. Lorsqu’il faut deux gardiens, il en faut deux tout le temps !
Le fait de travailler en sous-effectif, de loger souvent dans des logements indécents, le manque d’accès à l’eau potable – voire à l’eau tout court… tout cela met en danger notre santé. On recense beaucoup d’accidents dus à l’épuisement, aux conditions sanitaires ou au manque d’entretien des cabanes.
Les moyens de communication en zone blanche (appareils spécifiques aux endroits sans réseau), qui devraient être fournis par nos employeurs, sont aussi trop rares. C’est dangereux en cas d’accident, et on doit se débrouiller seuls.
Aujourd’hui, notre travail nous coûte. En termes de santé et d’usure, mais aussi en termes d’investissements concrets : tout le matériel de montagne, les vêtements, chaussures, jumelles, sont à nos frais. Sans compter le matériel normalement fourni par l’employeur et qui n’est pas toujours à la hauteur des besoins réels (trousse de premiers secours, talkie-walkie, contenants de stockage, produits de soin vétérinaires, etc.).
Comment s’est passée la création du Syndicat des gardiens de troupeaux (SGT CGT) ?
Le SGT est né une première fois en 2013 en Isère. Après une période à vide, il a été relancé en Ariège en 2018. Aujourd’hui, il est présent dans les Pyrénées, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud et les Cévennes. On compte environ 150 syndiqués sur, peut-être, 3000 gardiens. Le nombre réel de gardiens de troupeaux est difficile à connaître car les données ont tendance à mélanger les éleveurs – qui se font aussi volontiers appeler « bergers » – et les salariés.
Nos conditions de travail et d’embauche font qu’on est souvent seuls face au groupement pastoral – une structure qui regroupe plusieurs éleveurs pour gérer collectivement l’embauche de gardiens de troupeaux – pour négocier notre salaire ou faire valoir nos droits. Il fallait qu’on s’organise collectivement pour sortir de cet isolement.
Concrètement, nos conditions de travail sont encadrées par plusieurs textes. Dans certains départements, il existe déjà des règles particulières pour notre métier. On appelle ces textes des « avenants bergers » : ce sont des accords locaux qui précisent certaines conditions spécifiques de notre travail, comme les horaires, le logement ou les salaires.
Mais au niveau national, la seule référence officielle est la Convention Collective Nationale de la Production Agricole et des Coopératives d'Utilisation Agricole, signée en 2020. Ce texte est très général : il concerne l’ensemble des salariés agricoles, mais ne prend pas en compte les réalités spécifiques du métier de gardien de troupeaux.
Grâce à la mobilisation et au rapport de force que nous avons construits collectivement, nous avons obtenu l’ouverture de négociations nationales pour créer un avenant spécifique aux gardiens de troupeaux. Ce serait une avancée majeure pour faire reconnaître enfin les particularités de notre métier dans la loi.
Nos employeurs sont considérés comme des « petits » éleveurs. Mais il faut faire attention avec cette qualification, dans le sens où l’élevage est soumis aux mêmes logiques de rentabilité que les autres secteurs productifs. Ils doivent être concurrentiels et s'agrandir. Nous refusons que notre salaire et nos conditions de travail soient l’éternelle variable d’ajustement de leurs profits et de leur modèle économique.
On nous reproche souvent d’appliquer une lecture matérialiste à la production agricole, comme si la lutte des classes n’existait pas ici… Comme si les « petits paysans », nos employeurs, étaient nos camarades. Nous refusons tout corporatisme : on se sent plus proches d’un ouvrier à la chaîne chez Bonduelle que d’un producteur de laine mohair.
On a choisi d’être rattachés à la CGT car on adhère à son héritage marxiste et parce qu’il s’agit d’une organisation de masse. Ce caractère massif nous permet d’être représentatifs et de siéger en commissions paritaires pour négocier.
Partout où nous avons mené des mobilisations, les conditions de travail ont été améliorées. La lutte paie !
Salariés de tous les secteurs, unissons-nous !