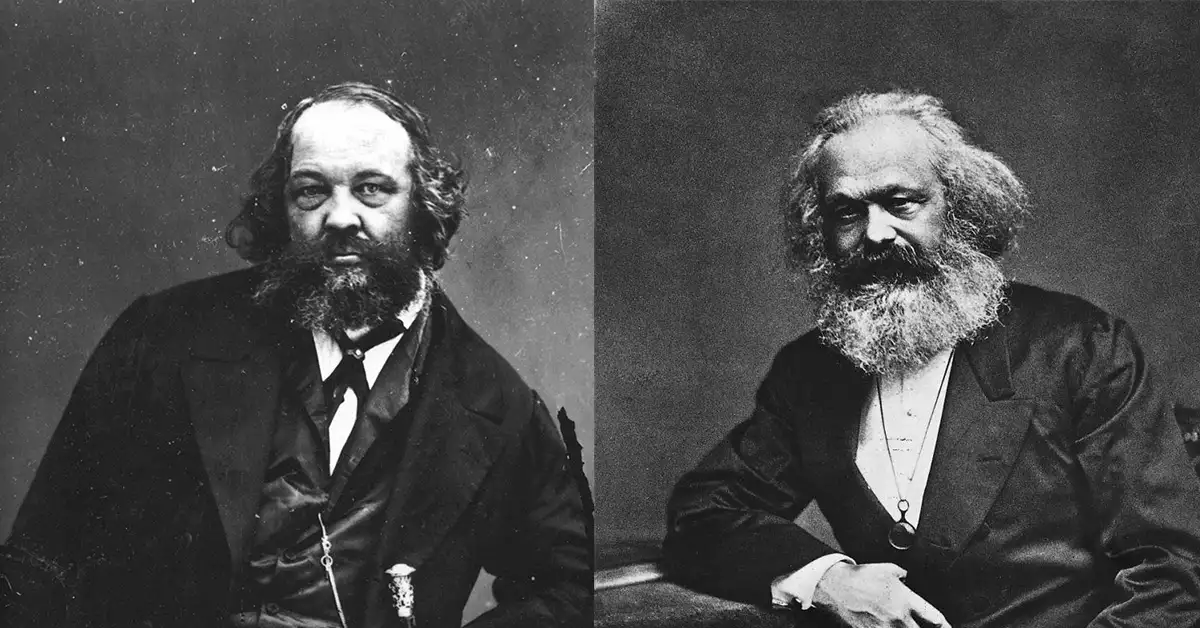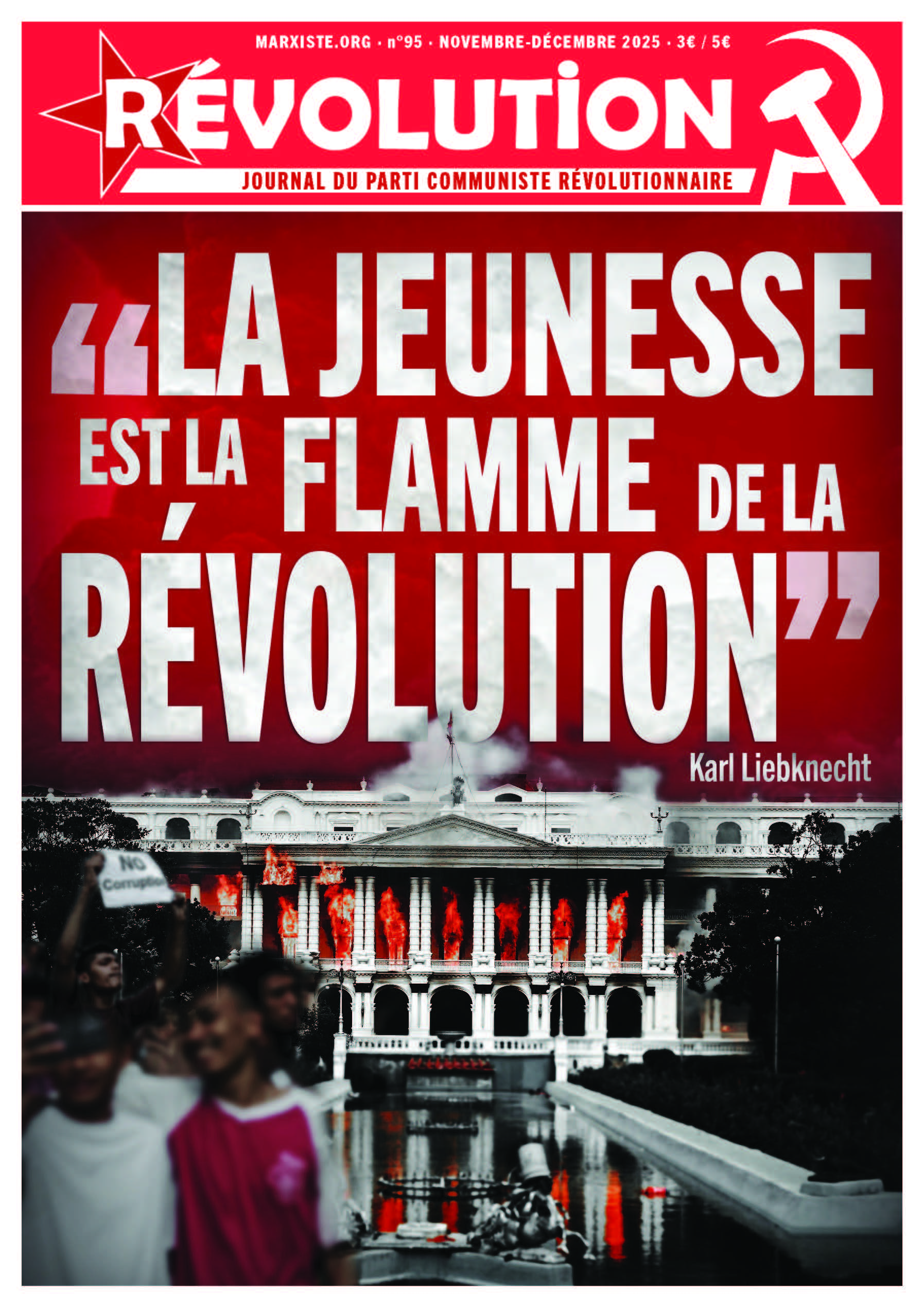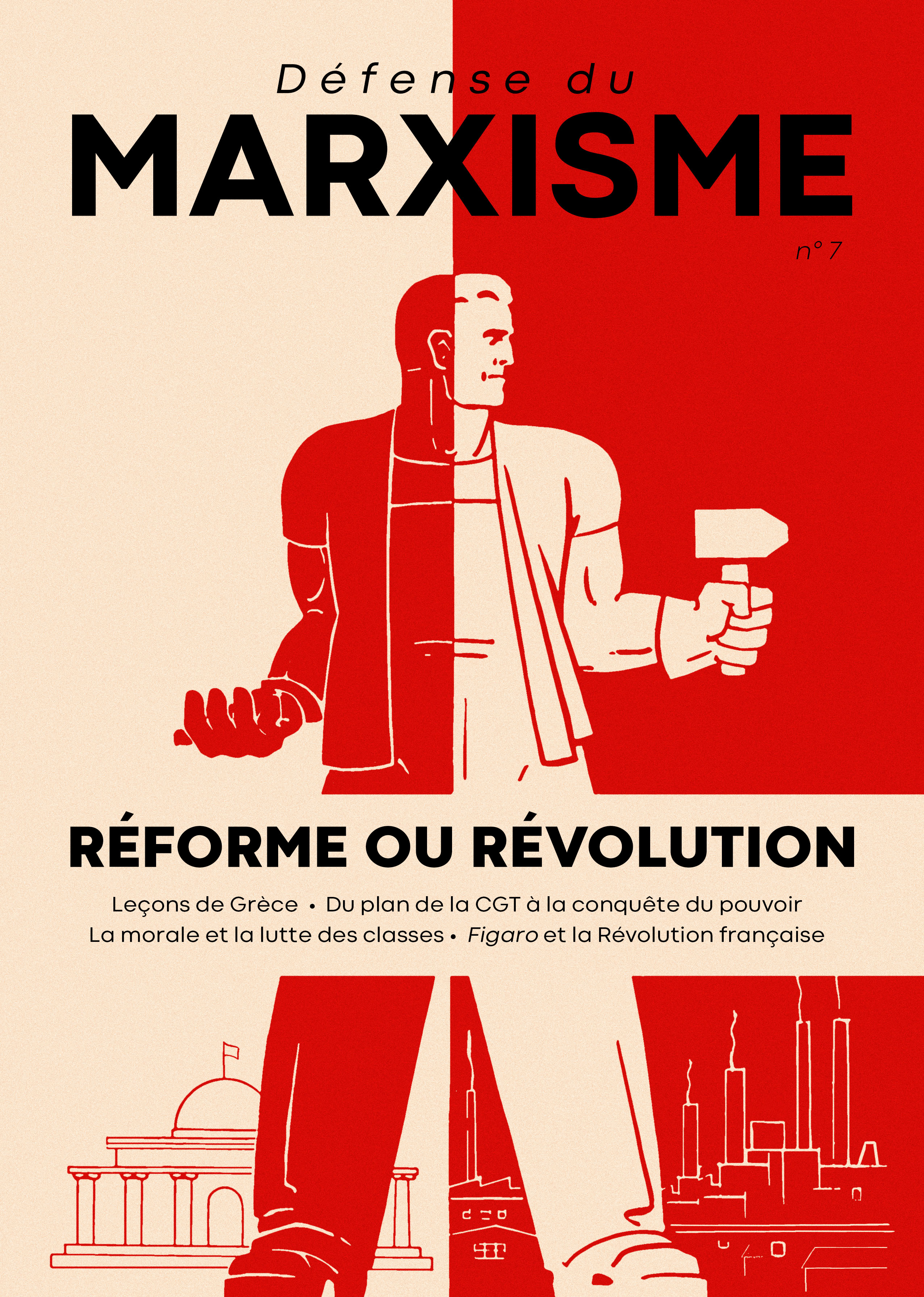Pourquoi doit-on discuter de cette question ?
En tant que tendance organisée dans le mouvement ouvrier, l’anarchisme est relativement marginal, désormais – pour des raisons que j’expliquerai.
Mais, du fait de notre travail en direction de la jeunesse, on est confronté à des tendances, des idées anarchisantes – qu’il faut connaître et combattre, mais pas n’importe comment.
*
Les idées anarchistes émergent au début du XIXe siècle – elles sont alors surtout associées aux noms de Joseph Proudhon et de Mikhaïl Bakounine.
Comme toute doctrine politique qui parvient à s’enraciner dans la société (c’est-à-dire qui n’est pas le délire solitaire d’un individu isolé), l’anarchisme exprime un point de vue de classe déterminé.
C’est parfaitement clair, au XIXe siècle, l’anarchisme représente le point de vue de la petite-bourgeoisie – petits artisans, paysans, etc. – qui constituaient alors une partie importante de la population active (voire sa majorité dans nombre de pays).
En ce sens, l’anarchisme se rattache au socialisme utopique – lequel ne percevait pas le rôle spécifique de la classe ouvrière dans la révolution.
L’influence de l’anarchisme sur le mouvement ouvrier à ses débuts (notamment celle de Proudhon en France) reflète l’immaturité sociale et politique du prolétariat naissant.
C’était d’ailleurs particulièrement le cas en Espagne, en Italie et en Suisse – précisément du fait de la composition de classe de ces pays – qui étaient en retard du point de vue du développement capitaliste.
En Grande-Bretagne, à l’inverse, l’anarchisme était marginal parce que la classe ouvrière moderne y était beaucoup plus développée.
*
Du fait qu’il repose sur la petite-bourgeoisie – dont le point de vue est contradictoire car elle est tiraillée entre les deux autres grandes classes – l’anarchisme se caractérise par sa confusion, sur le plan théorique mais aussi, du coup, par son extrême hétérogénéité.
Il existe toutes sortes d’anarchistes et d’anarchismes.
Entre l’« anarchisme » individualiste d’un Bakounine et l’« anarchisme » d’un Durruti (Espagne), par exemple : il y a un gouffre.
Dans la mesure où l’anarchisme s’éloigne des tendances petites-bourgeoisies, il tend à se rapprocher du bolchevisme. C’est le cas de Durruti qui avait adopté, pendant la révolution espagnole, un programme et des méthodes proches de ceux des bolcheviques.
L’Espagne a été le pays où la greffe de l’anarchisme sur le mouvement ouvrier est allée le plus loin.
Au point que la CNT était à un moment donné la plus puissante organisation ouvrière d’Espagne et organisait les meilleurs éléments du mouvement ouvrier espagnol, en particulier en Catalogne.
Ils n’avaient rien à voir avec l’individualisme petit-bourgeois de Bakounine, qui rejetait explicitement l’idée que la classe ouvrière ait un rôle révolutionnaire à jouer.
Bakounine écrivait notamment : « Nous, anarchistes, considérons avec répugnance une autre expression du programme social-démocrate, à savoir la désignation du prolétariat, des travailleurs, comme une classe, et non comme une masse. Vous savez ce que cela signifie ? Ce n’est rien de moins que la domination aristocratique des travailleurs des usines et des villes sur les millions des prolétaires des campagnes » (les paysans).
Autrement dit, Bakounine ne comprenait pas – ou ne voulait pas comprendre – le rôle spécifique de la classe ouvrière moderne dans le processus de production, et donc dans les destinées politiques de la société.
Souvent, Bakounine encore plus explicite : les forces sociales de la révolution, selon lui, consistaient en une alliance entre les petits paysans, les petits artisans et le lumpenprolétariat (c’est-à-dire les éléments déclassés : les mendiants, les prostituées, les truands, etc.).
C’est l’expression d’un point de vue typiquement petit-bourgeois et hostile à la classe ouvrière.
*
Ce caractère petit-bourgeois est visible aussi dans le programme économique de l’anarchisme : qui prône une société de « petites communes libres et autogérées », refuse la centralisation, refuse la grosse industrie (qui avale les « petits producteurs », les petits artisans, etc.).
Aujourd’hui, un tel programme semble absurde : que fait-on d’EDF, de la SNCF, d’Airbus, de la grande industrie ? On les fragmente et on les distribue dans les « petites communes libres » ?
De manière générale, on ne peut pas organiser de cette manière les grandes infrastructures et les chaînes de production et de transport qui sont nécessaires à la recherche, aux services de santé, etc.
Sur le plan économique, l’anarchisme veut faire tourner la roue de l’histoire à l’envers.
*
Comme organisation de masse de la classe ouvrière, l’anarchisme est mort.
Très précisément : il est mort en Espagne en 1939, avec l’écrasement de la révolution espagnole et la victoire de Franco.
A la chute du franquisme, on a assisté à une résurgence du PC et du PS en tant qu’organisations de masse – mais pas de la CNT.
Ce pour 2 raisons :
- la composition sociale de la société espagnole qui était devenue bien plus prolétarienne ;
- le refus de la CNT de mener une lutte politique, sous le franquisme : ce qui était absurde.
L’anarchisme est mort, comme organisation de masse de la classe ouvrière.
Mais pas comme tendance idéologique à l’œuvre, sous différentes formes, dans les classes moyennes, la classe ouvrière et la jeunesse (en particulier).
De ce point de vue, il est toujours vivant – et bien vivant : beaucoup plus influent que les idées authentiques du marxisme, à ce stade.
Perméabilité des travailleurs – et de la jeunesse étudiante en particulier – aux idées « étrangères » à notre classe
Ça vaut pour les idées ouvertement réactionnaires (racistes, nationalistes, bourgeoises) – mais aussi pour les idées ultra-gauchistes, anarchisantes, etc.
Il existe une pression des « classes moyennes » sur le mouvement ouvrier – surtout, une pression des idéologues petit-bourgeois comme Lordon, Friot, etc.
D’autant plus que les dirigeants officiels du mouvement ouvrier ne défendent plus les idées marxistes révolutionnaires...
Toutes sortes d’idées viennent remplir le vide qui en résulte, parmi lesquelles forcément, des idées anarchistes, gauchistes… Tout ce qui sonne un peu radical.
Aujourd’hui encore il y a, parmi tous ceux qui sont influencés par l’anarchisme, de bons éléments. Leur « anarchisme » est l’« enveloppe d’un bolchevisme immature ».
Lénine disait que le gauchisme était le « prix à payer pour la trahison des dirigeants sociaux-démocrates ». Il ajoutait qu’il s’agissait souvent d’une réaction saine, qu’il fallait corriger pour gagner les meilleurs éléments au bolchevisme.
Soit dit en passant, il existe un mythe selon lequel il aurait existé une « opposition implacable » des bolcheviks à l’égard des anarchistes russes.
Il cite en exemple notamment la répression de l’insurrection de Cronstadt et la répression des aventures militaires de Makhno.
On a des articles qui explique en détail ces deux sujets, mais on peut quand même en dire deux mots.
Pour ce qui est de Cronstadt, qualifier les insurgés d’anarchistes est un abus de langage évident. C’était en réalité une insurrection de conscrits d’origine paysanne et petite-bourgeoise, inspirés par des éléments réformistes, qui défendaient un programme de rétablissement du commerce et, in fine, de retour au capitalisme.
Pour ce qui est de Makhno, c’était un authentique anarchiste. Son armée représentait la petite paysannerie propriétaire (paysannerie « moyenne ») du Sud de l’Ukraine, mais était complètement déconnectée de la classe ouvrière ou même de la paysannerie pauvre.
Dans tous les cas, l’« indépendance » de ces mouvements en pleine guerre civile, alors que les armées impérialistes guettaient une occasion de poignarder la révolution, représentait un risque mortel pour la Russie soviétique. Leur écrasement militaire était donc une « tragique nécessité » selon le mot de Trotsky.
Mais ces deux « affaires » ne résument pas l’attitude des bolcheviks vis-à-vis des anarchistes.
Lénine insistait pour que l’on publie les œuvres de Kropotkine, comme des éléments de l’histoire du mouvement socialiste russe.
Lénine et Trotsky se sont adressés aux anarcho-syndicalistes français, comme Rosmer et Monatte, et ont réussi à les convaincre de se rallier au bolchevisme.
Un certain nombre d’anarchistes russes, comme Victor Serge, se sont eux aussi ralliés au bolchevisme.
La CNT espagnole a même envisagé de rejoindre la IIIe Internationale, avant de reculer.
*
Il faut qu’on ait une attitude flexible à l’égard des tendances anarchisantes dans la jeunesse
Ces tendances peuvent être le fruit de l’influence des idées petite-bourgeoisies. Mais elles peuvent aussi représenter aussi un rejet (sain) des bureaucraties qui dominent les grandes organisations réformistes (CGT, CFDT, PS, PCF, FI).
Ces deux facteurs ne pèseront pas toujours le même poids, selon les personnes. D’ailleurs, il faut rappeler que des travailleurs aussi peuvent être influencés par des idées petite-bourgeoises.
*
Une des idées anarchisantes les plus répandues, c’est le refus de l’organisation et, en particulier, de toute direction politique. Bakounine disait même : « toute organisation écrase inévitablement la liberté du peuple ».
Si on pousse cette idée jusqu’au bout, cela signifierait qu’il ne faut aucun parti et aucun syndicat.
Mais cela signifie réduire la classe ouvrière à l’état de matière première disponible pour l’exploitation capitaliste.
Certains soi-disant « anarchistes » vont effectivement jusque-là, des petit-bourgeois individualistes qui réflechissent en solitaire. C’est le cas notamment de Max Stirner, que Marx et Engels ont critiqué dans La sainte famille.
Ou dans un autre genre, plus bruyant et moins intellectuels, les « autonomes » et les « black blocks » qui se réunissent uniquement pour semer la pagaille dans telle manif ou telle AG, et se moquent complètement des conséquences que cela aura pour le reste du mouvement, au nom de leur « liberté d’action individuelle ».
Mais en réalité, la plupart des militants anarchistes ne poussent pas jusqu’au bout le refus de toute direction.
A partir du moment où ils se réunissent pour décider de sortir un tract ou un journal : ils font de la politique et doivent confier des tâches à des « dirigeants ».
*
Il existe une tendance anarchisante particulièrement répandue dans la jeunesse. Elle part du principe que « les partis, ça dégénère, ça se bureaucratise », et qu’il faut donc… se passer de parti.
Notre réponse doit être positive : Oui, le PS, le PCF, les grandes confédérations syndicales, etc. ont dégénéré.
Mais :
1) il faut comprendre pourquoi ils ont dégénéré.
Cette dégénérescence ne vient pas de la forme d’organisation en « parti », mais bien des pressions extérieures à l’organisation, en lien avec son environnement économique et politique.
Aucune organisation – même la plus révolutionnaire – n’est à l’abri de la dégénérescence.
Exemple : le parti bolchevik ! C’était le parti le plus révolutionnaire et le plus démocratique au monde, mais cela ne l’a pas empêché, dans les conditions qui ont donné naissance au stalinisme, de devenir l’instrument d’un régime totalitaire.
Autrement dit : non, il n’y a pas de garantie qu’une organisation ne dégénère pas. Comme le dit souvent Alan Woods : « ceux qui veulent une garantie doivent acheter une télévision ».
Mais réciproquement, il n’y a aucune fatalité à ce qu’un parti dégénère.
Il est possible d’agir pour l’empêcher.
Pas par des formules organisationnelles ou des règlements intérieurs démocratiques, etc.
Par exemple, le PCF aujourd’hui est formellement très démocratique, mais cela n’empêche pas sa direction d’être totalement bureaucratisée.
Le problème est que la bnase du PCF n’a pas le niveau politique qui lui permettrait de comprendre les problèmes auquel son parti est confronté et de changer sa direction.
La principale qu’on peut faire pour éviter la bureaucratisation, c’est de soigner l’éducation politique des militants : mieux ils seront éduqués, plus ils pourront juger, comprendre et éventuellement corriger ce que fait la direction.
2) La nécessité d’un parti révolutionnaire découle de la situation même de la classe ouvrière sous le capitalisme
Il existe différentes couches de travailleurs, qui sont plus ou moins conscientes.
Une partie, minoritaire, arrive à des conclusions révolutionnaires avant l’autre partie, majoritaire, qui n’arrive à des conclusions révolutionnaires que sur la base de son expérience, et notamment de son expérience politique.
C’est la différence entre la classe en soi – qui existe objectivement – et la classe pour soi – qui a pris conscience de ses intérêts de classe.
Quant aux conclusions révolutionnaires, la majorité de la classe ouvrière y arrive seulement dans le cadre même d’une révolution.
Or, au cours de la révolution, la masse de la classe ouvrière ne peut pas s’élever d’elle-même – sans parti, sans direction – au niveau des tâches de la conquête du pouvoir.
Affirmer le contraire, c’est pure démagogie et c’est en contradiction complète avec toute l’expérience du mouvement ouvrier international.
De l’Egypte à la Tunisie en 2011 à Mai 68 en passant par la Commune de Paris, des dizaines de révolutions ont été vaincues parce qu’il leur manquait un parti révolutionnaire, capable de leur proposer une tactique et un programme.
En Russie en 1917, c’est la présence du parti bolchevik qui a permis de sauver la révolution. Elle aurait fini par être écrasée si les bolcheviks ne l’avait pas menée à la prise du pouvoir.
Ce Parti doit être construit avant la révolution, car pendant la révolution, c’est trop tard.
*
Il existe aussi un rejet anarchiste de la politique, de l’organisation politique, qui est lié au fétichisme de la « grève générale ».
Est-ce que la grève générale est l’expression suprême de la lutte des classes ? Non. Elle est insuffisante en elle-même, comme le montre l’exemple de Mai 68. Malgré la grève générale massive, la classe ouvrière n’a pas réussi à renverser le capitalisme.
Autre exemple : à Barcelone en juillet 1936, la classe ouvrière se soulève contre les officiers fascistes qui vienne de tenter un coup d’Etat. Mais la CNT refuse de prendre le pouvoir, et donc, laisse les staliniens et les réformistes reconstituer l’appareil d’Etat.
C’était une première erreur.
Là dessus, les dirigeants anarchistes en ont commis une deuxième : ils sont rentrés au gouvernement bourgeois, avec les staliniens, les réformistes et les républicains bourgeois « de gauche ».
Ces erreurs sont la conséquence de la doctrine anarchiste, qui rejette l’idée même de la prise du pouvoir par la classe ouvrière.
Grève générale pose la question du pouvoir, mais en elle-même ne peut pas y répondre. Il est nécessaire de prendre le pouvoir, et pour ça, il faut un parti révolutionnaire.
Trotsky résumait ainsi la différence entre marxisme et anarchisme sur l’Etat : « La bourgeoisie dit : ne touchez pas au pouvoir d’Etat ; c’est le privilège héréditaire et sacré des classes éduquées. Les anarchistes disent : n’y touchez pas, c’est une invention infernale, diabolique. Les deux disent : n’y touchez pas. Nous disons aux travailleurs : ne vous contentez pas d’y toucher : prenez le, et faites-le fonctionner dans vos propres intérêts, pour l’abolition de la propriété privée et pour l’émancipation de la classe ouvrière ».
*
Quand au refus des directions qui seraient « autoritaires », là aussi, les anarchistes tombent dans des contradictions insolubles.
Malgré tout ce qu’ils peuvent prétendre, ils ont des dirigeants, parce qu’il y a toujours des dirigeants, qu’on le veuille ou non.
C’est rendu nécessaire par la division du travail dans une organisation. Mais aussi par le fait que les camarades plus expérimentés auront tendance à avoir plus d’autorité et leur point de vue va davantage peser dans la décision.
En fait, un régime interne dans lequel la direction n’est pas élue et n’est pas contrôlable, c’est le pire possible pour une organisation : en l’absence de mécanismes formels de contrôle, c’est la porte ouverte à la dictature d’une clique ou d’un individu.
C’était le cas de Bakounine, qui se comportait comme un tyran dans sa propre organisation.
Ce refus des directions, de la discipline et des décisions majoritaires, c’est complètement en contradiction avec l’expérience concrète de la classe ouvrière, qui est habituée à la discipline collective dans l’entreprise – et dans la lutte.
Durant une grève, il y a une assemblée générale et c’est la majorité qui décide. Si elle vote la grève, c’est son intérêt de toute faire pour que la minorité respecte la décision et ne brise pas la grève. Pas question de « liberté individuelle », ici.
*
Ce préjugé se retrouve d’ailleurs au sommet de la FI. Mélenchon répète régulièrement qu’il ne faut pas élire les dirigeants, ni décider par des votes majoritaires.
Il écrivait même : « Pas de candidature, pas de vote qui exclue et mortifie, pas de majorité et de minorité, aucune raison de fabriquer des conflits théoriques pour habiller les conflits de personne »
Des « conflits théoriques artificiels » pour « habiller des conflits de personne » ?
C’est-à-dire que l’opposition entre jacobinisme et girondisme durant la révolution française étaient des « conflits de personne » ? Et l’opposition entre bolchevisme et menchevisme ? Ou entre trotskysme et stalinisme ? Ou, aujourd’hui, entre Hollande et Mélenchon lui-même ?
Par ailleurs, qu’est-ce que ça signifie l’idée qu’« il ne faut pas de majorité » mais plutôt un « consensus » ? Ça signifie donner un droit de veto à la minorité – et même théoriquement à un individu – pour empêcher la majorité d’agir comme elle le souhaite.
Dans le cas de la FI, ça signifie surtout que les décisions prises en haut, par Mélenchon et son entourage, sans que la base ne puisse exercer aucun contrôle.
Cette démagogie « anarchisante », qui s’appuie sur la méfiance d’une partie de la jeunesse et des travailleurs vis-à-vis des vieux partis comme le PCF ou le PS, sert à justifier le contrôle bureaucratique de la FI.
En conclusion, il faut étudier l’anarchisme et toutes les question qui y sont liées : le rôle de la classe ouvrière, du parti, de la direction, etc.
A nous de défendre ces idées du marxisme sur ce thème, pour gagner les meilleurs éléments, ceux qui cherchent nos idées.