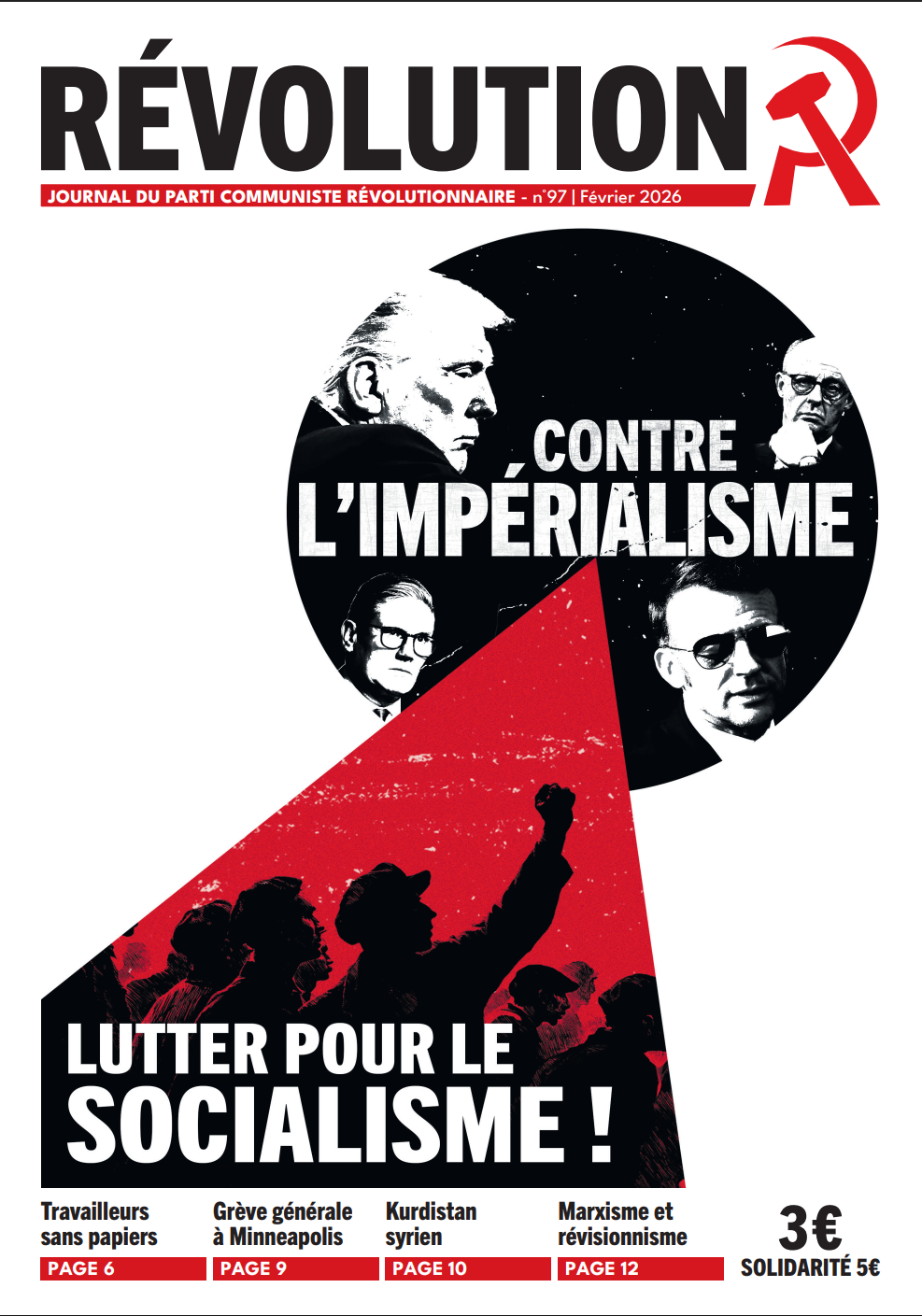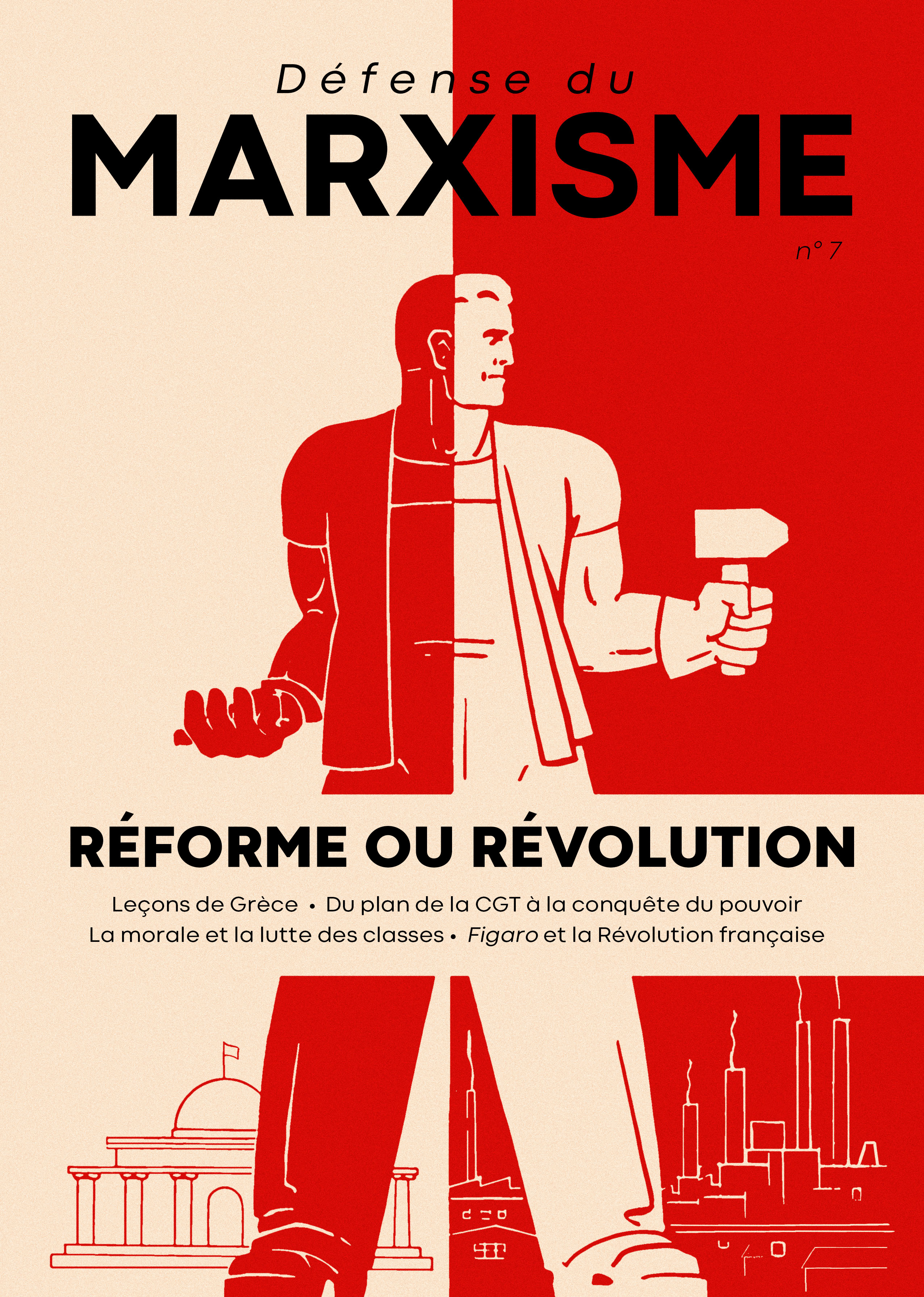S orti en 1980, Le Roi et l’Oiseau est souvent considéré comme l’un des plus grands films d’animation français. Pour plusieurs générations de spectateurs, il s’agit d’un monument de l’enfance.
Préparé par son réalisateur Paul Grimault tout au long des années 1970, en coopération avec Jacques Prévert, ce long-métrage porte l’empreinte des luttes de classe de cette décennie. Traité sous la forme d’un conte, son thème n’est rien moins qu’une révolution.
Le film met en scène deux personnages de tableaux – une bergère et un ramoneur – qui s’échappent de la chambre du despotique roi de Takicardie. Aidés par un oiseau coloré, ils partent alors à la découverte du monde. Pour conquérir leur liberté, ils devront renverser le tyran et, ce faisant, libérer l’ensemble du royaume.
Le rôle de Jacques Prévert
Sur le plan visuel, Le Roi et l’Oiseau emprunte largement aux artistes d’avant-garde du XXe siècle : les décors évoquent les gravures d’Escher et les tableaux de Chirico, tandis que de nombreux éléments de l’intrigue s’inspirent des œuvres de Dalí et de Miró.
Ce long-métrage est aussi la dernière œuvre de Jacques Prévert, qui en signe le scénario et les dialogues. Il leur imprime sa marque poétique et politique. Il n’est pas exagéré de dire que Prévert est le deuxième auteur du film, même s’il est mort avant de l’avoir terminé.
Le célèbre écrivain avait un itinéraire politique précis [1]. Longtemps, Prévert avait mis son art au service de la révolution, notamment à travers le théâtre populaire de sa troupe, « Octobre », dont Grimault a également été membre. Les zigzags et trahisons successives des dirigeants du PCF avaient éloigné Prévert du mouvement révolutionnaire au milieu des années 1930. Mais à l’époque où il travaille, avec Grimault, sur Le Roi et l’Oiseau, Prévert a retrouvé une partie de sa fougue politique, notamment sous l’impact de Mai 1968.
Dictature…
Au-delà de tous ses aspects merveilleux, c’est bien une révolution que Le Roi et l’Oiseau nous donne à voir. Le titre même recentre l’intrigue sur sa dimension politique : là où l’histoire originale – un conte d’Andersen – s’intitulait La Bergère et le Ramoneur, Grimault et Prévert choisissent d’insister sur l’opposition de la figure tyrannique du roi à celle, subversive, de l’oiseau.
D’emblée, le film dresse un drolatique tableau du régime dictatorial de la Takicardie : son souverain, le roi Charles-V-et-trois-font-huit-et-huit-font-seize, sature son royaume de mille et une formes de son portrait. Selon son caprice, il peut faire disparaître subitement tous ceux qui lui déplaisent au moyen d’un système de trappes. Des policiers sont embusqués dans les moindres recoins, prêts à intervenir…
Culte de la personnalité, répression systématique : la Takicardie fait songer aux régimes fascistes (dont Grimault et Prévert ont été les contemporains), aux dictatures renversées au Portugal (en 1974), en Espagne (en 1975) et en Grèce (en 1974), mais aussi aux régimes staliniens d’URSS et d’Europe de l’Est.
… et exploitation
Mais Le Roi et l’Oiseau ne se contente pas de critiquer la tyrannie en général. La Takicardie a beau être un royaume imaginaire, il conserve le caractère concret d’une société de classes. Tandis que la cour jouit des niveaux supérieurs du royaume, le peuple habite la ville basse, dans une misère manifeste et sous étroite surveillance policière. La lumière n’y pénètre jamais, et lorsque les deux fugitifs y arrivent, les habitants leur demandent : « Est-ce vrai que le monde existe ? Est-ce vrai que le Soleil brille ? ». Cette stratification sociale nous rappelle toutes sortes d’univers dystopiques, mais on comprend qu’en concevant cette ville basse, Grimault et Prévert pensaient aux banlieues ouvrières et aux bidonvilles français de l’époque.
Au-delà de son aspect dictatorial, la Takicardie est un condensé d’exploitation capitaliste. Le travail à la chaîne occupe une place importante dans l’intrigue, car le roi condamne tous ses opposants – dont l’oiseau et le ramoneur – à trimer à l’usine, dont l’activité est entièrement tournée vers la reproduction d’effigies du roi.
A la bergère, qui le supplie de libérer ses amis, le roi répond : « Le travail, ma belle, c’est la liberté ! ». Si cette formule rappelle celle que les nazis inscrivaient à l’entrée des camps de concentration, il est clair que Prévert exprime ici sa haine de l’exploitation capitaliste et de toutes les formes de travail sous contrainte.
Pour en finir avec le tyran, les héros recourent aux armes forgées par l’ancien régime lui-même. Les personnages retournent contre son maître un robot géant ; ils en font l’arme de la destruction du régime. Cette merveille technique – que le roi employait pour maintenir son ordre social – devient, dans les mains des opprimés, un instrument de libération, qui leur permet de se défaire du roi et de son royaume. Cette dialectique est présente dans toutes les révolutions : l’ancien monde engendre et développe lui-même la classe et les outils qui finissent par le renverser.
[1] Lire notre article : « Jacques Prévert : poésie, théâtre et communisme », sur marxiste.org.