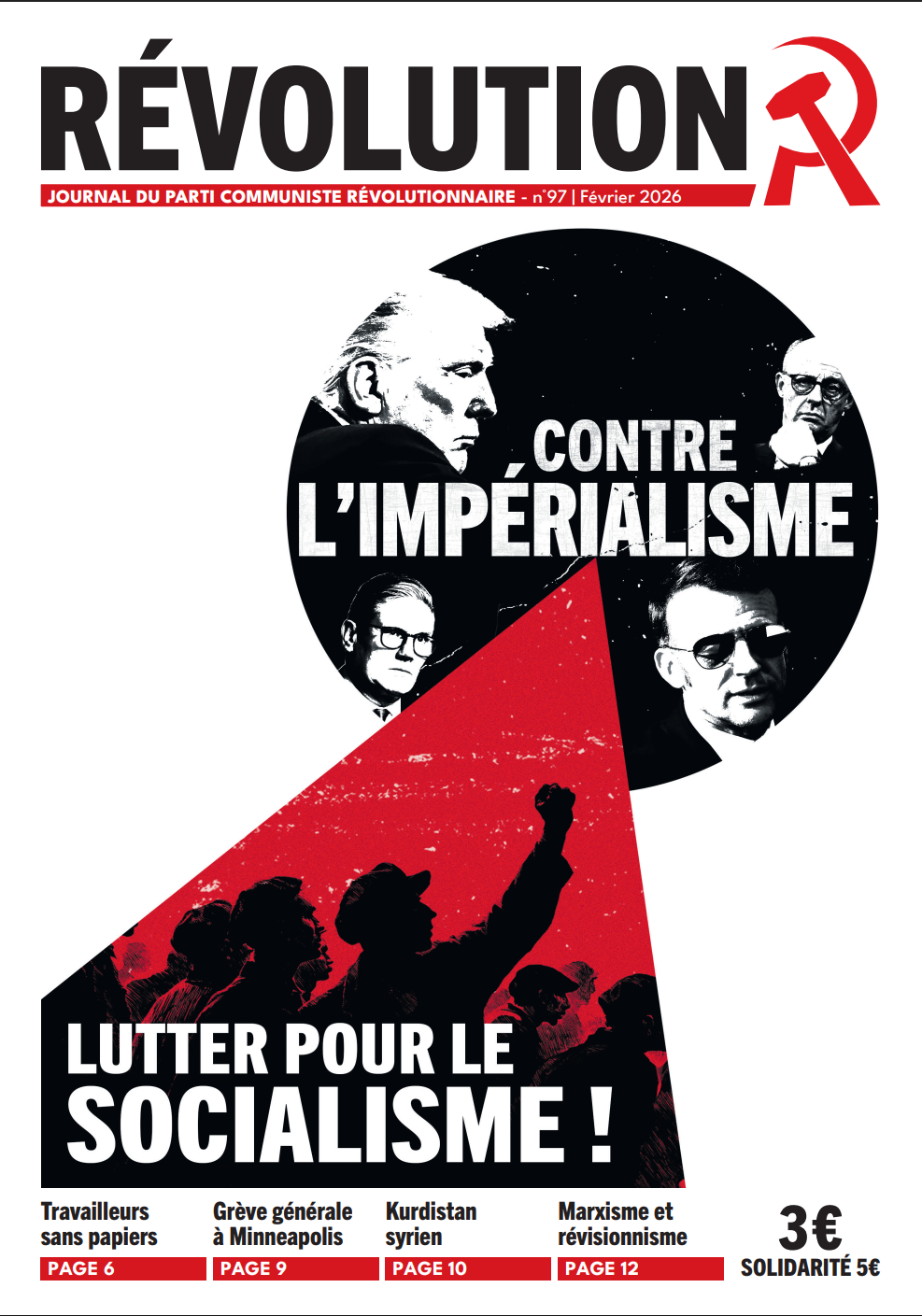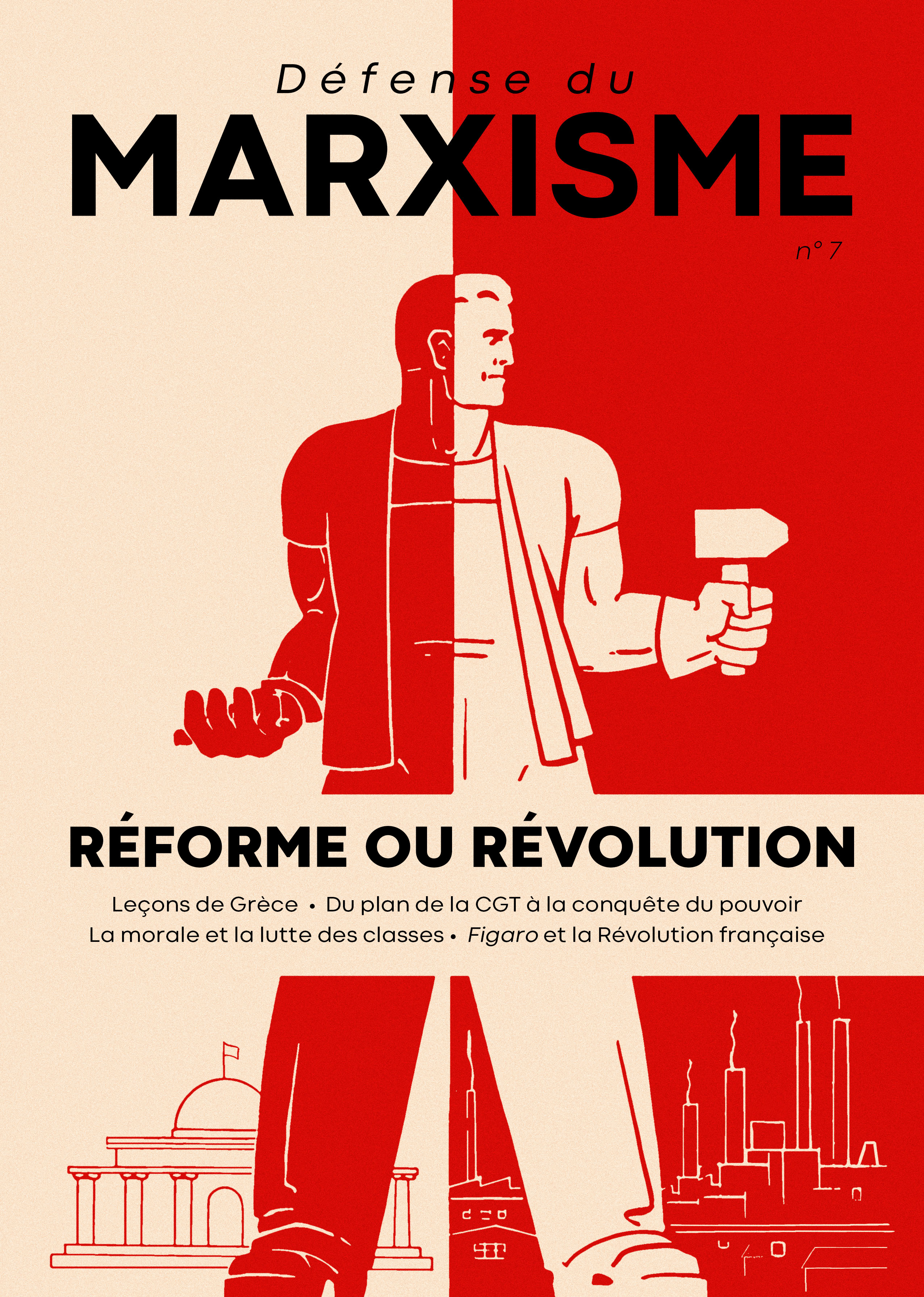Faust, la pièce de théâtre épique de Goethe, est l’une des œuvres d’art les plus importantes de tous les temps. Elle a intrigué et inspiré des générations à travers le monde ; il en sera de même pour les générations à venir. Dans cet article, Josh Holroyd explore certains des thèmes clés de ce chef-d’œuvre de la dialectique – notamment la nature humaine, la lutte pour le savoir et la relation entre le bien et le mal.
Il est des œuvres d’art et de littérature qui s’élèvent tellement au-dessus de l’existence quotidienne qu’elles transforment définitivement le paysage culturel. Elles structurent nos horizons d’une façon telle que les passants s’orientent vers leurs sommets, sans même connaître leurs noms.
Par exemple, plus de 1000 ans après la mort d’Homère, ses œuvres étaient la source d’une grande partie de la religion et de la culture gréco-romaine. Quant aux pièces de Shakespeare, elles ont définitivement façonné l’identité nationale anglaise.
De prime abord, cela peut sembler contredire la vision matérialiste de l’histoire. Après tout, l’art ne peut pas exister indépendamment de la société, tout comme l’esprit ne peut pas exister sans le corps. Dès lors, comment l’art peut-il avoir un impact sur la société ?
Au fond, l’art reflète la vie en lui tendant un miroir, en montrant aux gens ce qu’ils sont et ce qu’ils veulent devenir. Ce faisant, l’art peut réagir sur la société et influencer son histoire.
Les plus grandes œuvres d’art peuvent même faire plus que cela. Si les arts des époques révolues ne faisaient que refléter leur temps, l’art du monde antique n’aurait plus qu’un intérêt historique. Mais ce n’est manifestement pas le cas. Les plus grandes œuvres d’art continuent de trouver un écho, de nos jours, parce qu’elles offrent un aperçu de quelque chose d’universel, d’une vérité profonde, qui marque notre compréhension de ce que signifie le fait d’être humain.
Faust, la pièce de théâtre épique de Johann Wolfgang von Goethe, doit être classée dans la catégorie de ces grandes œuvres d’art. L’influence de Goethe sur la culture allemande a été comparée à celle de Shakespeare sur la culture anglaise. De toutes ses œuvres, Faust est celle qui a eu l’effet le plus large et le plus durable. Dans le monde entier, elle a inspiré d’innombrables œuvres d’art dans les domaines de la littérature, de la musique, de la peinture et du cinéma.
Il est impossible d’aborder ici tout ce que contient cette pièce réputée « injouable ». Mais nous serions satisfaits si l’exploration de quelques-unes des plus puissantes idées contenues dans ce chef-d’œuvre pouvait encourager des lecteurs à se plonger dans le texte lui-même.
Tempête et passion
Goethe est né en août 1749 à Francfort, alors « ville libre d’Empire » du Saint-Empire romain germanique. Il a grandi dans un monde en pleine mutation.
L’Allemagne se réveillait du sombre sommeil qui avait suivi les carnages de la Guerre des Paysans allemands (1524-25) et de la guerre de Trente Ans (1618-48). A travers le monde germanophone, une intelligentsia en plein essor cherchait avidement à s’inspirer des travaux scientifiques, historiques et artistiques d’autres nations et d’autres époques. Comme l’écrit Goethe dans son autobiographie, Poésie et vérité, souvenirs de ma vie :
« L’Allemand, que deux siècles d’une situation malheureuse et tumultuaire avaient rendu sauvage, allait à l’école chez les Français pour apprendre la politesse, et chez les Romains pour s’exprimer dignement. » [1]
A l’époque de l’enfance de Goethe, la littérature française était particulièrement influente, et cette prédominance de la culture française en Allemagne impliquait la prédominance du théâtre « néoclassique » français. Cependant, c’est cette influence même qui a provoqué une réaction d’opposition chez certains artistes allemands.
Le classicisme français avait produit des titans du théâtre tels que Corneille, Molière et Racine ; mais à la fin du XVIIIe siècle, il était devenu statique, formaliste et strictement réglementé par l’establishment culturel que représentait l’Académie française.
Celle-ci décrétait que pour être considérées comme du « bon » théâtre, les pièces devaient comporter cinq actes en alexandrins ; la tragédie et la comédie ne devaient pas être mélangées ; les « trois unités » d’action, de temps et de lieu devaient être strictement respectées ; la pièce devait être « vraisemblable », et donc ne pas inclure de personnages mythiques ou magiques tels que des fantômes, des fées, etc. ; et elle devait chercher à éclairer le public sur la bonne morale et la bienséance : à la fin, le pécheur devait toujours être puni et le juste toujours récompensé.
Une nouvelle génération d’écrivains allemands s’est rebellée contre ce régime éculé du « bon goût ». Ils aspiraient à quelque chose de nouveau, de naturel et, surtout, qui leur soit propre.
Le philosophe-poète Johann Gottfried Herder était une figure importante de ce nouveau mouvement littéraire. Parmi de nombreuses autres idées profondes et influentes, Herder mettait l’accent sur les sentiments naturels et les contes populaires plutôt que sur les règles formelles de composition. Il a eu une grande influence sur Goethe, qui le rencontra à Strasbourg, en 1770, alors qu’il étudiait le droit.
Publié en 1774, le premier roman de Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, reflétait l’impatience qui se développait dans la société – et rendit son auteur célèbre. L’histoire de cet individu brillant et torturé qui met fin à ses jours a touché une corde si sensible, en Allemagne, qu’elle inspira des centaines de suicides similaires.
Cette œuvre, et d’autres du même genre, ont fini par caractériser un nouveau mouvement dans la littérature allemande, connu sous le nom de Sturm und Drang (« tempête et passion »). Ce qui est significatif à propos de Werther et d’autres œuvres de ce type, c’est que leurs « tempêtes » et leurs « passions » ne sont pas les guerres et les révolutions ; elles portent essentiellement sur les tumultes internes, psychologiques, des individus.
Cela fit écho à l’angoisse adolescente de la bourgeoisie allemande – très éduquée, enfiévrée par des rêves héroïques, mais économiquement et politiquement exclue, toujours accrochée aux basques de l’ancienne aristocratie féodale. Goethe lui-même écrira à propos de la classe moyenne allemande :
« Il s’agit ici de gens dont la vie est gâchée par le manque de choses à faire... » [2]
Faust porte toutes les marques de ce style. Dans cette œuvre, Goethe prend plaisir à transgresser toutes les règles du théâtre « classique ». La comédie et la tragédie se mêlent sans cesse et, souvent, coïncident. La pièce saute entre des lieux, des époques et des intrigues complètement différentes, sans même prétendre à une narration unique et cohérente. Quant à sa contribution à l’édification morale du public, cette question fait encore aujourd’hui l’objet de vifs débats.
Le classicisme de Weimar
L’effort subjectif et la prééminence du sentiment sur le raisonnement formel et abstrait sont de puissants thèmes tout au long de l’œuvre, et en particulier dans sa première partie, tout comme la découverte du divin dans la beauté de la nature. Par ces thèmes, Faust s’inscrit très nettement dans le mouvement romantique, qui a conquis toute l’Europe dans la foulée de la Révolution française.
Pourtant, Goethe a très tôt désavoué le romantisme. Il méprisait son subjectivisme et son apologie du médiévalisme, qui s’est particulièrement développé parmi les adeptes allemands du mouvement. Au lieu de cela, Goethe a créé son propre genre, le « classicisme de Weimar », avec son ami proche et collaborateur, le poète Friedrich Schiller.
Dans le classicisme de Weimar, Goethe a tenté de marier le dynamisme et l’individualisme du romantisme avec la ferme croyance en la vérité objective qui caractérise l’art classique, mais en débarrassant ce dernier des limites formelles et artificielles dans lesquelles il s’était enfermé. Faust est l’œuvre phare de ce genre, dans lequel la tension entre l’effort individuel, subjectif, et les limites tangibles de la réalité objective, externe, occupe le devant de la scène.
Véritablement épique, tant par son ampleur que par son sujet, Faust s’étend sur un total de plus de 12 000 vers, qui passent d’un mètre à l’autre et d’une rime à l’autre, et qui fourmillent de références à la mythologie classique, à la Bible, ainsi qu’à d’importants débats scientifiques et philosophiques de l’époque. Le poète allemand Heinrich Heine ne s’y est pas trompé en affirmant que Faust était « aussi vaste [dans sa portée] que la Bible ». [3]
La longueur de la pièce, et parfois la structure déconcertante de son intrigue, lui ont valu d’être généralement considérée comme impossible à jouer sur scène, du moins dans son intégralité. En outre, les lecteurs modernes ont souvent été intimidés par le symbolisme riche et complexe de l’œuvre, en particulier dans sa deuxième partie. Mais il n’y a aucune raison de se décourager.
La plupart des éditions fournissent d’utiles notes interprétatives, qui permettent de comprendre un peu les références culturelles et philosophiques de Goethe. Mais le lecteur peut également ignorer ces notes et, se plongeant dans ce monde magique, tirer ses propres conclusions en suivant Faust dans ses aventures. Il y a assez de choses belles, qui font réfléchir et rire, pour maintenir l’intérêt du lecteur.
Pour Goethe, il ne s’agit pas d’illustrer une idée unique et étroite, mais « une vie riche, hétéroclite et extrêmement variée ». Si la réalité ne se conforme pas bien à un schéma abstrait, pourquoi l’art s’y conformerait-il ? Le Tout reste toujours « incommensurable », comme l’a dit Goethe lors d’une conversation – ajoutant que, comme un problème non résolu, cela « pousse constamment l’humanité à l’étudier encore et encore ». [4]
Faust se présente également au lecteur comme un problème non résolu, un univers infini contenu dans un nombre fini de pages, qui pousse le lecteur à une lecture et une étude répétées, pour son plus grand bénéfice.
Une tragédie humaine universelle
A l’époque de Goethe, l’histoire de Faust était déjà une légende bien connue. Dans les années 1570, plusieurs légendes circulant au sujet d’un mystérieux personnage appelé « Faustus » furent rassemblées et publiées dans un volume qui, en 1600, avait déjà été traduit dans plusieurs autres langues européennes.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’histoire de Faustus était toujours racontée sous un angle moral. La Tragique Histoire du docteur Faust, de Christopher Marlowe, en est un exemple célèbre. Dans le récit de Marlowe, un érudit impatient se tourne vers la magie et réussit à faire apparaître un diable, « Méphistophélès », avec lequel il conclut un marché : Méphistophélès servira Faustus pendant 24 ans, après quoi son âme sera réclamée par Lucifer. Après une série d’aventures magiques, Faust est finalement emmené par des démons alors qu’il se repent et implore la miséricorde de Dieu.
Goethe a découvert cette histoire lorsque, encore enfant, il l’a vue jouée dans un théâtre de marionnettes. Très tôt, il a commencé à développer l’idée d’une pièce basée sur la légende de Faustus. Mais le traitement de Goethe diffère nettement de celui de ses prédécesseurs.
Goethe commença à écrire Faust en 1771, et n’en achèvera la dernière partie que quelques mois avant sa mort, en 1832. Pendant ces 61 années, l’Europe a connu une révolution profonde et irréversible dans tous les domaines de la vie sociale – une révolution philosophique, politique, artistique, scientifique et économique. Goethe a participé activement – mais pas toujours avec enthousiasme – à chacune de ces révolutions, et Faust contient en définitive ses réflexions sur tous ces sujets, ce qui en fait véritablement l’œuvre de son temps.
Dans ce contexte, et sous l’influence de Schiller en particulier, Goethe va transformer la pièce de moralité chrétienne en une tragédie humaine universelle. Le personnage de Faust n’est plus une exception maléfique qui sert d’avertissement au reste de la société. Au contraire : entre les mains de Goethe, il devient un représentant idéalisé de l’humanité en général, et sa quête une allégorie de l’expérience humaine.
Goethe lui-même a caractérisé ainsi le principe central et moteur du personnage de Faust : « L’effort idéal pour parvenir à influencer et à ressentir la nature tout entière ». [5]
En quoi cela résume-t-il la condition humaine ? Ce qui ressort clairement de la pièce, c’est que sous ce langage philosophique se cache le problème de la conscience et de la relation entre nos idées subjectives et le monde objectif à l’extérieur de nos têtes.
Les êtres humains font tout autant partie du monde naturel que n’importe quelle autre chose. Comme tous les animaux, nous interagissons avec le reste de la nature afin de continuer à vivre et de produire les générations futures. Mais à la différence des autres animaux, nous créons des idées sur le monde et la place que nous y occupons. Sur la base de ces idées, nous développons des espoirs et des rêves qui, trop souvent, n’ont que peu ou pas de rapport avec l’état réel des choses.
Nous essayons ainsi de « sauter » par-dessus le monde ; nous nous efforçons obstinément de transformer nos conditions tant au plan individuel que social, au mépris des limites qui nous sont imposées par des autorités extérieures, y compris les lois de la nature et de la société.
Notre acharnement sans limite nous mène toujours plus loin, ce qui nous conduit nécessairement à des moments de bonheur et de gloire, mais aussi d’échec et de désespoir. Pour Goethe, il s’agit là de la tragédie inhérente à toute existence humaine : c’est
« le point secret, qu’aucun philosophe n’a encore vu et déterminé, où l’idiosyncrasie de notre ego, la prétendue liberté de notre volonté, se heurte au cours nécessaire de l’ensemble ». [6]
Mais ce conflit constant entre la volonté subjective et la nécessité objective n’est pas seulement présent dans nos relations avec le monde extérieur : il est aussi présent à l’intérieur de chacun de nous, dans la relation entre l’esprit et le corps, la pensée et l’être.
« Deux âmes, hélas ! se partagent mon sein », se lamente Faust, « et chacune d’elles veut se séparer de l’autre : l’une, ardente d’amour, s’attache au monde par le moyen des organes du corps ; un mouvement surnaturel entraîne l’autre loin des ténèbres, vers les hautes demeures de nos aïeux ! » [7]
Tout comme nos idées nous poussent à sauter par-dessus le monde, nous essayons de nous dépasser nous-mêmes, en niant et en réprimant le côté naturel et « bestial » de notre nature, dans la poursuite de quelque chose de plus élevé. Du fait de cette lutte interne constante, nous passons de la joie au chagrin, de la beauté à la répulsion, du bien au mal et vice versa, sans jamais échapper à notre difficile situation.
En d’autres termes, la pièce de Goethe pose la question suivante : « Pouvons-nous vraiment connaître le monde et maîtriser notre condition ? Pourrons-nous un jour nous débarrasser de l’erreur et du péché ? » Les philosophes ne sont pas les seuls à réfléchir à ces questions ; nous nous les posons nous-mêmes à notre manière, chaque jour.
Théorie et pratique
Conformément à la légende originale de Faustus, notre Faust entame sa quête de savoir dans l’univers miteux de l’érudit médiéval. Nous le rencontrons pour la première fois dans un cabinet de travail poussiéreux, tapissé de livres, au cœur de la nuit. Pendant dix ans, il a étudié toutes les disciplines théoriques disponibles pour un érudit du Moyen-Âge : Philosophie, Jurisprudence, Médecine et Théologie. [8]
Le but de Faust n’est pas simplement d’accumuler un tas de « faits » arides. Il cherche plutôt à obtenir un aperçu de quelque chose de plus profond : les lois fondamentales de la nature, « tout ce que le monde cache en lui-même », selon ses mots. Goethe introduit ici un problème sur lequel les philosophes s’échinent depuis des milliers d’années.
Tout ce qui nous entoure est en perpétuel changement, inconstant et imparfait, y compris nous-mêmes. Le monde social des êtres humains est pire encore. Et au milieu de toute cette cruauté, de ces contradictions et de cette douleur, les êtres humains ont toujours cherché quelque chose de vrai : des lois ou des principes qui révèlent l’essence des choses derrière le monde trompeur des apparences.
Cette recherche de la vérité a pris de nombreuses formes au cours de l’histoire de l’humanité, en fonction des conditions de l’époque : la magie, la religion, la philosophie et la science en sont toutes issues, chacune représentant un stade plus élevé de notre développement social.
La naissance de la philosophie, dans la Grèce antique, a été un événement révolutionnaire dans l’histoire de la pensée humaine. Pour la première fois, on affirmait avec audace que l’on pouvait comprendre les lois de la nature sans passer par le truchement d’esprits, de sorts ou d’interventions divines.
Pendant des millénaires, les philosophes, de Platon à Descartes, ont insisté sur la capacité des êtres humains – ou au moins de certains d’entre eux – à pénétrer le « voile de l’expérience » et à percevoir le monde « réel » en utilisant la pensée pure et la déduction logique.
Cette philosophie « métaphysique », qui signifie « au-dessus » ou « au-delà » du monde physique, est devenue extrêmement influente à l’époque des « lumières » européennes, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Des progrès gigantesques en mathématiques et en sciences naturelles ont inspiré une confiance énorme dans les capacités de l’esprit humain à saisir les lois objectives de la matière. Mais paradoxalement, plus les sciences se développaient, plus les philosophes étaient assaillis de doutes.
Si l’essence des choses n’est perçue que par l’esprit, comment peut-on garantir qu’elles ont une existence réelle et objective en dehors de notre esprit ?
Prenons l’exemple suivant : nous regardons le soleil se lever à l’est ; la lumière illumine la scène devant nous ; nous ressentons une chaleur nouvelle. Tout cela, raisonnons-nous, est lié : à mesure que la terre tourne, l’endroit où nous nous trouvons se rapproche du soleil, et lorsque ses rayons nous atteignent, nous les percevons comme de la lumière et de la chaleur. Mais comment pouvons-nous être sûrs que tout cela est effectivement vrai ? Comment pouvons-nous être sûrs qu’il existe vraiment un « soleil » ?
Au XVIIIe siècle, une série de philosophes « sceptiques » ont répondu fermement que nous ne pouvions pas l’être. L’évêque Berkeley, puis David Hume, ont expliqué que, dans la mesure où nous ne pouvons acquérir la connaissance du monde que par le biais de nos sens, la seule façon d’essayer de vérifier nos idées relatives aux phénomènes naturels est d’utiliser ces mêmes sens. Par conséquent, nous ne pouvons jamais connaître que nos propres expériences subjectives. Bref, nous voilà piégés dans nos petits mondes, dans l’ignorance totale de ce qui se trouve au-delà, si tant est qu’il y ait quelque chose.
Influencé par Hume, le philosophe allemand Emmanuel Kant est arrivé à une conclusion similaire. Il énonçait qu’en toute logique il doit y avoir quelque chose là-dehors, sinon nous n’aurions aucune sensation ; mais nous ne pourrons jamais vraiment savoir quoi que ce soit à propos de ce quelque chose. Tout ce que nous pouvons faire, c’est organiser nos expériences d’une manière qui a du sens pour nous, en utilisant des « formes » et des catégories innées, telles que l’espace et le temps.
Après avoir promis la découverte de vérités universelles et éternelles, la philosophie s’est donc transformée en son contraire : elle a nié la possibilité d’une quelconque vérité.
Faust résume cette crise lorsqu’il s’exclame :
« Je promène çà et là mes élèves par le nez. – Et je vois bien que nous ne pouvons rien connaître !… ». [9]
Faust désespère. Il ne voit aucune issue au piège métaphysique dans lequel il est tombé. Pour son bien, et pour le bien de l’intrigue, il est vital qu’il trouve un moyen d’en sortir.
C’est précisément ce qu’a tenté de faire une nouvelle génération de philosophes allemands à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ils finiront par être rangés dans la catégorie des « idéalistes allemands ». Johann Gottlieb Fichte, qui travaillait avec Goethe à l’université d’Iéna, a « résolu » le problème en poussant les idées de Kant jusqu’à leur conclusion logique : nous pouvons connaître le monde parce que nous – ou plus exactement je – sommes tout ce qui existe. Le monde est quelque chose que notre conscience crée.
L’idéalisme subjectif de Fichte a suscité beaucoup d’enthousiasme, car il correspondait à la passion romantique pour l’individu qui enflait à l’époque au sein de l’intelligentsia allemande. Mais Goethe n’a jamais été convaincu.
À travers Faust, il donne une réponse différente, qui aura des implications révolutionnaires pour toute la philosophie :
« Au commencement était l’Action ! » [10]
Goethe était un grand admirateur du philosophe hollandais Baruch Spinoza, qu’il disait lire « comme ma prière du soir ». Et comme Spinoza, il croyait fermement qu’il n’y a rien en dehors de la nature, ou « au-dessus » d’elle. L’essence des choses se trouve dans le monde des choses.
La connaissance du monde ne peut être trouvée par l’introspection, en nous retirant du monde même que nous cherchons à connaître. Elle ne peut pas davantage être trouvée en le découpant en parties et en décrivant chacune d’entre elles de manière isolée. C’était précisément l’erreur du matérialisme « mécaniste » qui avait émergé au cours du XVIIIe siècle :
« Qui veut reconnaître et détruire un être vivant commence par en chasser l’âme : alors, il en a entre les mains toutes les parties ; mais, hélas ! que manque-t-il ? Rien que le lien intellectuel. » [11]
Les matérialistes de l’époque de Goethe considéraient la matière comme quelque chose de statique, de fixe – quelque chose de mort. Mais c’est précisément pour cette raison qu’ils ne pouvaient pas expliquer la source du mouvement, de la vie et de la conscience. C’est cet aspect de la réalité que les idéalistes allemands ont développé dans leur philosophie. Le problème est qu’ils sont partis de la pensée, de l’esprit, au lieu de partir de la matière elle-même.
Pour Goethe, l’« essence » ou le « principe organisateur » d’une chose doit être recherché dans sa vie : le cours entier de son développement et la totalité de ses interrelations. Cela peut être compris – ou du moins entrevu – par l’expérience. Mais pas seulement l’expérience en tant que réception passive de sensations : la connaissance de notre monde vivant ne peut être trouvée qu’en étant une partie vivante de celui-ci, par le biais d’une activité réelle et concrète :
« Toute théorie est sèche, et l’arbre précieux de la vie est fleuri. » [12]
Même si c’est sous une forme poétique, Goethe franchit ici une étape qui dépasse non seulement Spinoza, mais aussi toute la philosophie de son époque. Avec cette idée brillante et inspirante, il a également contribué à ouvrir la voie à la philosophie matérialiste et dialectique de Marx et Engels.
Dans ses Thèses sur Feuerbach, des notes philosophiques brèves mais novatrices, le jeune Marx écrivait que ni le matérialisme mécanique, ni l’idéalisme ne conçoivent la réalité en termes d’« activité réelle, concrète, comme telle ». Il poursuit :
« La question de savoir s’il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n’est pas une question théorique, mais une question pratique. C’est dans la pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité, c’est-à-dire la réalité, et la puissance de sa pensée, dans ce monde et pour notre temps. La discussion sur la réalité ou l’irréalité d’une pensée qui s’isole de la pratique, est purement scolastique. »
Avec l’invocation audacieuse de « l’Acte », Faust fait son premier pas de la théorie vers la pratique, de la contemplation stérile vers la vie active et pleine. Le reste de la pièce conduira Faust à travers tout ce que la vie humaine a à offrir : romance, art, richesse, politique, guerre – et plus encore.
Sympathie pour le diable
Ayant décidé de se lancer dans une vie d’action, Faust est immédiatement confronté au démon Méphistophélès (souvent abrégé en « Méphisto »), qui accompagnera Faust pendant la quasi-totalité du drame qui suivra.
A la question de Faust : « Quel est ton nom ? », Méphisto répond :
« Je suis l’esprit qui toujours nie ; et c’est avec justice : car tout ce qui existe est digne d’être détruit ».
Le seul but de Méphisto est de tout détruire. Symbole de « l’esprit de négation », il est le pendant parfait de l’insatiable élan créateur de Faust. Mais Méphisto est constamment frustré dans sa quête d’anéantissement de toute existence. La terre et la mer subsistent malgré toutes les forces de destruction qui leur sont opposées. Quant à la vie :
« Combien n’en ai-je pas déjà enterrés ! Et toujours circule un sang frais et nouveau. »
Vie et mort, création et destruction, être et néant, chacun passe de l’un à l’autre dans une union constante, qui ne mène ni au néant absolu, ni à l’être « pur » et sans limites.
Pour Goethe, c’est cette confrontation constante de forces opposées (cette « polarité ») qui produit le développement. L’existence est un état constant de naissance et de disparition, de « devenir ». Et ce devenir est une évolution vers des formes de plus en plus élevées.
Cette philosophie magnifiquement dialectique imprègne l’ensemble de Faust. Il n’est donc pas surprenant que le grand dialecticien Hegel ait écrit à Goethe :
« Lorsque j’examine mon développement intellectuel, je vous y trouve partout mêlé et je pourrais bien me considérer comme l’un de vos fils ». [13]
La relation de Faust et Méphisto offre un reflet frappant de ce développement dialectique qui se déroule au sein de la double nature de Faust lui-même. Méphisto tente constamment d’entraîner Faust dans une vie d’« insignifiance superficielle ». D’une part, il le tente avec des plaisirs terrestres ; d’autre part, il ridiculise toutes ses prétentions élevées, et souvent d’une manière qui contient plus qu’une lueur de vérité.
Mais même lorsqu’il cède à la tentation, Faust ne peut s’empêcher de chercher quelque chose au-delà. A chaque pas, il passe de l’erreur à la vérité et de la vérité à l’erreur. Mais il n’est jamais ramené au point de départ ; il apprend. Après chaque désastre, il est horrifié par les conséquences de ses actes et tente de corriger son erreur. Reprenant la vérité partielle ainsi acquise, il la pousse – à son tour – au-delà de ses limites et la transforme en une nouvelle erreur, mais à un niveau de compréhension plus élevé, ce qui est crucial.
Ce qui est vrai de Faust peut également être dit de l’humanité dans son ensemble. C’est de ce point de vue qu’Engels a décrit l’histoire de la science, de manière amusante mais pleinement justifiée, comme le remplacement de l’idiotie « par une stupidité nouvelle, mais de moins en moins absurde ». [14]
Cela a des implications révolutionnaires, non seulement pour notre philosophie de la connaissance, mais aussi pour la morale. Le bien ne consiste pas simplement à éviter tout mal. Comme l’affirme « le Seigneur » dans le « Prologue dans le ciel » de la pièce : « Tout homme qui marche peut s’égarer. »
Si pécher, c’est s’égarer, alors éviter tout péché, c’est mettre fin à tout effort. Mais vivre, c’est s’efforcer.
Tout comme la connaissance se développe à travers l’erreur, le bien se développe à travers le péché, et vice versa. Méphisto se décrit lui-même comme « une partie de cette force qui tantôt veut le mal et tantôt fait le bien. » Nous pouvons le constater dès le début. Après tout, c’est Méphisto qui conduit finalement Faust hors de son cabinet de travail et dans le monde. Ainsi, au lieu de le condamner, Méphisto le sauve.
Hegel a avancé une idée similaire, peut-être sous l’influence de Goethe. Mais il la développera davantage en l’appliquant encore plus explicitement à l’histoire de la société humaine. Comme l’explique Engels :
« Chez Hegel, le mal est la forme sous laquelle se présente la force motrice du développement historique. Et, à vrai dire, cette phrase a ce double sens que, d’une part, chaque nouveau progrès apparaît nécessairement comme un crime contre quelque chose de sacré, comme une rébellion contre l’ancien état de choses en voie de dépérissement, mais sanctifié par l’habitude, et d’autre part, que, depuis l’apparition des antagonismes de classes, ce sont précisément les passions mauvaises des hommes, la convoitise et le désir de domination qui sont devenus les leviers du développement historique, ce dont l’histoire du féodalisme et de la bourgeoisie, par exemple, n’est qu’une preuve continue. » [15]
Tout au long de Faust, nous voyons des exemples de ce processus à travers lequel le bien produit le mal, et le mal produit le bien.
La société
Lorsqu’enfin le diable est parvenu à faire sortir Faust de son cabinet de travail, Goethe dresse un riche portrait de la société. Bien que la pièce se déroule principalement au XVIe siècle, elle se livre à une critique dévastatrice de la société à l’époque de Goethe.
Le Saint-Empire romain germanique tombe en morceaux ; l’empereur lui-même est un débauché déconnecté de la réalité. Un empereur rival apparaît – référence à Napoléon Bonaparte – et le vieil empereur ne parvient à conserver son trône que grâce à des forces démoniaques. Finalement, l’ordre ancien est restauré, mais il est encore plus faible et plus corrompu qu’auparavant. C’est ainsi que Goethe considérait les monarchies européennes restaurées après la défaite de Napoléon en 1814.
Quant à la puissante institution religieuse, l’Eglise, elle est bigote et cupide. « La nature est le péché ; l’esprit est le diable en personne », prévient le chancelier de l’Empire. Mais les terres et les dîmes ? C’est une autre histoire. Comme le commente Méphisto, sarcastique :
« L’Église a un bon estomac, elle a dévoré des pays entiers sans jamais cependant avoir d’indigestion. »
Goethe explore également la sphère économique de la société. Lorsqu’il achève la deuxième partie de sa pièce, en 1831, l’Allemagne connaît les premiers balbutiements de l’industrialisation. Dans la pièce, Faust s’efforce de mettre ses connaissances en pratique et de transformer la nature ; il veut faire émerger de la mer des terres vierges à l’aide d’un système de digues.
Mais Goethe ne se faisait pas d’illusions sur le nouvel ordre capitaliste qui commençait à s’installer. Le commerce mondial est dépeint comme un pillage et une piraterie :
« la guerre, le commerce et la piraterie [sont] une inséparable trinité. » [16]
Cela fait évidemment penser au pillage et à la colonisation du monde par les nations capitalistes émergentes d’Europe. Comme Marx l’écrira plus tard dans Le Capital :
« ... le capital y arrive suant le sang et la boue par tous les pores. » [17]
La famille
La critique la plus acerbe de Goethe, sans doute, est celle qui frappe le prétendu fondement de la civilisation : le foyer familial.
La « tragédie de Gretchen », qui constitue la partie la plus importante du drame dans la première partie de Faust, contient certaines des scènes les plus dévastatrices jamais écrites en vers ou en prose. Un critique a décrit Gretchen comme « le personnage féminin le plus puissant de la littérature allemande ». [18] Marx semble avoir partagé cette appréciation, puisqu’il a cité Gretchen comme son « héroïne » en 1865. [19]
Il est intéressant de noter que, contrairement à la majeure partie de la pièce, la tragédie de Gretchen n’a aucun lien avec la légende originale de Faustus, quelle que soit sa version. Il s’agit d’un ajout entièrement nouveau de Goethe, tiré de la vie réelle. Le 14 janvier 1772, une jeune femme du nom de Susanna Margaretha Brandt a été exécutée publiquement, à Francfort, pour le crime d’infanticide. Goethe a assisté à l’exécution et certains détails de l’affaire Brandt se sont retrouvés dans Faust.
Goethe a clairement introduit la séduction de Gretchen par Faust, et ses conséquences catastrophiques, parce qu’il estimait qu’elle disait quelque chose qui devait être dit, et que sa tragédie humaine universelle serait incomplète sans elle.
Jusqu’à l’apparition de Gretchen, le conflit entre l’aspiration subjective et la limite objective ne s’exprime que dans le cadre de l’aspiration – essentiellement intellectuelle – de Faust à la connaissance. Avec Gretchen, nous découvrons une aspiration très différente, mais tout aussi humaine.
Au fur et à mesure que Faust fait la connaissance de Gretchen, nous découvrons sa modeste vie petite-bourgeoise, avec son fardeau de tâches ménagères – « jour après jour, la même chose » – et surtout son étroitesse. Le monde de Gretchen se compose d’une petite maison et d’un jardin, de la place du marché et du confessionnal, où elle « va à confesse pour un rien ». [20]
« Dans ce cachot, que de félicité ! », commente Faust, imaginant naïvement un foyer heureux et plein d’enfants. En réalité, Gretchen mène une existence solitaire, son père étant mort et son frère parti au combat. Une petite sœur, que Gretchen a nourrie et élevée elle-même, est morte jeune. « Cette enfant me donnait bien du mal », dit Gretchen en passant, « cependant j’en prenais volontiers la peine ».
L’amour que Gretchen porte en elle est trop grand pour les limites qui lui sont imposées. L’arrivée de Faust lui montre un amour et une vie au-delà de son enfermement domestique, et réveille ses propres aspirations. A sa manière, elle est l’égale de Faust. Elle n’a peut-être pas son vocabulaire philosophique, mais cela n’a aucune importance.
En fin de compte, c’est cette aspiration même qui condamne Gretchen, non parce qu’elle est intrinsèquement mauvaise ou pécheresse, mais parce qu’elle se heurte violemment aux traditions et aux préjugés de la société dans laquelle elle vit. Après être tombée enceinte de Faust, Gretchen entend les ragots malveillants de jeunes filles jalouses, qui se réjouissent à l’idée d’humilier publiquement toute femme qui tente de se marier après avoir eu un enfant hors mariage.
Dès lors, la première partie de Faust s’achemine irrésistiblement vers son horrible dénouement. Mais ce qui est très significatif, c’est que la source de toute l’horreur de la pièce n’a rien à voir avec ses diverses sorcières, ses diables et autres créatures surnaturelles. Elle provient des « bonnes gens » et des élites moralisatrices, qui jugent Gretchen et toutes les femmes, en maintenant un règne de terreur qui détruit l’esprit pour asservir le corps. Comme le dit Méphisto de façon glaçante : « Elle n’est pas la première ».
Évolution et révolution
Malgré sa critique acerbe de la société qui l’entoure, les idées politiques de Goethe sont loin d’être révolutionnaires. Par exemple, il a participé à l’invasion de la France révolutionnaire par le roi de Prusse et ses alliés. Il estimait que « rien n’est plus repoussant que la majorité ». [21]
Goethe était un penseur profondément dialectique et croyait fermement à l’évolution, non seulement de la vie mais de tout ce qui existe dans l’univers. Cependant, il concevait l’évolution comme un processus graduel ; il souscrivait sans réserve au principe selon lequel « la nature ne connaît pas de bonds ». C’est pourquoi, selon lui, l’humanité devrait s’efforcer d’imiter le cours naturel de la sédimentation graduelle en réduisant au minimum ses bonds révolutionnaires.
Ce faisant, bien sûr, Goethe se trompait – à la fois sur l’histoire et sur la nature. Comme l’a expliqué Hegel, les « bonds » et les révolutions sont inhérents à tout développement. Quant aux révolutions sociales, elles ne sont pas l’éruption d’une masse idiote ; elles sont l’effort collectif de millions de personnes pour surmonter les entraves qui leur sont imposées – et pour transformer leurs conditions.
Le gradualisme de Goethe n’était pas une exception : c’était la vision dominante de la bourgeoisie de l’époque, après les traumatismes de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. Le gradualisme était particulièrement ancré dans la mentalité de la bourgeoisie allemande, qui se trouvait limitée par l’absolutisme et un retard semi-féodal, tout en restant complètement soumise à l’aristocratie et à la bureaucratie d’Etat.
Même un géant ne peut pas s’élever au-dessus de son temps : géant parmi les géants, Goethe n’a pas pu échapper à cette loi de l’histoire. On ne peut guère le lui reprocher.
Il faut être un génie pour tendre un miroir à un peuple – ou plus précisément à une classe – avec autant de beauté et de vérité. Si l’esprit réfléchissant possède lui-même les défauts de cette classe, cela contribue d’autant à la clarté du reflet. Mais Goethe ne s’est pas contenté de refléter son époque. Comme Aristote ou Marx, il a saisi quelque chose de plus profond, une vérité qui traverse les générations – passées et à venir. Et qu’y a-t-il de plus révolutionnaire que cela ?
Progrès
La conclusion de la pièce a suscité beaucoup de consternation et de débats. Elle est délibérément conçue pour soulever au moins autant de questions qu’elle n’apporte de réponses.
Faust mérite-t-il d’être sauvé ou condamné ? Méphisto parvient-il à étouffer les aspirations de Faust ? Et ce dernier arrive-t-il à pénétrer l’essence des choses, comme il le souhaitait au début de la pièce ?
A toutes ces questions, la réponse la plus brève et la plus simple est : « oui et non ».
Comme Goethe s’y attendait, la fin de Faust a suscité des critiques à droite et à gauche. Ceux qui croyaient fermement en la raison humaine ont été déconcertés par le recours appuyé de Goethe au symbolisme religieux et catholique, dans la scène finale. Mais les conservateurs religieux ont soupçonné – à juste titre – qu’on se moquait d’eux ; ils ont protesté avec indignation contre toute interprétation qui ne condamnait pas Faust comme un pécheur irrécupérable.
L’affaire ne s’est pas arrangée, depuis lors. Aujourd’hui, les critiques conservateurs tentent désespérément de transformer l’allégorie de Goethe en un discours misanthrope et fastidieux contre l’ambition et l’effort. Quant aux interprètes postmodernes, ils affirment que l’œuvre n’a jamais été censée signifier quoi que ce soit. Dans sa biographie de Goethe, par ailleurs très intéressante, Rüdiger Safranski affirme que « tout cela n’est qu’un jeu, une belle imposture contaminée par le néant ». [22]
Il n’est pas surprenant que l’actuelle intelligentsia littéraire ne sache pas quoi faire de Faust ; la bourgeoisie moderne n’en a absolument pas besoin.
En fin de compte, au cœur de Faust et de ses dernières scènes se trouve un message simple et optimiste sur la nature humaine et le progrès. C’est une ode à l’effort créatif incessant des êtres humains dans les domaines de l’amour, de l’art, de la science, de la transformation de la nature et de nous-mêmes, au cours d’une succession innombrable de générations.
Ce progrès est, par nature, contradictoire. Comme l’expliquait Goethe lui-même : dans « l’histoire du monde et l’histoire de l’humanité, chaque problème résolu en crée un nouveau à résoudre ». Nous allons tour à tour de l’erreur à la vérité et de la vérité à l’erreur ; mais en fin de compte, nous progressons vers une compréhension de plus en plus grande de l’univers et de la place que nous y occupons.
A la fin, Faust n’atteint pas la connaissance finale, absolue, et nous ne le pouvons pas plus ; aucune génération d’êtres humains ne saura jamais tout ce qu’il y a à savoir sur l’univers. La connaissance n’est pas un point final à atteindre, mais un processus, cet effort même qui constitue l’essence du personnage de Faust.
Plusieurs décennies après la publication de la deuxième partie de Faust, Engels a décrit cette contradiction – entre la connaissabilité fondamentale de l’univers et l’impossibilité, pour l’humanité, de le connaître complètement – comme « le principal levier de tout le progrès intellectuel », qui « se résout chaque jour et constamment dans l’évolution progressive sans fin de l’humanité ». [23]
Ce faisant, Engels donnait une expression parfaite du cœur poétique de la conclusion de Faust. Et c’est précisément ce que les critiques littéraires bourgeois, aujourd’hui, ne peuvent pas et ne veulent pas comprendre. Ils ont renoncé de longue date au grand levier du progrès. Il revient à la classe ouvrière de s’en saisir.
Mais qu’en est-il de Faust comme « tragédie humaine universelle » ? Avec une fin aussi optimiste, la pièce peut-elle être considérée comme une tragédie ? Il est vraiment trop tôt pour le dire ; l’histoire n’est pas encore terminée.
Quiconque cherche à en tirer une leçon morale devrait se tourner vers le « Prologue dans le ciel », au début de la pièce, et examiner attentivement les instructions du Seigneur :
« Que la puissance qui vit et opère éternellement vous retienne dans les douces barrières de l’amour, et sachez affermir dans vos pensées durables les tableaux vagues et changeants de la Création. »
Sortez. Agissez. Efforcez-vous de changer ce monde. Et utilisez vos connaissances acquises pour créer quelque chose qui durera pendant des générations.
« Au commencement était l’Action. »
[1] J. W. von Goethe, Vérité et poésie, Livre VII, Librairie de L. Hachette et Cie, Paris, 1862
[2] R. Safranski, Goethe : Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag, 2013, p. 155, Tr. Q Ghesquière-Dierickx
[3] H. Heine, Die romantische Schule, Hoffmann & Campe, 1836, livre I, Tr. Q Ghesquière-Dierickx
[4] J. W. von Goethe, Conversations of Goethe with Eckermann and Soret, George Bell and Sons, 1875, p. 507, Tr. Q Ghesquière-Dierickx
[5] J. W. von Goethe, C Hamlin (ed.), Faust, Norton, 2001, p. 515, tr. Q Ghesquière-Dierickx
[6] R. Safranski, Goethe : Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag, 2013, p. 100, tr. Q Ghesquière-Dierickx
[7] J. W. von Goethe, Faust, Garnier frères, 1877, tr. Gérard de Nerval
[8] ibid.
[9] J. W. von Goethe, Faust, Garnier frères, 1877, tr. Gérard de Nerval
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] G. W. F. Hegel, ‘Hegel to Goethe – April 24, 1825’, Hegel: The Letters, Indiana University Press, 1984, p. 709, Tr. Q Ghesquière-Dierickx
[14] F. Engels, Lettre à Conrad Schmidt, 27 octobre 1890.
[15] F. Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande.
[16] J.W. Goethe, Faust 2, Aux horizons de France, Paris, p.266.
[17] K. Marx, Le Capital, livre premier, chapitre XXXI
[18] C. Hamlin, Second Norton Critical Edition of Faust, 2001, tr. Q Ghesquière-Dierickx
[19] K. Marx, “Confession” de Karl Marx, in International Review of Social History, Vol. 1, 1956, p. 108
[20] J. W. von Goethe, Faust, Garnier frères, 1877, tr. Gérard de Nerval
[21] R. Safranski, Goethe : Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag, 2013, pg 623, tr. Q Ghesquière-Dierickx
[22] R. Safranski, Goethe : Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag, 2013, pg 623, tr. Q Ghesquière-Dierickx
[23] F. Engels, Anti-Dühring