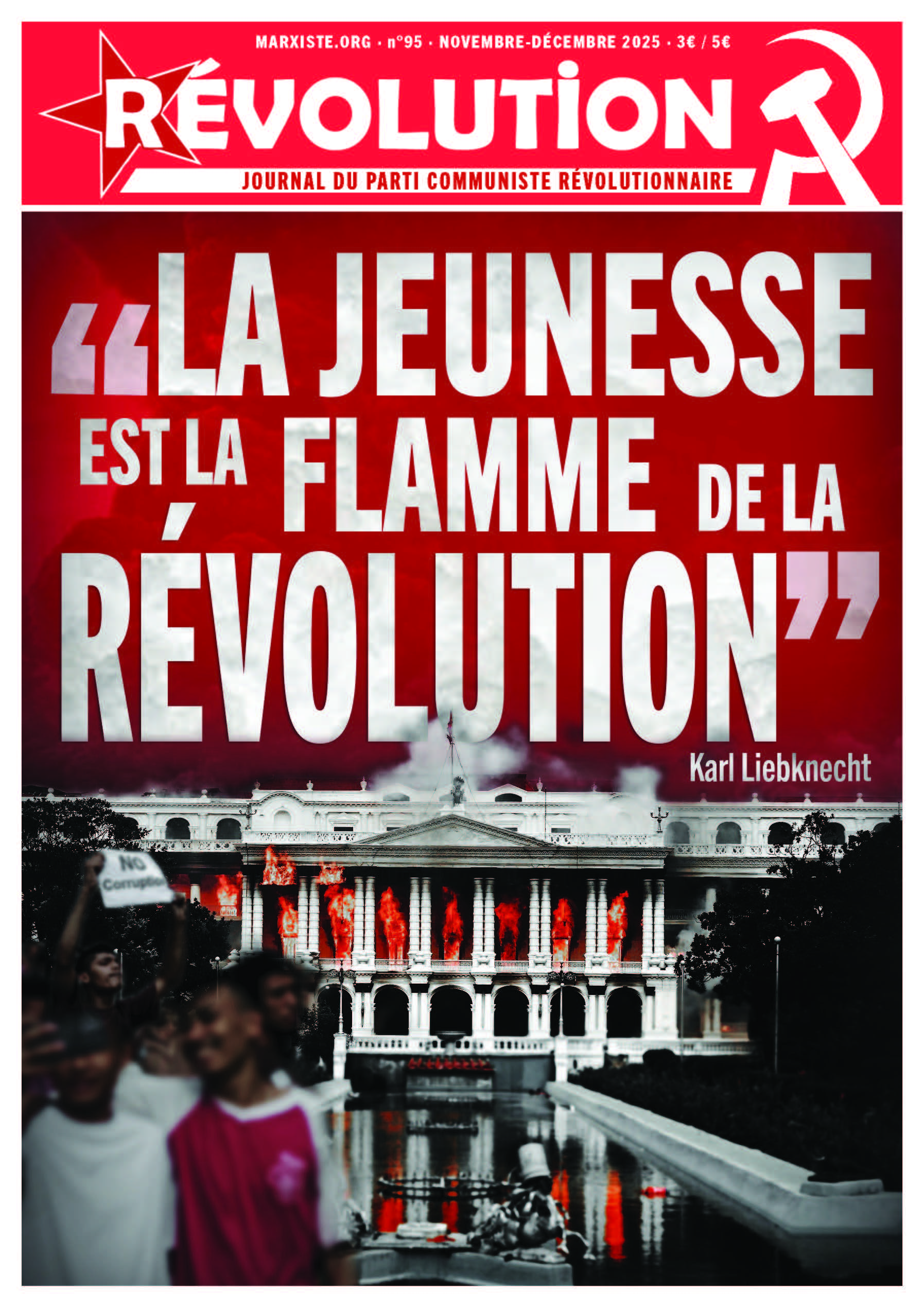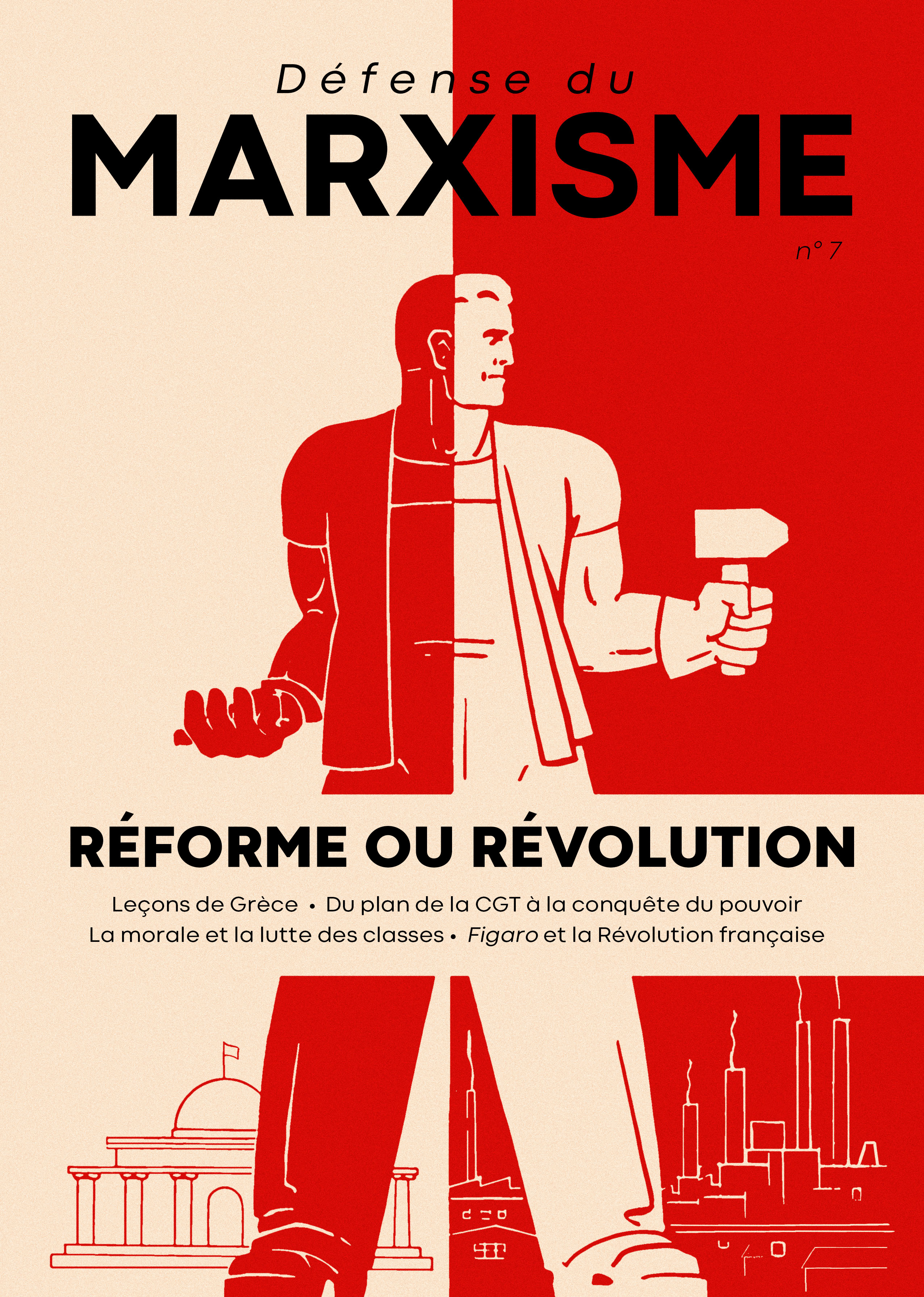Fin 2024, un puissant mouvement contre la vie chère secouait la Martinique. Par son ampleur et sa combativité, il a forcé le gouvernement à annoncer une baisse de 20 % sur 54 produits de première nécessité. Mais aucune garantie concrète n’était donnée quant à l’application de cette mesure, et les initiateurs de la mobilisation – le Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéennes (RPPRAC) – ont refusé de signer l’accord qu’ils ont, à juste titre, dénoncé comme une manœuvre du gouvernement.
Depuis, le mouvement s’est essoufflé, mais les causes de la colère restent intactes. Cet article revient sur les causes de la vie chère qui touche l’ensemble des territoires d’Outre-mer – et sur les tâches qui incombent au mouvement ouvrier pour y faire face.
Prix exorbitants et pauvreté massive
Pendant la mobilisation, de nombreuses vidéos montrant des Martiniquais filmant des étiquettes dans des magasins ont circulé sur les réseaux sociaux : 9 € les 250 g de beurre, 4 € pour deux tranches de jambon, 2 € le kilo de bananes produites localement… Ces prix ahurissants ne sont pas des cas isolés. On les retrouve dans tous les territoires d’Outre-mer.
D’après l’INSEE, les prix des denrées alimentaires y sont entre 37 % (à La Réunion) et 78 % (en Nouvelle-Calédonie) plus élevés qu’en métropole. Selon The Economist, Nouméa serait même la 20e ville la plus chère au monde, devant San Francisco, Houston ou Abu Dhabi ! Et ces prix s’accompagnent d’une pauvreté massive : 42 % de pauvres à La Réunion et 77 % à Mayotte par exemple – contre 14 % en métropole.
Les capitalistes qui dominent le secteur de la grande distribution à commencer par les békés – descendants des colons esclavagistes – nient toute responsabilité dans cet état de fait. Une enquête de Libération révélait pourtant en 2009 que les békés, représentant à peine 1 % de la population, détenaient alors 90 % de la filière agroalimentaire et 50 % des terres aux Antilles françaises. Même si des capitalistes métropolitains ou étrangers (notamment américains) pénètrent aujourd’hui les marchés, les békés conservent un poids prépondérant dans l’économie locale.
Le Groupe Bernard Hayot (GBH), véritable empire de la distribution, prétend lutter contre la vie chère et se dédouane de toute responsabilité. Pour expliquer les prix élevés, il pointe du doigt les « frais d’approche », la petite taille des marchés, ou encore une taxe appelée « l’octroi de mer ». Mais ces arguments ne tiennent pas. Le surcoût lié au transport maritime et au stockage – les fameux « frais d’approche » – ne représente que 5 à 7 % du prix final, selon Christophe Girardier, consultant pour l’Observatoire des prix de La Réunion.
Quant à l’octroi de mer (dont les recettes reviennent aux collectivités locales), les grands distributeurs omettent de rappeler que la TVA sur les produits alimentaires est déjà abaissée à 5,5 % (contre 20 % en métropole) dans la plupart des territoires d’Outre-mer. En Guyane et à Mayotte, elle est même suspendue depuis plus de 10 ans.
Monopoles
La cause centrale de ces prix élevés tient donc à la situation de monopole des grands groupes capitalistes qui contrôlent le secteur dans les DOM-TOM. Une poignée de groupes familiaux békés contrôle le marché de la grande distribution dans les Outre-mer. En Martinique, 80 % de ce marché sont détenus par quatre groupes : GBH, CréO, le Groupe Parfait et la SAFO. Une concentration similaire existe dans les autres territoires.
Ces grands groupes possèdent aussi les franchises de nombreuses enseignes. Par exemple : Carrefour, Casino, Yves Rocher, Monsieur Bricolage, Décathlon, Brioche Dorée, Renault, Nissan et Hyundai sont toutes aux mains de GBH. Sur certains produits, GBH est même à la fois importateur unique et distributeur (voire producteur). Les concurrents doivent lui acheter les produits plus chers pour espérer faire une marge, tandis que GBH peut les vendre moins « cher » (mais toujours cher) dans ses propres magasins.
Cette mainmise sur l’économie ne s’arrête pas là. Elle touche aussi la logistique : le groupe CMA-CGM exerce un quasi-monopole sur le fret maritime. Dans le meilleur des cas – à Mayotte, en Polynésie ou en Guyane – on compte deux ou trois compagnies concurrentes au maximum.
De 2019 à 2021, GBH est passé de 17 % à 37 % de parts de marché dans la grande distribution à La Réunion, en rachetant Vindemia, son principal concurrent sur l’île. Aujourd’hui, il concentre 45 % des dépenses de consommation courante des ménages réunionnais.
Ces capitalistes dégagent donc des profits considérables. En 2023, GBH a réalisé 227 millions d’euros de bénéfices et a empoché 55 millions d’euros d’aides publiques.
À Mayotte, l’arrivée de GBH a provoqué la fermeture de 1000 doukas (petites épiceries de quartier). Face à cette offensive, l’Autorité de la concurrence reste largement passive, voire complice, en jouant le rôle de médiateur quand les capitalistes se partagent leur butin.
Cette hégémonie est telle que des groupes comme GBH ont longtemps pu éviter de publier leurs comptes. Il a fallu une décision de justice et, surtout, la pression du mouvement social martiniquais pour les y contraindre. Avant de s’exécuter, Stéphane Hayot se justifiait en invoquant le « secret commercial ». Le 27 mars dernier, lorsqu’un sénateur lui demandait d’expliquer les raisons de cette non-publication, il avait rétorqué : « 80 % des entreprises en Outre-mer ne déposent pas leurs comptes ».
Le 22 janvier dernier, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, déclarait : « Il y a des groupes très performants, voire un grand groupe très performant [allusion à GBH], qui joue souvent un rôle d’étouffement de l’économie et du pouvoir d’achat. » Le lendemain, il ajoutait : « Il y a dans les pratiques économiques des relents de colonialisme. En évoquant, hier, ces sujets, j’ai vu d’ailleurs comment les lobbies réagissent. Je vois bien qu’on veut m’empêcher d’agir. »
Le RPPRAC s’est réjoui, qualifiant cette sortie hypocrite d’une « ouverture » de l’Etat. Mais sur ce point, il se trompe. Il devrait au contraire dénoncer fermement ces larmes de crocodile et rappeler que c’est bien l’Etat français – celui-là même que Valls sert – qui a brutalement réprimé les jeunes et les travailleurs mobilisés contre cette situation, à l’automne dernier. Il devrait aussi souligner que les déclarations de Valls contre les monopoles n’ont été suivies de l’annonce d’aucune mesure concrète. Le ministre s’est donc contenté de demander à GBH et leurs semblables d’être plus généreux. Autant demander poliment à un loup de bien vouloir cesser de manger les moutons…
Un programme révolutionnaire
La vie chère en Outre-mer n’est pas une fatalité. Elle est le produit direct du capitalisme et de l’impérialisme. Les békés et les grands groupes comme GBH travaillent main dans la main avec l’impérialisme français, qui exploite les matières premières et les travailleurs d’Outre-mer. Les grands groupes de métropole profitent pleinement de cette situation : ils approvisionnent les békés et engrangent des bénéfices via les franchises qu’ils leur cèdent. L’Etat français est au service de ces grands groupes. Il est donc vain d’espérer qu’il agisse contre leurs intérêts. Au contraire, il les défend en réprimant férocement les mobilisations des travailleurs d’Outre-Mer.
Face à la domination des monopoles et de l’Etat français, les travailleurs doivent s’organiser autour d’un programme offensif. Les organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier doivent revendiquer l’alignement immédiat des prix des produits de première nécessité sur ceux de la métropole – comme le fait le RPPRAC. Il faut aussi exiger la hausse des salaires et leur indexation sur l’inflation, afin d’empêcher l’érosion continue du pouvoir d’achat.
Mais cela ne suffit pas. Tant que les capitalistes garderont le contrôle de l’économie, ils continueront à spéculer sur les besoins vitaux. Il est donc essentiel d’exiger la levée du secret commercial : les comptes des grandes entreprises doivent être rendus publics. Cela permettrait de faire toute la lumière sur les circuits de surfacturation, d’optimisation fiscale et de captation des aides publiques.
Sur cette base, il faut revendiquer la nationalisation – sans aucune indemnité pour les actionnaires – de tous les groupes qui contrôlent les chaînes d’approvisionnement et de distribution : les géants du fret, de la logistique et du commerce, à commencer par GBH et CMA-CGM. Cette nationalisation doit s’opérer sous le contrôle démocratique des travailleurs eux-mêmes.
Dans le même temps, le mouvement ouvrier doit lutter contre la criminalisation des luttes sociales. Toutes les poursuites contre les militants doivent être abandonnées et les violences policières dénoncées.
Enfin, il est crucial de construire de puissants liens de solidarité entre les travailleurs d’Outre-mer et ceux de métropole. Car c’est le même patronat, le même Etat, le même système qui exploite ici comme là-bas. Lutter contre la vie chère et la « profitation » en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, c’est lutter contre l’austérité et les licenciements en métropole. L’unité de notre classe est notre force : la lutte des travailleurs d’Outre-mer est aussi celle des travailleurs de métropole.