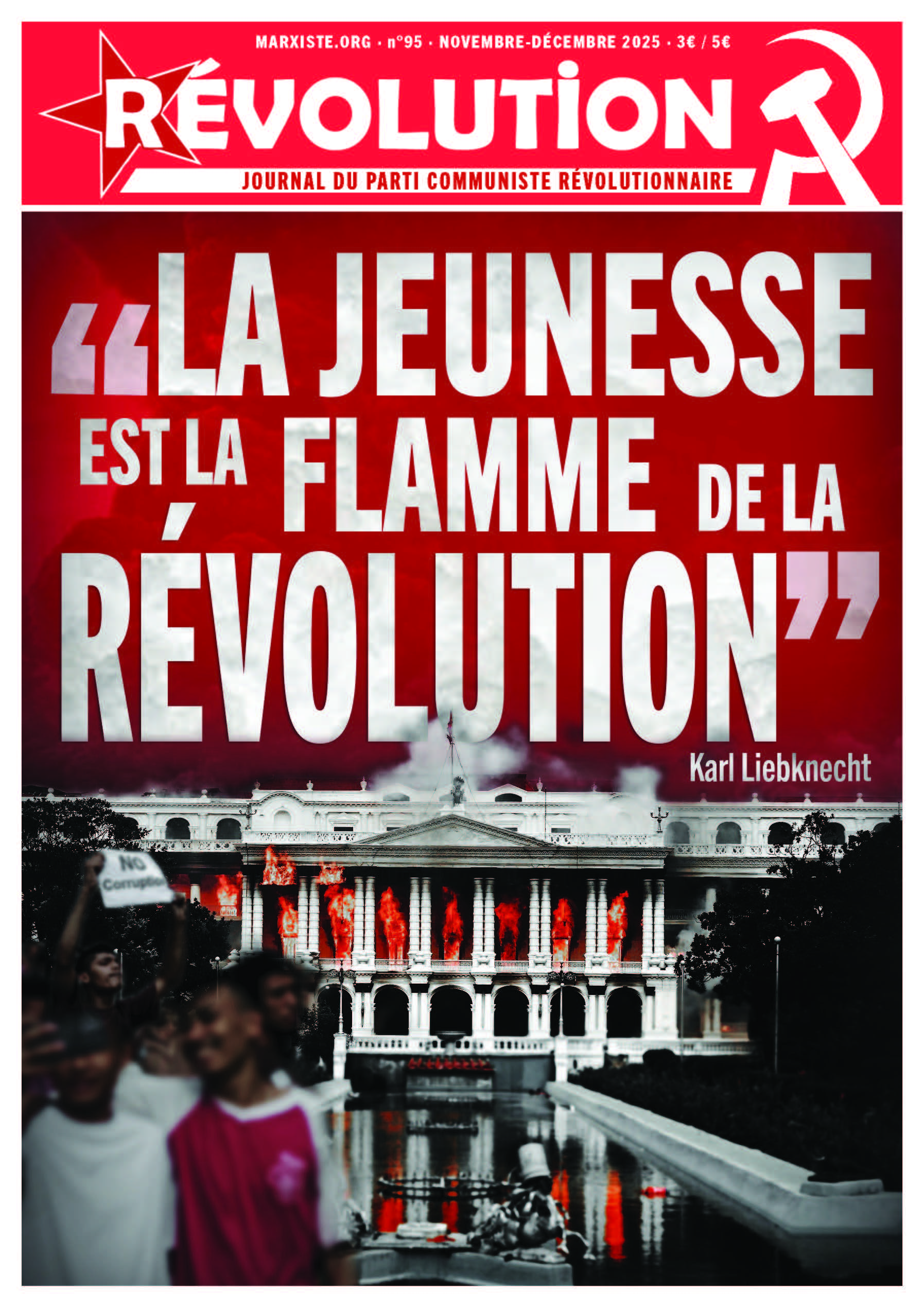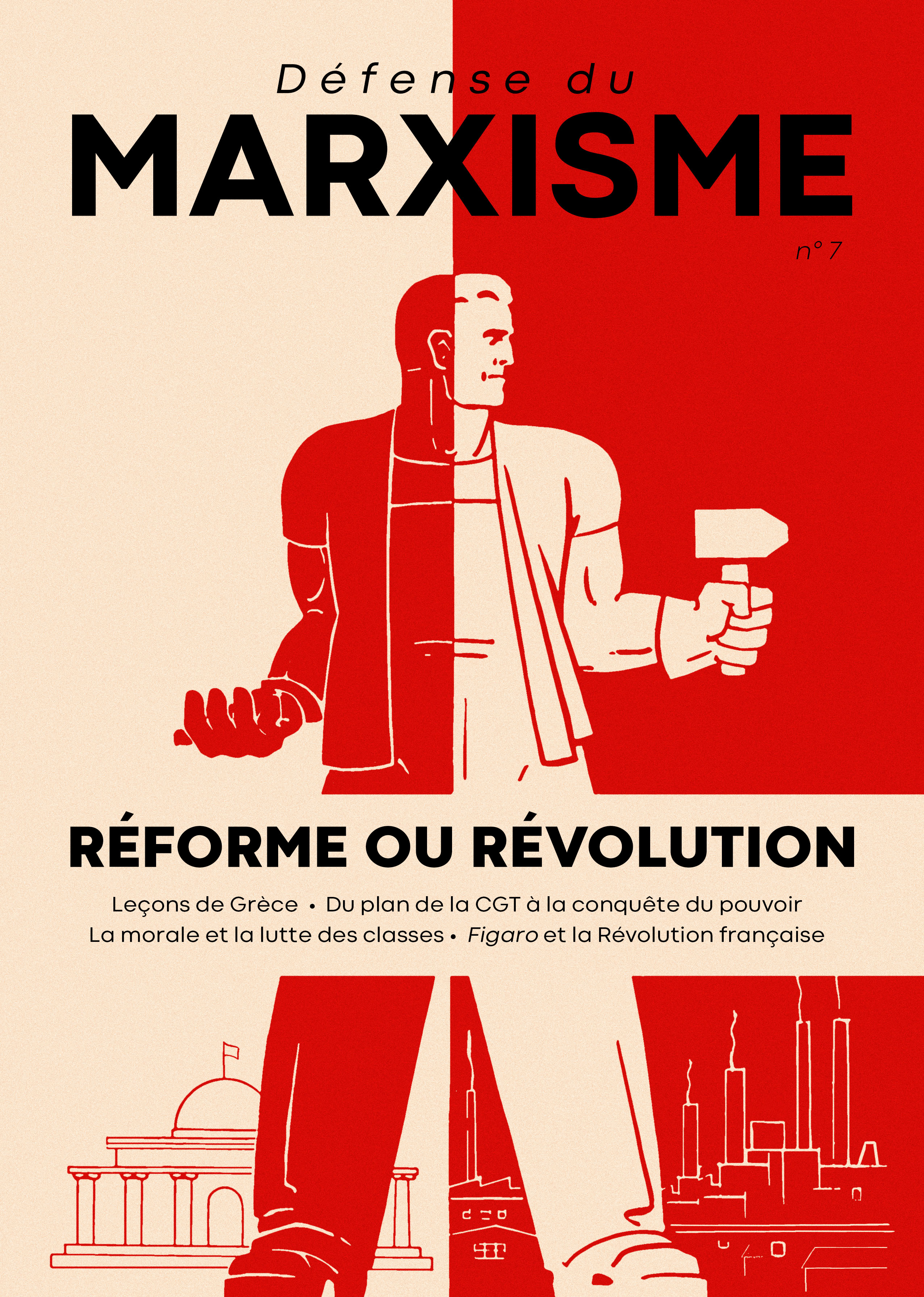Pour les marxistes, la Révolution russe a été l’événement le plus important de l’histoire moderne.
Pour la première fois, la classe ouvrière – se plaçant à la tête de toutes les autres couches opprimées – a pris le pouvoir, l’a conservé et a engagé la transformation socialiste de la société.
On sait que par la suite la bureaucratie stalinienne a confisqué ce pouvoir, puis a fini par restaurer le capitalisme en Russie (ce doit être abordé dans une autre discussion).
1917 a bouleversé l’histoire mondiale.
Malgré les crimes et le gâchis suscité par la bureaucratie stalinienne, l’expérience de la Russie soviétique a démontré la supériorité d’une économie planifiée sur l’économie de marché.
Enfin, cette révolution est une source unique de leçons pour les révolutionnaires de nos jours.
Les leçons non pas d’une défaite (pour une fois), mais d’une victoire.
Elle a notamment démontré positivement le rôle décisif du parti révolutionnaire – et même de la direction de ce parti.
Vous savez qu’il y a eu deux révolutions dans la révolution russe : février et octobre.
En bien, on peut affirmer sans l’ombre d’un doute que sans le parti bolchevik, il y aura eu, à la place de la révolution d’Octobre, une contre-révolution bonapartiste – voire le premier régime fasciste du XXe siècle.
*
Donc, la révolution 1917 est unique du point de vue des leçons qu’elle nous livre.
Tous nos camarades doivent la connaître à fond. Pour cela, il y a un livre qui est très utile et qui est peut-être un des plus grands chefs d’œuvre du marxisme : L’Histoire de la révolution russe, de Léon Trotsky
Il fait plus de 1000 pages, mais c’est une œuvre fascinante – et un bijou littéraire.
Trotsky était d’autant mieux placé pour écrire ce livre qu’il fut, avec Lénine, un acteur central de la Révolution russe : il y joua un rôle dirigeant dès son retour en Russie en mai 1917.
Comme Orateur et journaliste de premier plan. Comme Président du Soviet de Petrograd avant l’insurrection d’Octobre – et comme chef du Comité militaire révolutionnaire qui a organisé l’insurrection d’Octobre.
Mais Trotsky était bien placé aussi à un autre titre : dès 1905, il avait anticipé la possibilité que les travailleurs russes prennent avant la classe ouvrière d’Occident. C’est ce que l’on appelle la théorie de la révolution permanente.
On a pas le temps d’entrer dans les détails de cette théorie, mais en quelques mots.
La Russie pré-révolutionnaire n’avait pas accomplie sa révolution bourgeoise :
- la réforme agraire de 1861 avait laissé la masse des paysans pauvres dans une situation encore plus précaire ;
- le pays était économiquement très arriéré, très dépendant des investissements étrangers ;
- il n’y avait pas de parlement, mais la dictature féroce de l’autocratie tsariste ;
- la bureaucratie tsariste et l’aristocratie terrienne pesait de tout leur poids sur la société, et la bourgeoisie était très faible – et fusionnait en pratique avec l’aristocratie terrienne.
Mais dans le même temps, cette arriération économique et sociale se combinait à des éléments de modernité capitaliste : des usines géantes à Petrograd, Moscou et ailleurs et une classe ouvrière très concentrée.
La conclusion à laquelle arrivait Trotsky, c’est que la révolution bourgeoise russe ne pouvait être dirigée par la bourgeoisie. Elle serait donc dirigée par la classe ouvrière, qui entraînerait derrière elle toutes les couches opprimées, mènerait à bien les tâches de la révolution bourgeoise et commencerait à réaliser celles de la révolution socialiste, réalisant ainsi une première étape de la révolution mondiale.
C’est exactement ce qui s’est passé…
*
La cause immédiate de la révolution de février 1917, ce sont les terribles souffrances de la première guerre mondiale.
L’armée russe accumulait les défaites sur le front, la famine menaçait à l’arrière – pendant que les couches dirigeantes se vautraient dans la richesse et la corruption.
Le 8 mars, qui correspond au 23 février dans le calendrier qui existait alors en Russie, les femmes des usines décident de faire grève.
Ce n’est pas la première fois que les femmes déclenchent une révolution ou la portent en avant – comme l’ont montré plusieurs épisodes de la révolution française.
A noter d’ailleurs, un incident significatif : quand les femmes ont demandé conseil aux militants bolcheviks présent alors dans la capitale, ceux-ci ont tenté de les dissuader de manifester, par crainte qu’elles ne soient massacrées.
Elles n’ont pas écouté les conseils, et elles ont entraîné le reste de la classe ouvrière dans la grève.
Dès lors, la puissance colossale de l’appareil d’Etat tsariste a été réduit à néant et s’est effondré. Les soldats chargés de la répression ont désobéi et sont passés du côté des masses. Il y a de très belles pages dans le livre de Trotsky qui décrivent ce processus.
Cet exemple est une réfutation pratique du vieil argument selon lequel « l’Etat est trop puissant pour faire la révolution ». C’est oublier que les armes les plus puissantes sont tenues par des bras humains. Au moment décisif, en Russie, les bras qui tenaient les armes ont changé de camp.
En quelque jours, le régime s’effondre et le Tsar abdique.
*
Des politiciens bourgeois (Rozianko, Milioukov, etc) proclament un gouvernement provisoire.
Mais dans le même temps, on assiste à l’émergence des « soviets » d’ouvriers et de soldats à l’échelle nationale, qui étaient déjà apparu pendant la première révolution russe, celle de 1905.
Soviet en russe, ça veut dire « conseil », c’était en fait des sorte de comités de grève élargis élisant des délégués au niveau régional et national.
Il y a un « paradoxe » de cette révolution de février : elle est accomplie par les masses des ouvriers et des paysans (en uniforme), mais la majorité des soviets est alors composée de délégués réformistes, les Mencheviks et les Socialistes-révolutionnaires (SR).
Les Bolcheviks sont minoritaires.
Or les dirigeants mencheviks et SR ne voulaient pas le pouvoir : ils pensent que puisque la révolution est bourgeoise, le pouvoir doit revenir à la bourgeoisie. Ils appuient donc le gouvernement provisoire.
La révolution donne donc le pouvoir à ce gouvernement, composé de bourgeois monarchistes, hostiles à la révolution, à la réforme agraire, à la journée de 8 heures et à l’arrêt de la guerre.
On a une situation de double pouvoir : le gouvernement provisoire est au pouvoir, mais il ne peut gouverner que grâce à l’appui d’un deuxième pouvoir, les soviets.
*
Que font alors les Bolcheviks ? Lénine est en exil en Suisse lorsque la révolution éclate.
Staline et Kamenev, qui sont les principaux dirigeants bolcheviks à Petrograd, adoptent une position opportuniste : ils apportent un « soutien critique » au gouvernement provisoire, et parlent même d’unifier les Bolcheviks et les Mencheviks.
A son retour en Russie, en avril, Lénine mène une bataille au sein du parti pour changer cette ligne, et la remplacer par le programme de la prise du pouvoir par les soviets et la classe ouvrière.
Il défend ses positions dans les Thèses d’avril, et avance notamment le mot d’ordre « Tout le pouvoir aux soviets ».
Celui-ci à ce moment-là signifie en fait la prise du pouvoir par les Mencheviks et les SR, mais c’est une façon d’expliquer au travailleurs qu’il faut mettre fin au double pouvoir, que la prise du pouvoir par les Soviets était la seule façon d’obtenir « la paix, le pain, la terre »
Le gouvernement provisoire ne pouvait pas satisfaire ces revendications, car la bourgeoisie est liée aux propriétaires terriens, craint que toute la propriété privée (usines, banques) soit remise en cause dans la foulée d’une réforme agraire et est endettée auprès des impérialistes français, britanniques, etc. qui exigent que la guerre continue.
*
En avril, le ministre bourgeois Milioukov publie une note qui affirme que les « objectifs de guerre restent inchangés ». Cela provoque des manifestations, et une crise gouvernementale.
C’est la naissance du premier gouvernement de coalition : les SR et les Mencheviks entrent au gouvernement au coté des bourgeois pour servir de « couverture de gauche » de la bourgeoisie.
Kerensky devient ministre de la Guerre… et annonce une nouvelle offensive !
*
Lénine avance le mot d’ordre : « A bas les 10 ministres capitalistes ! »
Les Bolcheviks préparent une manifestation pour le 10 juin pour faire pression sur les dirigeants réformistes des Soviets.
Ceux-ci mènent une campagne de propagande hystérique contre la manifestation. Elle est annulée par les Bolcheviks, qui ne veulent pas donner de prétexte à une répression féroce.
Mais le 17 juin, une manifestation appelée par les dirigeants des Soviets se déroule presque entièrement sous les slogans des Bolcheviks, qui réalisent alors qu’ils ont gagné une énorme influence sur les masses de la capitale.
*
En juillet se déroule un épisode qu’on retrouve dans beaucoup de révolutions : l’avant-garde est frustrée par le fait que la révolution est bloquée et tente de la faire avancer à nouveau.
Les journées de Juin avaient démontré l’énorme influence des bolcheviks dans la capitale, mais Lénine et Trotsky comprenaient que le reste du pays (et les soldats sur le front) n’étaient pas encore prêts à les soutenir.
Lénine : « Avant de prendre le pouvoir, il faut gagner les masses »
A ce stade, une tentative de renverser le gouvernement provisoire aurait fini comme la Commune de Paris : la capitale, isolée, aurait été écrasée dans le sang.
Il y avait une énorme pression de la base de la classe ouvrière et des soldats de Petrograd, notamment des marins de la base de Kronstadt, pour que les Soviets prennent le pouvoir et renversent le gouvernement provisoire. Les Bolcheviks ont décidé de prendre la tête de cette manifestation armée pour l’encadrer, la limiter et ainsi la protéger.
Le gouvernement déclenche une répression brutale : Lénine est obligé de se cacher en Finlande, Trotsky est arrêté, l’imprimerie des Bolcheviks est saccagée, etc.
Autrement dit, on assistait à une phase réactionnaire, mais grâce à l’attitude des Bolcheviks, les forces de la classe ouvrière avaient été préservées, la répression n’avait pas pu décapiter la révolution. Cette phase réactionnaire n’était donc qu’un prélude à une nouvelle phase ascendante.
D’autant plus que la persécution des Bolcheviks renforçait leur autorité aux yeux de masses.
*
La contre-révolution relève la tête. Un général Kornilov prépare un coup d’Etat, en coopération avec Kerenski, pour détruire les soviets.
Mais, au dernier moment, il se retourne contre Kerenski et se prépare à prendre le pouvoir directement. Ses troupes – dont la terrible « divisions sauvage » composée de montagnards du Caucase – marchent sur Petrograd.
Comment réagissent les Bolcheviks ? Par une politique de front unique : combattre Kornilov, aux cotés de Kerenski, sans cesser de critiquer Kerenski, sans cesser de dénoncer sa complicité avec Kornilov et en se préparant à le renverser.
Ils rentrent notamment au Comité militaire révolutionnaire, créé par les Soviets pour défendre Petrograd.
Le coup d’Etat de Kornilov échoue lamentablement, sans qu’un coup de feu ne soit tiré.
Les cheminots organisés par les Bolcheviks détournaient les trains transportaient les soldats vers des voies sans issue – puis des agitateurs bolcheviks venaient discuter avec eux, en leur expliquant le programme de la révolution : le partage des terres et l’autodétermination pour les peuples du Caucase.
Tout le monde a pu voir le rôle des bolcheviks dans la défaite de Kornilov. Leur autorité est donc énorme. On assiste à une nouvelle vague bolchevik dans les soviets.
Kérensky tente de désarmer la révolution en envoyant au front la garnison de Petrograd. Les soldats demandent au Comité militaire révolutionnaire, que dirigeant maintenant les Bolcheviks, qui décide qu’il faut d’abord vérifier « la légitimité des demandes du gvt et de l’Etat-major ».
C’est là déjà une insurrection « à froid » : les soldats et le Comité refusent d’exécuter l’ordre du gouvernement provisoire.
La prise du pouvoir qui vient ensuite ne fait en fait que parachever cette insurrection.
Il y a alors une divergence entre Lénine et Trotsky sur la date de l’insurrection : Lénine voulant la faire sans attendre, quand Trotsky préférait qu’elle se tienne au moment du Congrès panrusse des Soviets, rassemblant les délégués venus de toute la Russie, pour que les masses comprennent bien qu’il s’agissait de remettre le pouvoir aux Soviets.
Insurrection est organisée, à Petrograd, le jour du Congrès. C’est une affaire très pacifique : personne ne veut plus défendre Kérensky et le gouvernement provisoire.
A Moscou, l’insurrection est plus violente, du fait des vacillations des dirigeants bolcheviks locaux.
Mais le véritable bain de sang est venu après, lors des 3 années de guerre civile et d’interventions impérialistes déclenchée par la bourgeoisie contre la révolution…
Toujours est-il que le 7 novembre 1917, Lénine pouvait proclamer la naissance du pouvoir soviétique, premier Etat ouvrier durable de l’histoire.
*
On voit bien comment à chaque étape de la révolution, le parti et sa direction – parfois concentré dans la personne de Lénine – ont eu à jouer un rôle considérable en proposant une tactique correcte, en l’expliquant – y compris au sein de leur propre parti parfois.
Sans ce rôle crucial de la direction, la révolution n’aurait pas été victorieuse. C’est une leçon pour les révolutionnaires d’aujourd’hui. Il nous faut un parti révolutionnaire !
Sans cette direction révolutionnaire, la révolution aurait été écrasée.