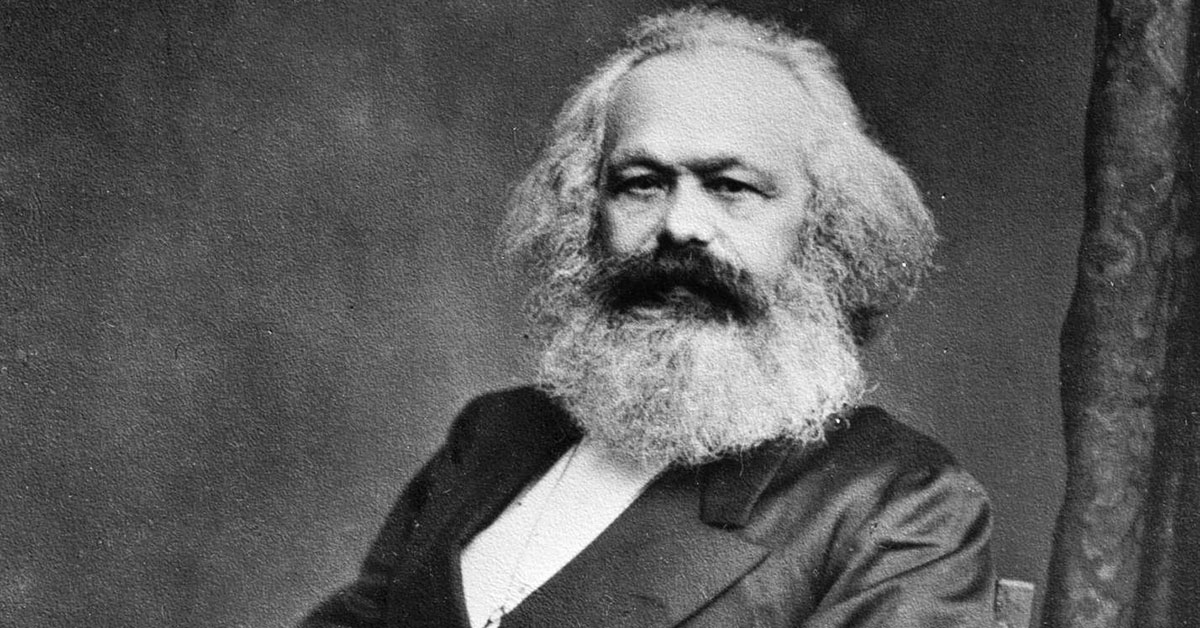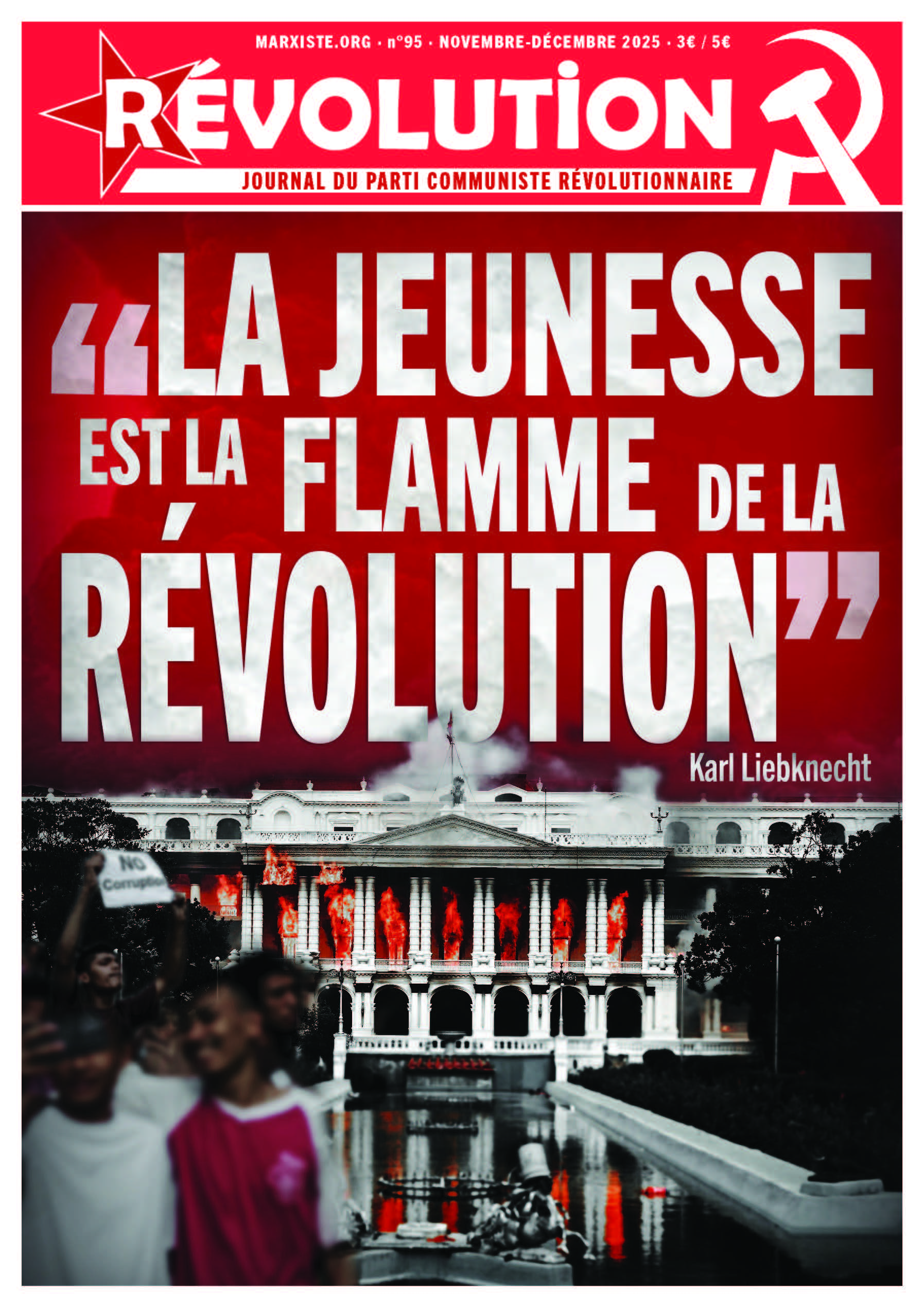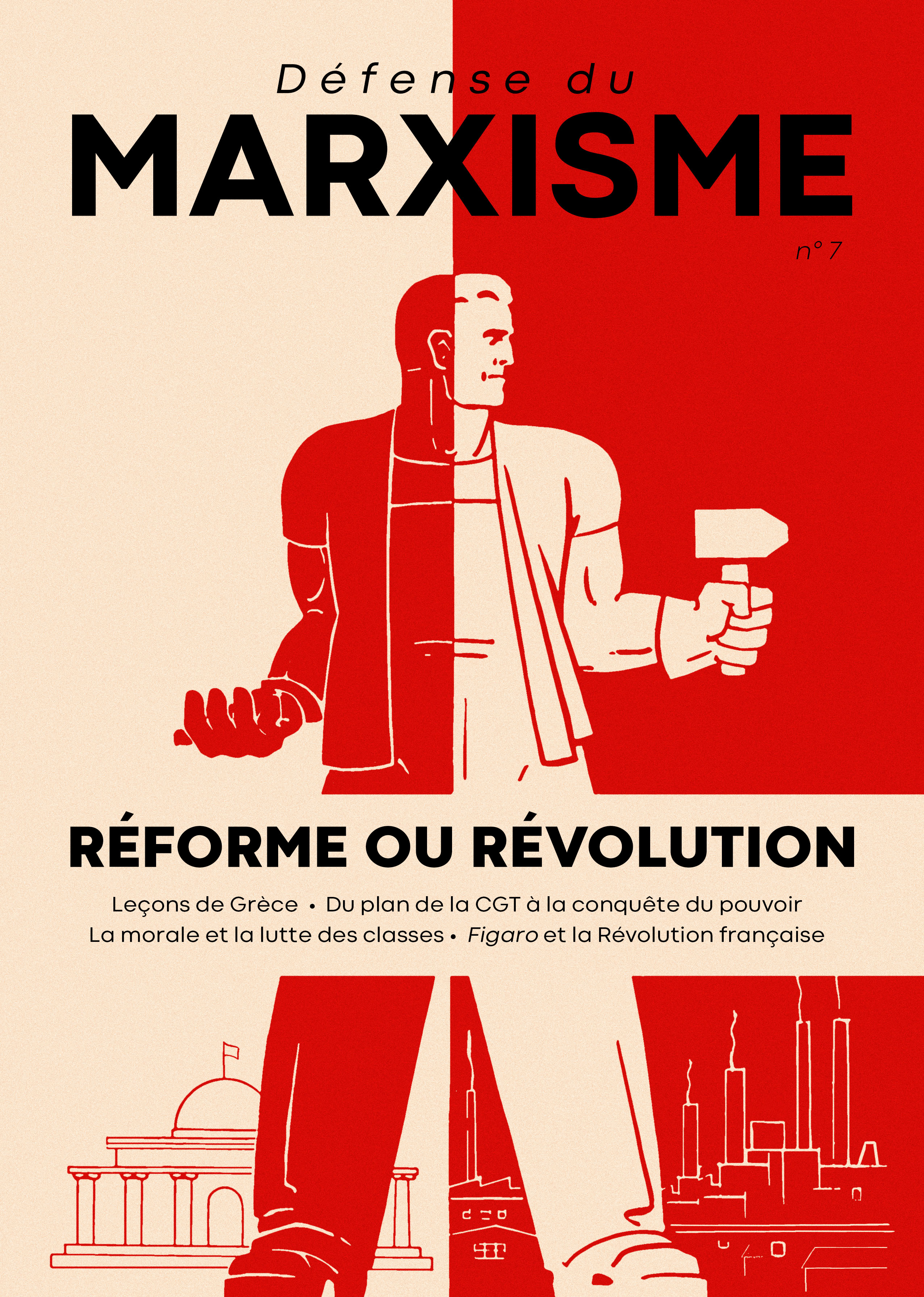Quand on aborde le thème de la philosophie, la première question qui vient à l’esprit de nombreux militants, c’est : « A quoi bon ? Est-ce qu’on a besoin d’une philosophie dans nos luttes sociales, dans notre lutte contre le capitalisme ? »
A première vue, ce n’est pas évident. D’ailleurs, en apparence, la philosophie est pratiquement absente du débat politique.
Mais ce n’est qu’une apparence, précisément – car en réalité, on n’échappe pas aussi facilement à la philosophie.
En fait, tout le monde a des idées philosophiques, même celui ou celle qui n’a jamais ouvert un livre de philosophie.
Tout le monde a des idées philosophiques, parce que tout le monde a sa petite idée sur le rapport entre les pensée et la matière, l’existence ou l’inexistence de Dieu, la finitude ou l’infinité de l’univers, etc.
Surtout, chacun raisonne, réfléchit, pense, en s’appuyant sur certains concepts logiques, même si la plupart des gens ne s’en rendent pas compte et n’y prêtent pas attention.
Or la logique, par excellente, relève de la philosophie.
Donc, tout le monde a des idées philosophiques. Simplement, lorsque ces idées ne sont pas consciemment élaborées, en quoi consistent-elles ? Inévitablement, en un mélange de préjugés philosophiques.
Or le préjugé, comme son nom l’indique (« préjugé »), c’est ce qui n’a pas encore été jugé, critiqué, analysé – et c’est donc une source d’erreurs.
En politique, ça se traduit par des erreurs d’analyse et de perspective, mais aussi des erreurs de programme, de stratégie et de tactique.
Les militants révolutionnaires ont donc tout intérêt à prendre la philosophie au sérieux.
*
J’en viens au sujet lui-même : la philosophie marxiste.
Et je partirai du nom qui lui a été donné : le « matérialisme dialectique ».
On a donc deux éléments : « le matérialisme » / « la dialectique ».
*
Je commencerai par la « dialectique ».
La méthode de pensée dialectique ne date pas de Marx. Elle remonte au moins aux philosophes grecs d’avant Socrate, entre le 7e et le 5e siècle avant JC.
En particulier, un certain Héraclite écrivait : « Tout est, et en même temps n’est pas, parce que tout est dans un mouvement perpétuel. Tout coule ».
C’est l’idée la plus fondamentale de la dialectique : toute chose est dans un processus de transformation permanent.
Or cette idée va à l’encontre du « bon sens » et de l’expérience quotidienne.
En effet beaucoup de choses ont l’air figées, fixes, permanentes.
Par exemple, cette table semble être stable, immobile, identique à elle-même. Mais en réalité, non. Elle subit sans cesse des modifications : de température, de volume, de masse, etc.
Ces modifications invisibles à l’œil nu, mais elles n’en sont pas moins réelles – et permanentes.
Ici, on voit en quoi la dialectique se distingue de ce qu’on appelle la logique formelle (développée dans son détail par Aristote).
Le principe de base de la logique formelle, c’est le principe d’identité, qui s’écrit : A = A. Par exemple : cette table = cette table.
Je ne dis pas que ce principe ne vaut rien. La logique formelle fonctionne parfaitement, mais seulement dans certaines limites.
Dans la plupart des activités quotidiennes, la logique formelle convient. Par exemple, je n’ai pas besoin de tenir compte des modifications de cette table pour l’utiliser.
Pour la plupart de nos « affaires courantes », la logique formelle est très utile – et parfaitement suffisante.
Mais dès qu’on a affaire à des processus beaucoup complexes, la logique formelle devient inopérante.
Or le développement du système capitaliste, de la lutte des classes, de ses diverses expressions – syndicales, politiques, idéologiques, etc. – sont des processus complexes, pleins de contradictions, et face auxquels la logique formelle est inopérante – mais aussi fausse, dangereuse et, finalement, réactionnaire.
Pourquoi je dis « réactionnaire » ? Parce que la logique formelle, c’est la philosophie de « l’ordre établi ».
C’est une philosophie qui nous dit, par exemple : « il y a toujours eu des riches et des pauvres – et donc il y en aura toujours. »
De manière générale, la logique formelle nous dit : « puisque les choses sont ainsi faites aujourd’hui, c’est qu’elles l’ont toujours été – et le seront toujours ».
C’est un préjugé très puissant et qui pèse très lourd sur la conscience des masses.
Pour déraciner ce préjugé de la conscience des masses, il faut de grands événements, de grands chocs – comme aujourd’hui avec la crise organique du capitalisme, l’inflation, la crise sanitaire, la crise environnementale, les guerres impérialistes, etc.
*
Pour préciser encore ce qu’est la dialectique, je vais prendre un exemple tiré de la biologie.
Jusqu’au début du XVIIIe siècle, on pensait que les différentes espèces végétales et animales avaient été créées une fois pour toutes – et par Dieu, évidemment.
Ce n’était pas une idée absurde, au fond, puisque l’expérience immédiate nous montre des espèces végétales et animales très différentes, dans leurs caractéristiques.
Alors, on supposait que chacune avait été créée telle quelle.
Mais, au début du XIXe siècle, les progrès de la science ont démontré que toutes les espèces, y compris l’homme, ont évolué à partir d’organisme monocellulaires.
Mieux encore : Darwin a constaté que cette évolution n’a pas été graduelle, linéaire, mais marquée par des accélérations brutales.
Les nouvelles espèces ne sont pas apparues graduellement, mais soudainement, brutalement.
Ce faisant, Darwin a mis le doigt sur un point central de la dialectique, à savoir : non seulement tout est en mouvement permanent, mais ce mouvement n’est pas linéaire : il est marqué par des ruptures, des bonds, des transformations soudaines.
*
C’est à Hegel, un philosophe allemand de la fin 18e et du début 19e, qu’on doit le développement le plus complet de cette idée d’une évolution par ruptures, par bonds.
Il faut souligner ici l’influence – sur Hegel – de la Révolution française de 1789-94, qui fut une énorme « rupture » dans l’ordre économique, politique et social.
On doit également à Hegel la formulation de lois de la dialectique : la transformation de la quantité en qualité, la négation de la négation, l’interdépendance des opposés – mais j’y reviendrai plus loin.
Enfin, Hegel a démontré – mieux que personne avant lui – que la contradiction, le conflit, sont au cœur de toute chose. La contradiction est le moteur du mouvement.
Par exemple : la lutte des classes est le moteur de l’histoire.
*
Cependant, la pensée de Hegel avait un défaut majeur : elle était idéaliste.
Pas au sens où il avait de grands « idéaux », mais au sens philosophique du terme. Selon Hegel, les idées sont premières, la matière est seconde. La matière est produite par les idées.
Pour Hegel, la nature, les hommes et leur histoire – tout cela est le produit de « l’Idée absolue », qui était là depuis le début, on ne sait trop où – et qui se réalise, s’aliène dans la nature et l’histoire humaine pour revenir à elle-même, enrichie de tout son développement historique.
Et que se passe-t-il lorsque l’Idée absolue est revenue à elle-même ? On a le « Savoir absolu », c’est-à-dire… le système philosophique de Hegel.
Hegel tombe donc dans une contradiction fatale. D’un côté, toute sa pensée dialectique implique que rien n’est jamais figé, que tout est engagé dans un mouvement perpétuel – mais, de l’autre, il fait de son système le point final de la pensée humaine, après lequel il n’y a plus rien à dire.
Cette contradiction est inhérente à son idéalisme – et à son hypothèse d’une « Idée absolue » qui se réalise en un Savoir absolu.
*
Cependant, en face de l’école idéaliste, en philosophie, il y a l’école matérialiste.
La philosophie marxiste – le matérialiste dialectique – appartient à cette école.
Marx et Engels admiraient la philosophie de Hegel, et ils en ont conservé la méthode dialectique, mais ils l’ont développée sur des bases matérialistes.
Ils l’ont « remise sur les pieds », comme l’écrivait Marx.
Pour les matérialistes, la pensée est le produit de la matière – et non l’inverse.
Plus précisément, la pensée est le produit du cerveau humain. Elle est le produit le plus subtil de la matière.
La pensée, c’est la matière qui se pense elle-même, qui se réfléchit elle-même.
La matière est première, elle précède et conditionne la pensée. Sans matière, pas de pensée – alors qu’à l’inverse la matière (le monde objectif) n’a pas besoin de la pensée pour exister.
*
En ce qui concerne l’histoire de l’humanité, le matérialisme marxiste ramène le rôle des idées à leur juste place.
Ce ne sont pas les idées qui, en dernière analyse, déterminent le cours de l’histoire.
Le cours de l’histoire est déterminé par le développement des forces productives et par la lutte des hommes pour la satisfaction de leurs besoins matériels – et pour la défense de leurs intérêts matériels.
Depuis qu’il y a des classes sociales aux intérêts matériels contradictoires, l’histoire est donc déterminée par cette lutte des classes – et les idées politiques des hommes sont aussi déterminées par cette lutte des classes. Ces idées ne peuvent pas être comprises en dehors de cette lutte.
Par exemple : le retour en force des idées « communistes », dans la jeunesse du monde entier, laisse les bourgeois bouche bée. Mais ce n’est pas une surprise pour les marxistes. Cela découle de la crise du capitalisme.
En retour, bien sûr, les idées jouent un rôle important – mais dans le cadre et dans les limites de conditions matérielles données.
Par exemple, les idées du communisme peuvent jouer un rôle demain, et vont jouer un rôle, parce que les conditions matérielles d’une révolution socialiste sont réunies. Ce n’était pas le cas il y a trois siècles, par exemple, lorsque les conditions matérielles d’une révolution socialiste étaient inexistantes.
*
Pour finir, je voudrais donner quelques illustrations des lois de la dialectique matérialiste.
En fait, ces lois sont tellement omniprésentes qu’on les retrouve jusque dans des expressions du langage courant.
Pa exemple : « c’est la goutte qui a fait déborder le vase ».
Cette formule exprime la loi dialectique de la transformation de la quantité en qualité.
Une accumulation quantitative produit, à un certain stade, une transformation qualitative.
L’un des exemples les plus connus, c’est la transformation qualitative de l’eau, à pression ambiante, selon sa température : à 100° l’eau passe à l’état gazeux, à 0° elle passe à l’état solide.
Cette même loi est à l’œuvre dans l’histoire et la lutte des classes.
Qu’est-ce qu’une révolution, au fond, sinon une rupture qualitative dans le cours de l’histoire ?
Une accumulation quantitative de frustration, d’humiliations, de régression sociale finit, à un certain stade, par produire une explosion sociale.
Trotsky parlait du « processus moléculaire de la révolution ». Cette image montre bien que cela se passe sous la surface.
D’où le danger d’une approche formaliste, qui mène au pessimisme politique, c’est-à-dire à des idées du genre : « Les travailleurs sont confus, ils ont un faible niveau de conscience », etc.
C’est ne rien comprendre à la façon dont évolue la conscience des masses.
La conscience est généralement en retard sur les événements, et elle ne rattrape pas ce retard de façon graduelle, mais brutalement, soudainement – sous le forme d’une révolution.
L’histoire avance par bonds – des bonds qui ne sont pas toujours des révolutions, d’ailleurs, mais qui peuvent en être les prémisses. Exemple : le mouvement des Gilets jaunes, en 2018 et 2019. Il a suffi de la « taxe carbone » pour provoquer une explosion sociale d’une grande puissance.
*
Autre loi de la dialectique : « la négation de la négation ».
Ceux qui ont étudié en France la connaissent tous : « thèse, antithèse, synthèse ». C’est sa forme académique, un peu artificielle, mais l’idée générale est là : thèse (affirmation), antithèse (première négation), synthèse (négation de la première négation).
Or, la deuxième négation n’est pas un simple retour au point de départ, à l’affirmation initiale. La négation de la négation marque un progrès.
Dans l’histoire de l’art, par exemple, la négation de la négation est sans cesse à l’œuvre.
Par exemple, dans l’histoire de la poésie française : Classicisme (Racine, Boileau, Malherbe) / Romantisme (Hugo, Lamartine, Vigny) / « Parnassiens » (Mallarmé, Valéry).
Si vous lisez les Parnassiens, vous verrez que le romantisme est passé par là. Et précisément parce qu’il y a eu l’étape romantique, les Parnassiens ne marquaient pas un simple retour au classicisme de Racine. C’était un classicisme enrichi par l’étape romantique.
*
Pour finir, un exemple tiré de l’histoire de l’humanité.
Pendant la plus longue période de cette histoire, les hommes vivaient dans le « communisme primitif » : propriété commune du sol et des instruments de production ; pas de classes sociales ; pas d’Etat.
Deuxième étape (première négation) : apparition de la propriété privée, de l’exploitation de classes et de l’Etat.
Troisième étape (deuxième négation) : le communisme moderne, qui est à venir.
Le communisme moderne ne sera pas un simple retour au communisme primitif – parce qu’il s’appuiera sur tous les progrès réalisés pendant l’histoire des sociétés de classe.
Mais cette deuxième négation, bien sûr, elle est encore à venir, et c’est à nous de la réaliser.