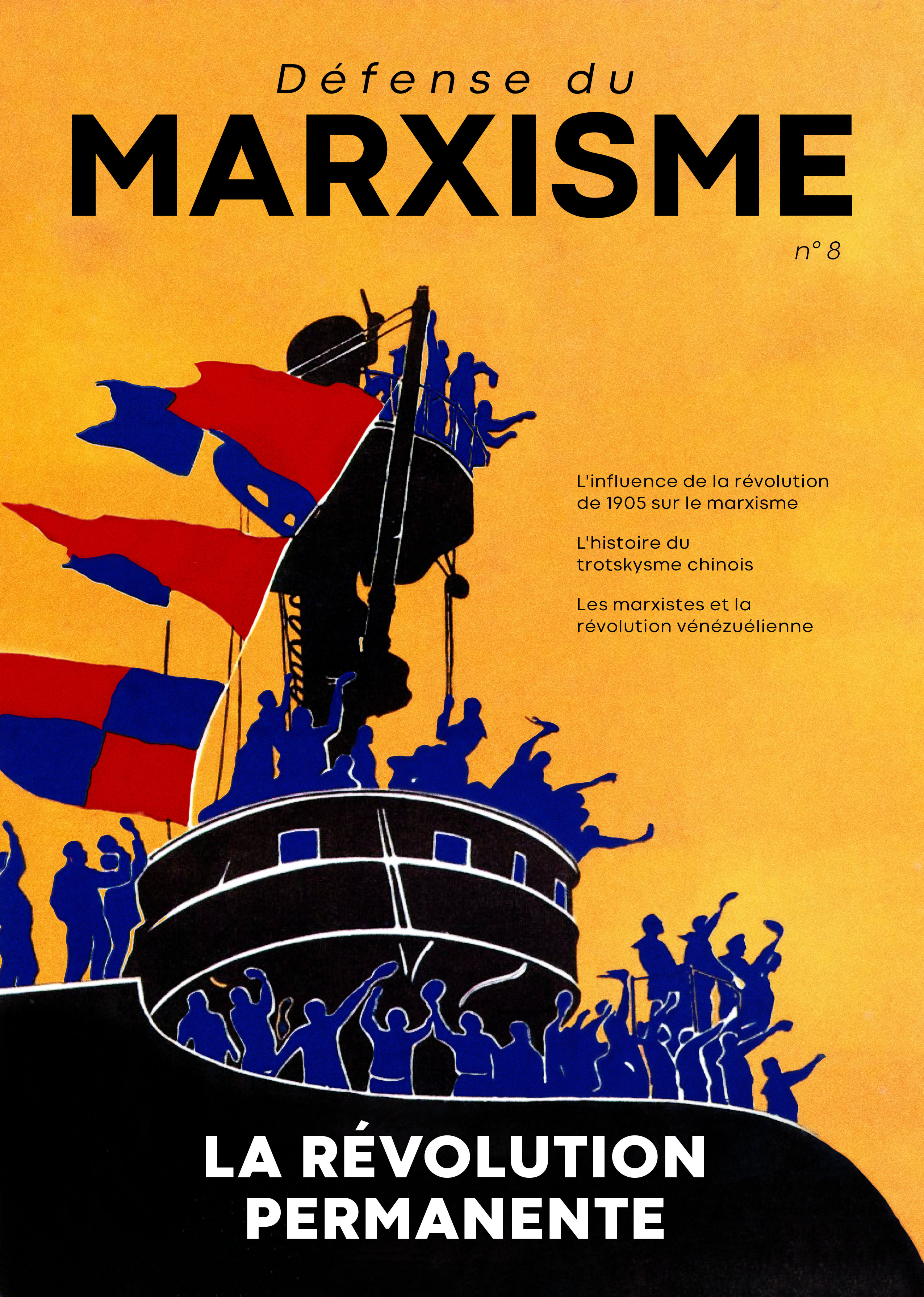En novembre et décembre 1995, un puissant mouvement social mettait en échec le « plan Juppé », qui s’attaquait notamment aux retraites des fonctionnaires. La SNCF, la RATP, la Poste et EDF-GDF – entre autres – étaient paralysés par une grève reconductible impliquant une grande partie du secteur public. Trente ans plus tard, on a tout intérêt à étudier les principales leçons de cette victoire.
La crise des années 1990
Le début des années 1990 est marqué par une crise économique, malgré l’ouverture de nouveaux marchés via la restauration du capitalisme en Russie, en Europe de l’Est et en Chine. L’économie américaine se remet difficilement du krach boursier de 1987. L’économie allemande est plombée par le coût de l’annexion de l’ex-RDA, ce qui pèse sur la croissance européenne.
En 1992, la France entre en récession pour la première fois depuis 1975. La production industrielle recule de plus de 5 %, tandis que le chômage augmente brutalement. Dans ce contexte, la bourgeoisie française exige des contre-réformes drastiques visant les retraites, la Sécurité sociale et les régimes spéciaux des fonctionnaires. L’objectif est de réduire le déficit public et de défendre la compétitivité (déclinante) du capitalisme français.
Au cours de l’été 1993, le gouvernement de droite d’Edouard Balladur – dont Nicolas Sarkozy est le ministre du Budget – s’attaque aux retraites. Il fait passer la durée de cotisation, pour une retraite à taux plein, de 37,5 à 40 annuités pour les travailleurs du privé. Dans le même temps, il indexe les retraites sur l’inflation, et non plus sur les salaires des actifs. Pour les travailleurs nés entre 1945 et 1954, cela se traduit par une baisse des pensions de 16 % pour les hommes et de 20 % pour les femmes (en moyenne).
Malgré sa brutalité, cette attaque ne rencontre pratiquement aucune résistance de la part du mouvement ouvrier. Le contexte politique est favorable à la bourgeoisie. La chute de l’URSS a porté un coup sévère au mouvement ouvrier organisé. Alors que les propagandistes de la bourgeoisie proclament la victoire de l’économie de marché, et même la « fin de l’histoire », la plupart des dirigeants réformistes – y compris ceux du PCF et de la CGT – renient à la fois le marxisme, la lutte des classes et le combat pour le socialisme, qu’ils identifient aux crimes de la bureaucratie stalinienne.
En décembre 1995, la CGT modifie ainsi ses statuts confédéraux pour remplacer la phrase « la CGT s’assigne pour but la suppression de l’exploitation capitaliste, notamment par la socialisation des moyens de production » par une phrase affirmant que la CGT « combat l’exploitation capitaliste et toutes les formes d’exploitation du salariat ».
L’expérience des deux septennats de François Mitterrand (1981-1995) pèse lourdement sur le mouvement ouvrier organisé. Alors que sa première élection avait suscité l’espoir de bâtir une « France socialiste (…) ici et maintenant », le gouvernement de gauche (PS-PCF) a rapidement capitulé face aux pressions des marchés. Dès 1983, les réformes progressistes font place au « tournant de la rigueur », c’est-à-dire à des politiques d’austérité. En conséquence, la droite remporte les élections législatives de 1986, puis celles de 1993, et multiplie les contre-réformes. C’est aussi sur la base de la trahison des gouvernements de gauche que le Front National de Jean-Marie Le Pen, à l’époque, entame sa longue ascension électorale.
Sur le plan syndical, les reculs ne sont pas moins profonds. Entre 1982 et 1992, la CGT perd environ la moitié de ses adhérents. Quant à la CFDT, après avoir viré à gauche sous l’impact de Mai 68 et de la crise des années 1970, elle a de nouveau viré à droite – et puissamment. Sa direction a même réclamé et approuvé le tournant de la rigueur. Cette trahison a suscité une forte contestation interne, notamment parmi les syndicats CFDT des Postes. Beaucoup de leurs militants sont exclus en 1988 et créent Sud-PTT, ancêtre de Solidaires.
Le « plan Juppé »
En mai 1995, Jacques Chirac remporte l’élection présidentielle. Pour se distancer de son rival de droite Edouard Balladur, il a mené campagne sur le thème de la « réduction de la fracture sociale » et promis de restaurer « la sécurité économique et la certitude du lendemain ». Mais très vite, Chirac et son Premier ministre Alain Juppé font de la réduction des déficits publics la « priorité du gouvernement pour les deux ans à venir ».
Présenté officiellement le 15 novembre 1995, le « plan Juppé » est axé sur plusieurs grandes mesures d’austérité : le passage à 40 annuités de cotisations pour la retraite des fonctionnaires ; l’abandon de la gestion paritaire de la Sécurité sociale au profit d’une loi budgétaire spéciale adoptée par l’Assemblée nationale ; l’augmentation des tarifs d’accès à l’hôpital public et la fin du remboursement de plusieurs médicaments ; le blocage et la fiscalisation des allocations familiales ; enfin, l’augmentation des cotisations maladie pour les retraités et les chômeurs.
A ce tsunami austéritaire s’ajoutent un programme massif de coupes à la SNCF et des attaques contre l’accès à l’université. Le ministre de l’Education nationale, François Bayrou, veut renforcer la sélection sous couvert de favoriser l’« orientation » dès le lycée. Autrement dit, « Parcoursup » est déjà dans les tuyaux. Mais cette contre-réforme, comme bien d’autres, va être repoussée (provisoirement) par la plus grande mobilisation sociale depuis Mai 68.
Bouillonnement social
Les premières mobilisations éclatent dès le début de l’automne, avant même la présentation officielle du plan Juppé – dont l’orientation est déjà connue. Sous pression de leur base, les syndicats de la Fonction publique se réunissent le 22 septembre et annoncent une journée de grève le 10 octobre. Des mobilisations éclatent aussi dans les universités pour protester contre le manque de moyens. Le 9 octobre, les étudiants de la faculté de sciences et techniques de Rouen sont en grève. Malgré une répression brutale, le mouvement étudiant s’étend à d’autres campus de province, puis à Paris.
Le 10 octobre, la journée de mobilisation des fonctionnaires est un grand succès : le gouvernement annonce 55 % de grévistes. Tous les sondages montrent que la grève est soutenue par une large majorité de la population. Sous pression, le secrétaire général de la CGT, Louis Viannet, est contraint d’annoncer qu’« il y aura une suite ».
Parallèlement, les syndicats de la SNCF se mobilisent sur fond de rumeurs concernant des projets de licenciements et de fermetures de lignes. Une première journée de mobilisation des cheminots a lieu le 25 octobre. Elle s’accompagne de la création d’assemblées générales (AG), qui vont jouer un rôle clé dans la préparation et l’animation de la grève reconductible de novembre et décembre.
Le 15 novembre, le Plan Juppé est adopté par l’Assemblée nationale. Deux jours plus tard, la secrétaire d’Etat aux Transports, Anne-Marie Idrac, présente les projets du gouvernement pour la SNCF : fermeture de 6000 kilomètres de lignes « non rentables », suppression de 73 000 emplois et augmentation des prix des billets !
Toutes ces attaques provoquent une colère massive : 54 % des personnes interrogées par les sondeurs déclarent être « prêtes à participer à un mouvement social ».
Grève reconductible
Tous les syndicats de la Fonction publique appellent à la grève le 24 novembre. Mais derrière ce front uni se cachent de profondes divisions. La Secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, déclare publiquement qu’il y a des « points positifs » dans le plan Juppé. En appelant à la mobilisation du 24 novembre, elle ne cherche qu’à obtenir du gouvernement des concessions mineures lui permettant de capituler et soutenir le plan.
De son côté, le gouvernement ne prend pas la mesure de la mobilisation qui s’amorce. Le 16 novembre, Alain Juppé lance un défi à la classe ouvrière : « Si deux millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n’y survivra pas ». Le 19 novembre, le ministre de l’Economie, Jean Arthuis, croit même judicieux d’annoncer que d’autres mesures d’austérité sont en cours de préparation, dont une hausse de l’impôt sur le revenu que payent les salariés.
Le 24 novembre, la journée de mobilisation est un peu moins massive que celle du 10 octobre – sauf dans les transports : près de 85 % de grévistes à la SNCF. Sur la manifestation parisienne, Nicole Notat (CFDT) est interpellée et traitée de « collabo » par des militants de son propre syndicat.
Le faux « reflux » du 24 novembre marque, en réalité, le début d’une mobilisation massive et de longue haleine. Le lendemain, de nombreuses AG de cheminots votent la reconduction de la grève à la SNCF. Plusieurs syndicats CFDT de cheminots rejettent les consignes de leur direction confédérale et appellent à la grève. Inspirés par la mobilisation des cheminots, les travailleurs de la RATP et des PTT entrent à leur tour en grève reconductible le 27 novembre. Le 28, une nouvelle journée de mobilisation nationale – à laquelle la CFDT n’a pas appelé – rassemble des centaines de milliers de manifestants.
Le spectre de Mai 68
Le 30 novembre, la grève démarre chez EDF et GDF : 52 % des travailleurs y participent. Début décembre, ce sont tous les transports publics de Marseille qui sont à l’arrêt. En quelques jours, c’est tout le pays qui est « paralysé » par la grève de la Fonction publique, comme le déplore la presse bourgeoise.
Dans plusieurs villes (notamment Paris, Nantes et Saint-Etienne), une violente répression policière s’abat sur les piquets de grève et les manifestations, mais cela n’a pas plus d’impact sur le mouvement que les promesses gouvernementales de concessions.
Le 29 novembre, François Bayrou annonce un « plan d’urgence » pour l’université, sans réussir à affaiblir la puissante mobilisation des étudiants : environ un tiers des universités sont en grève et occupées par les étudiants. Le gouvernement annonce aussi la création d’une « commission spéciale » sur les retraites, dirigée par Dominique Le Vert, l’architecte de la contre-réforme de 1993. Cette pseudo-concession vise à gagner du temps, mais la manœuvre est si grossière qu’elle ne rencontre aucun succès. Le 6 décembre, la première réunion de la « commission Le Vert » est boycottée par la plupart des syndicats.
Paniqué par l’ampleur de la mobilisation, le gouvernement se lance dans des manœuvres loufoques. Une campagne de publicité intitulée « Connaissez-vous le plan Juppé ? » suscite beaucoup plus de moqueries que d’adhésion. Le parti de Jacques Chirac – le RPR, ancêtre des Républicains – appelle ses partisans à manifester contre la grève. Résultat : 3000 personnes se rassemblent à Paris le 2 décembre. Le 10, une nouvelle manifestation de soutien au plan Juppé réunit 1500 personnes. Pendant que cette poussière humaine proteste contre les grévistes, la manifestation du 5 décembre rassemble près de 800 000 personnes, et 62 % de la population déclare soutenir le mouvement !
Face à la popularité de la grève parmi les salariés du privé (62 % de soutien), la bourgeoisie redoute que le mouvement ne gagne l’ensemble de l’économie. Cependant, rien de sérieux n’est fait dans ce sens – ni par la CGT, ni par aucune autre centrale syndicale. Quelques appels à la grève sont lancés début décembre par la CGT de Renault, qui est en train d’être privatisée ; mais faute de perspectives et d’objectifs clairs, ils rencontrent peu d’échos. Seule l’usine du Mans est touchée par une grève, à laquelle participent environ 30 % des salariés.
Malgré cette passivité des directions confédérales, le mouvement aurait pu s’étendre. Après tout, la grève générale de Mai 68 n’a pas eu besoin d’un appel de la CGT pour se prolonger au-delà du 13 mai, puis mobiliser 10 millions de grévistes et plonger le pays dans une crise révolutionnaire. Début décembre 1995, la répétition d’un tel scénario était une possibilité. Des AG massives et démocratiques se tiennent dans les lieux de travail occupés par les fonctionnaires. Des délégations de grévistes de la SNCF se rendent dans les bureaux de poste et les dépôts de bus pour aider à étendre la grève. Dans certaines villes, des meetings regroupent les grévistes – enseignants, électriciens, cheminots – et les sympathisants du mouvement. Début décembre, un débat sur la nécessité d’une grève générale éclate en plein Congrès confédéral de la CGT.
Incapable de contenir le mouvement, et face au spectre d’un nouveau Mai 68, le gouvernement se résout à reculer. Le 11 décembre, Alain Juppé annonce qu’il n’y aura pas de modifications de l’âge de départ à la retraite pour la SNCF et la RATP. Le lendemain, deux millions de personnes sont dans les rues. Le 15, le Premier ministre annonce le retrait de la réforme des retraites, mais maintient le changement de statut de la Sécurité sociale.
Après une réunion avec le ministre des Transports, le Secrétaire général de la fédération CGT de la SNCF, Bernard Thibault, appelle à mettre fin à la grève et à passer « à d’autres formes d’action ». Dès le lendemain, la plupart des AG votent la reprise du travail.
Quelles leçons ?
Chirac et le gouvernement Juppé ressortent très fragilisés de la mobilisation de novembre et décembre 1995. Vaincus par « la rue », ils ne sont plus en situation d’imposer les contre-réformes d’ampleur dont la bourgeoisie française a besoin. C’est pourquoi Chirac se résout à dissoudre l’Assemblée nationale au printemps 1997, dans l’espoir d’obtenir un nouveau « mandat » et, sur cette base, repartir à l’offensive.
Mais c’est la « gauche plurielle » – qui regroupe le PS, le PCF et les Verts – qui remporte les élections législatives anticipées. Le gouvernement de Lionel Jospin arrive au pouvoir et, pendant cinq ans, noie quelques réformes progressistes dans une politique de privatisations massives, d’interventions impérialistes (Yougoslavie, Afghanistan) et de précarisation de l’emploi, y compris dans la Fonction publique.
Après avoir déçu les espoirs suscités par la victoire de la gauche, Jospin est battu à plate couture lors des élections présidentielles de 2002. Jacques Chirac se retrouve au second tour face à Jean-Marie Le Pen. Elus avec 82 % des voix grâce au « front républicain », Chirac et son Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, s’attaquent de nouveau aux retraites. Comme Juppé l’avait tenté en 1995, il s’agit d’aligner la durée de cotisation du secteur public (37,5 annuités) sur celle du privé (40 annuités).
Pour s’y opposer, la CGT – alors dirigée par Bernard Thibault – met en œuvre, pour la première fois, la stratégie des « journées d’action ». Elle repose sur l’idée (fausse) selon laquelle la victoire de 1995 aurait été arrachée par les grandes manifestations de novembre et décembre, alors qu’en réalité le facteur décisif fut la grève illimitée de la Fonction publique.
Entre le printemps et l’été 2003, la direction confédérale de la CGT organise toute une série de « journées d’action ». Elles rassemblent plusieurs centaines de milliers de manifestants – et jusqu’à deux millions, le 13 mai –, mais n’ont aucun impact significatif sur l’économie et, surtout, n’ouvrent pas la perspective d’une paralysie générale du pays, comme ce fut le cas en 1995. La bourgeoisie laisse donc les couches les plus mobilisées s’épuiser dans une lutte sans perspectives claires, qui finit par refluer durant l’été.
Ce scénario se répétera à plusieurs reprises : lutte contre la réforme des retraites en 2010, contre la Loi travail en 2016, contre la privatisation de la SNCF en 2018, contre la réforme des retraites en 2023…
Une occasion manquée
Quelques années après la chute de l’URSS, la grande grève de décembre 1995 a rappelé que la lutte des classes n’est pas une relique du passé. En plaçant dos au mur le gouvernement et la bourgeoisie, cette mobilisation d’une partie de la classe ouvrière – le secteur public – a démontré que rien n’est possible sans les travailleurs. Ce sont eux qui produisent toutes les richesses et qui font tourner la société. C’est donc eux qui devraient la diriger.
Sur la base de cette perspective, il aurait été possible de s’appuyer sur la mobilisation contre le plan Juppé pour mettre en mouvement le reste de la classe ouvrière et renverser le capitalisme. Mais cela supposait l’existence d’une direction révolutionnaire conséquente. Une telle direction aurait pu proposer un une stratégie et un programme alternatifs à ceux de la direction confédérale de la CGT, qui se limitait au seul rejet du plan Juppé – et à ceux des partis de gauche, qui n’allaient plus loin que les directions syndicales. Aujourd’hui encore, la construction d’une telle direction révolutionnaire doit être la priorité de tous ceux qui veulent en finir avec le capitalisme et la régression sociale.