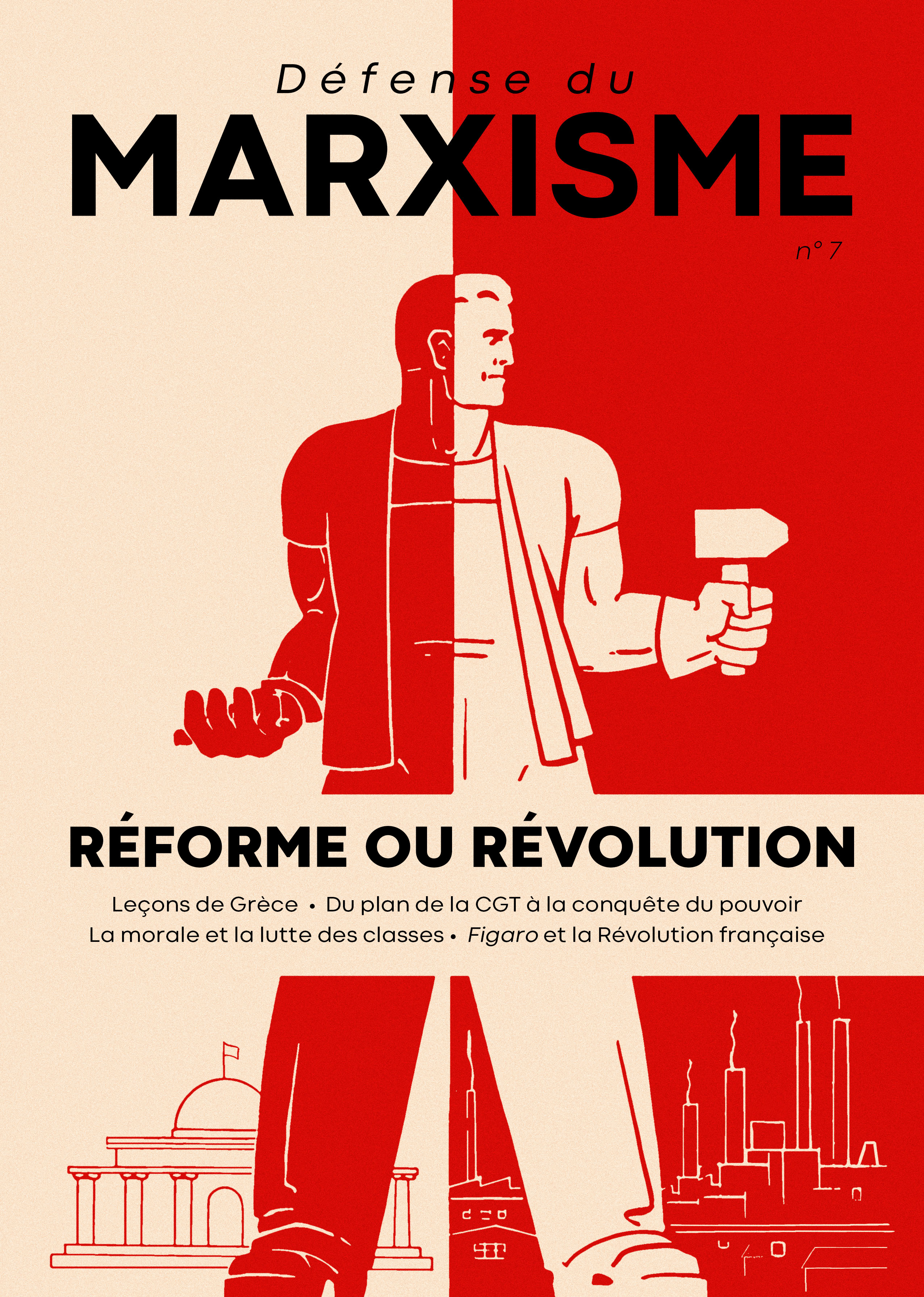De 1943 à 1948, l’Italie a connu un puissant mouvement révolutionnaire qui a balayé le fascisme et menacé le système capitaliste lui-même. Dans cet article, Roberto Sarti analyse cette vague révolutionnaire et explique comment elle a été délibérément trahie par les dirigeants staliniens du Parti Communiste Italien.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, en septembre 1939, l’impérialisme italien est dans un état d’impréparation économique et militaire totale. C’est pourquoi le régime fasciste de Benito Mussolini se garde d’entrer en guerre et laisse à son allié allemand, qui est bien plus fort, le soin de mener le combat.
En mai 1940, néanmoins, les Pays-Bas, la Belgique et la France sont balayés par la guerre-éclair des Allemands ; Mussolini s’effraie du rythme des événements, au point qu’il fait soudainement volte-face. Croyant que la guerre serait « terminée en septembre », il déclare :
« il me faut quelques milliers de morts pour être en mesure de participer à la conférence de paix en homme qui s’est battu. » [1]
Le 10 juin 1940, il lance l’Italie dans la guerre ; il espère ainsi s’offrir une place au « banquet des vainqueurs ».
C’était un très mauvais calcul : entre 1940 et 1943, l’armée italienne perd près de 500 000 hommes. La campagne de Russie est catastrophique : 90 000 soldats sont tués parmi les 220 000 qui sont envoyés – très mal équipés – combattre dans le glacial hiver russe.
Rapidement, la discipline de l’armée italienne s’effondre. Au lendemain de la déroute sur le Front de l’Est, dans les trains qui les rapatrient, les chasseurs alpins crient : « A bas Mussolini, assassin des Alpins ! ». Les désertions se multiplient.
A l’arrière, la situation n’est pas moins désespérée. Entre 1939 et 1942, les prix doublent. Pourtant, Mussolini ordonne le gel des salaires, car, dit-il, les augmenter ferait flamber l’inflation. Le rationnement atteint des niveaux insoutenables : en 1942, chaque personne n’a droit qu’à 80 grammes de bœuf par semaine, un œuf tous les 15 jours, 2 kilos de pâtes et 1,8 kilo de riz par mois.
La chute de Mussolini
Le mécontentement ne cesse de grandir, et après vingt ans de torpeur sous la botte fasciste, le mouvement ouvrier commence enfin à montrer des signes de réveil.
Les premières grèves éclatent dès la seconde moitié de 1942, en particulier à Turin, Milan et Gênes. Mais c’est à partir du 5 mars 1943 que la grève, partie des ateliers de la Fiat à Turin, se répand comme une traînée de poudre. Elle s’étend d’abord aux autres usines turinoises, puis à d’autres villes du nord. Bientôt, plus de 150 000 ouvriers sont engagés dans le mouvement.
Les revendications des travailleurs portent sur les « 192 heures » (l’équivalent d’un treizième mois, pour compenser l’inflation), l’échelle mobile des salaires, la libération des prisonniers politiques antifascistes et le retrait de la milice fasciste des usines. Dans la lutte, on reprend la chanson « Bandiera rossa » (Le drapeau rouge).
Dans une note à Mussolini, le dirigeant fasciste Roberto Farinacci écrit :
« Si l’on vous dit que le mouvement revêt un caractère purement économique, on vous ment. Dans les tramways, les cafés, dans les théâtres, les cinémas et les abris, c’est le régime que tout le monde met en cause. » [2]
Les tentatives de répression sont sans effet. Début avril, le gouvernement est contraint de céder à toutes les revendications économiques.
La bourgeoisie italienne commence à craindre pour l’ordre et la stabilité ; elle remet en question le lien qui l’attache au fascisme depuis vingt ans. Comme souvent dans l’histoire, la classe dirigeante cherche à empêcher une révolution par en bas en procédant à des changements par en haut.
C’est donc l’entrée en scène de la classe ouvrière qui a donné le coup de grâce au régime fasciste.
Le débarquement des « Alliés » anglo-américains en Sicile, début juillet 1943, ne rencontre pratiquement aucune résistance, ce qui confirme l’imminence de l’effondrement du régime. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, Mussolini est démis de ses fonctions et arrêté lors d’une réunion du Grand Conseil du Fascisme.
 Lors de cette révolution de palais, le roi Victor-Emmanuel III donne mandat au maréchal Pietro Badoglio de former un nouveau gouvernement. Chef d’état-major de Mussolini jusqu’en décembre 1940, Badoglio n’avait pas hésité à utiliser des armes chimiques lors de l’invasion de l’Abyssinie (Ethiopie) en 1935-1937.
Lors de cette révolution de palais, le roi Victor-Emmanuel III donne mandat au maréchal Pietro Badoglio de former un nouveau gouvernement. Chef d’état-major de Mussolini jusqu’en décembre 1940, Badoglio n’avait pas hésité à utiliser des armes chimiques lors de l’invasion de l’Abyssinie (Ethiopie) en 1935-1937.
La destitution de Mussolini est le premier pas vers la conclusion de la paix avec les Alliés. Une fraction majoritaire de la bourgeoisie italienne juge nécessaire de se placer sous la protection des troupes américaines et britanniques, afin de mieux contenir la montée de la lutte des classes.
Le nouveau gouvernement est, de facto, une tentative de protéger le capitalisme italien par une dictature militaire. Mais pour donner l’illusion du changement, les institutions les plus détestées sont dissoutes. C’est le cas du Parti National Fasciste, du Grand Conseil du Fascisme et de la Chambre des Corporations. Mais la continuité de l’appareil d’Etat est assurée : le pouvoir passe aux mains de l’Armée ; la très fasciste « Cour spéciale pour les crimes politiques » se contente de changer de nom, et l’OVRA – la police politique – continue d’opérer.
La préoccupation immédiate du gouvernement Badoglio est d’éviter tout trouble à « l’ordre public ». Dans les circulaires drastiques qu’il émet, on trouve l’état de siège, le couvre-feu, la censure, l’interdiction de reconstituer les partis politiques et d’afficher des projets de loi, la qualification de « tentative d’insurrection » pour tout rassemblement de plus de trois personnes, et l’interdiction de porter des insignes représentant autre chose que le drapeau italien.
Dans la seule journée du 26 juillet, la répression mobilisant l’armée et les Carabiniers (police militaire) fait 11 morts, autour de 80 blessés et près de 500 arrestations. Mais aucune mesure de répression, si dure soit-elle, ne peut empêcher les manifestations massives célébrant la chute du fascisme.
Le réveil des masses
A l’époque, le théoricien marxiste Ted Grant a décrit le caractère insurrectionnel de ces manifestations :
« Dans toutes les cités industrielles, Milan, Turin, Gênes, etc., des grèves massives éclatent en 24 heures. Dans toute l’Italie du Nord, les chemins de fer sont paralysés en l’espace de quelques jours. Les travailleurs prennent d’assaut les prisons et libèrent les prisonniers politiques. Dans les grandes villes, les quartiers généraux des fascistes sont mis à sac et leurs imprimeries sont saisies par les travailleurs de Milan et d’ailleurs. Au lendemain de la disparition de Mussolini, quiconque arbore les insignes fascistes en Italie prend le risque d’être lynché. Le fascisme s’évanouit du jour au lendemain. Le décret tardif procédant à la dissolution du Parti Fasciste ne fait qu’entériner une situation créée de manière irrévocable par les travailleurs et les soldats eux-mêmes. [...] A Milan, la tentative de lancer l’armée contre les manifestants a fait basculer les soldats du côté des travailleurs ». [3]
Dans les usines, le rapport de forces est inversé. Les ouvriers reconstituent les « commissions internes » (comités de délégués) et élisent à nouveau leurs représentants. Ils reconstruisent les syndicats ; ils expulsent les inspecteurs et les contremaîtres, pour la plupart membres du Parti Fasciste. Bref, ils renouent avec les traditions révolutionnaires du « Biennio Rosso » (« les deux années rouges ») de 1919-1920.
Les grèves au nord et les occupations de terres au sud marquent en profondeur les 45 jours du gouvernement Badoglio. Ce dernier assiste, impuissant, à l’intensification des bombardements alliés sur les villes, destinés avant tout à terroriser les masses et affaiblir la mobilisation des travailleurs. Entre-temps, Hitler renforce massivement son armée dans la péninsule, doublant ses effectifs entre juillet et septembre 1943.
Dès ce moment, Badoglio aurait pu être renversé. Mais sur l’insistance des Libéraux et des Démocrates-Chrétiens, l’alliance de tous les partis antifascistes, des Libéraux aux Communistes du PCI, bientôt scellée dans le Comité de Libération Nationale (CLN), refuse d’adopter cette position. Le politicien réformiste et initiateur de cette alliance, Ivanoe Bonomi, entend suspendre la résistance armée contre les nazis à l’arrivée des armées alliées dans la péninsule. Dans le même temps, les Alliés rebâtissent l’appareil d’Etat en Sicile, en s’appuyant sur la Mafia et le clergé catholique.
Le refus des dirigeants ouvriers d’assumer la direction de la lutte offre à Badoglio un répit suffisant pour conclure la paix avec les Alliés. L’armistice date du 3 septembre, mais il est gardé secret jusqu’au 8 septembre. Dès qu’il est révélé par les Américains, les nazis s’engagent dans la prise de contrôle du territoire italien et le désarmement de l’armée.
Le jour suivant, le roi, son héritier, Badoglio et le haut commandement militaire prennent piteusement la fuite vers Brindisi, sur la côte sud-est, désormais sous le contrôle des Alliés. Dans le même temps, l’appareil d’Etat, à commencer par l’armée, fond comme neige au soleil.
Face au danger de la révolution prolétarienne, la classe dirigeante oublie tous ses beaux discours sur la « défense de la patrie » et laisse aux nazis le contrôle d’une grande partie de l’Italie. Dans plusieurs villes, les hauts gradés refusent de livrer leurs armes aux travailleurs qui veulent combattre l’armée allemande. A Rome, ils considèrent comme un moindre mal la reddition de la ville aux nazis.
Les nazis organisent la libération de Mussolini, mi-septembre, et le placent à la tête de leur gouvernement fantoche : la « République sociale italienne », mieux connue sous le nom de « République de Salò », d’après le nom de la ville où elle fut fondée. D’abord plongées dans la sidération, les masses reprennent bientôt le combat, cette fois contre l’occupation nazie et contre les collaborateurs italiens.
Les « Quattro giornate di Napoli » (« les Quatre journées de Naples »), du 27 au 30 septembre 1943, constituent une illustration frappante du potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière. Le peuple en armes, guidé par les travailleurs, libère la ville de l’armée occupante au moyen d’une insurrection spontanée, sans aucune aide des Alliés et sans le soutien du CLN (Comité de Libération Nationale). Naples est, de fait, la première ville d’Europe à s’insurger victorieusement contre les nazis. Elle montre la voie aux masses opprimées d’Europe.
Le tournant de Salerne
A l’automne 1943, l’Italie est donc divisée : occupée par les Alliés au sud et par les nazis au nord. Les luttes de classe s’intensifient : reprise des grèves au nord et, au sud, extension des occupations de terres par les paysans et les ouvriers agricoles.
En pratique, il est désormais évident que le combat contre le fascisme est inextricablement lié au combat contre le capitalisme. Néanmoins, la ligne politique proposée par le secrétaire général du PCI, Palmiro Togliatti, ne contient rien qui puisse satisfaire les revendications sociales des masses.
Le gouvernement Badoglio ne dispose d’aucun soutien parmi les ouvriers et les paysans. Pourtant, dès le 10 septembre, depuis Moscou, Togliatti déclare que si le gouvernement Badoglio « prend en main, ouvertement et sans hésitation, la bannière de la défense de l’Italie contre l’agression lâche de Hitler [...], le peuple lui apportera son soutien sans hésiter. » [4]
En semant ainsi des illusions sur le gouvernement, l’objectif central de Togliatti est d’étouffer la poussée révolutionnaire de la base.
Plus tard, le 12 janvier 1944, Togliatti, toujours à Moscou, développe la ligne du PCI en vue de soutenir un nouveau gouvernement d’« unité nationale ». Il affirme à cette occasion qu’il faut œuvrer à « la création rapide, ou plutôt immédiate, d’un gouvernement démocratique national avec la participation de tous les partis antifascistes. »
D’après des notes personnelles de Georges Dimitrov, l’ancien secrétaire général de l’Internationale Communiste, Togliatti et Staline se rencontrent à Moscou le 3 mars. Togliatti informe ensuite Dimitrov des instructions que Staline lui a données : entrer dans le gouvernement Badoglio et ne pas exiger l’abdication immédiate du roi. En prévision de cette démarche, l’Union Soviétique reconnaît officiellement le gouvernement Badoglio, le 10 mars.
Fin mars 1944, Togliatti, de retour en Italie, confirme cette position lors d’un meeting des cadres du PCI des régions libérées. L’événement est connu sous le nom de « tournant de Salerne », du nom de cette ville, au sud de Naples, où la position est rendue publique.
« Fronts populaires »
Le tournant annoncé par le secrétaire général du PCI est complètement conforme à la politique stalinienne des « Fronts populaires », c’est-à-dire la formation d’alliances « antifascistes » avec les partis de la prétendue « bourgeoisie démocratique ».
La victoire de Hitler en 1933 et l’écrasement du mouvement ouvrier allemand ont semé la panique à Moscou – et provoqué un tournant spectaculaire dans la politique de l’Internationale Communiste.
Selon la position adoptée au septième Congrès de l’Internationale, en 1935, le processus révolutionnaire devrait être divisé en deux étapes clairement séparées. La première consiste à vaincre le fascisme et consolider la démocratie bourgeoise. Tant que cette étape n’est pas achevée, la révolution socialiste ne doit pas être mise à l’ordre du jour ; toute offensive de la classe ouvrière en vue de dépasser les limites du capitalisme serait prématurée et fatale. Le socialisme ne serait envisageable que dans un deuxième temps, lors d’une seconde étape de la révolution.
Les mencheviks russes avaient défini de façon identique leurs perspectives pour la révolution russe, ce qui leur avait valu d’être impitoyablement critiqués par Lénine. L’application de cette même politique par l’Internationale Communiste, dans les années 1930, a eu des conséquences catastrophiques, comme l’a montré l’exemple du Front populaire en Espagne. La direction du Parti Communiste Espagnol a fait tout ce qu’elle pouvait pour arrêter le mouvement révolutionnaire des masses, au nom du maintien de l’alliance avec la « bourgeoisie antifasciste ». Le résultat fut la victoire de Franco en 1939, l’isolement accru de l’Union Soviétique – et l’inéluctabilité d’une nouvelle guerre mondiale.
Pour comprendre les raisons de cette politique désastreuse, il faut tenir compte du fait qu’à l’époque, la direction de l’Internationale Communiste a complètement abandonné ce qui avait motivé sa création : la lutte pour la révolution mondiale. Au lieu de cela, elle s’est transformée en auxiliaire des manœuvres diplomatiques de la bureaucratie stalinienne de Moscou.
Le tournant des « Fronts populaires » reflétait la volonté de Staline de normaliser ses relations avec les « démocraties » impérialistes. Cela impliquait nécessairement de contenir et de réprimer toute révolution en Europe.
La bureaucratie soviétique cherchait par tous les moyens à défendre son pouvoir et ses privilèges. Elle considérait toute révolution ouvrière – même hors de ses frontières – comme un danger mortel pour sa propre position. Aucun point de référence alternatif ne devait émerger au sein du mouvement ouvrier international. L’exemple d’une authentique démocratie ouvrière soulignerait le caractère bureaucratique et répressif du régime stalinien, son usurpation des idées du socialisme et de la révolution d’Octobre.
Cette politique de trahison s’est poursuivie tout au long de la guerre. Pour montrer ses bonnes intentions à ses alliés impérialistes, Staline est allé jusqu’à dissoudre l’Internationale Communiste, le 15 mai 1943, sans même prendre la peine de convoquer un Congrès.
Fin octobre 1943, une conférence des ministres des Affaires étrangères de l’Union Soviétique, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne se tient à Moscou. Elle discute, entre autres, de la question italienne. La déclaration commune affirme la nécessité de poursuivre le combat contre le nazisme avec la participation au gouvernement italien des « secteurs du peuple italien qui se sont toujours opposés au fascisme » [5]. Ainsi est mise en œuvre la ligne de collaboration de classe arrêtée par Staline et Togliatti.
Les revendications démocratiques
Quelle position les communistes italiens auraient-ils dû adopter ? Dans un contexte où les nazis occupaient la majeure partie du territoire et où, au sud, sévissait la dictature militaire de Badoglio, les communistes pouvaient-ils ignorer la lutte pour des revendications démocratiques ?
Dès 1930, dans une lettre adressée à trois cadres dirigeants du PCI qui venaient de rompre avec le stalinisme, Léon Trotsky abordait la question des tâches des marxistes dans la prochaine révolution italienne. Il soulignait que, dans l’hypothèse d’un renversement révolutionnaire du régime fasciste par les travailleurs et les masses opprimées, la bourgeoisie italienne chercherait à préserver sa domination de classe au moyen d’un régime parlementaire. Elle opposerait une « révolution démocratique » au mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière, dans le but de le détruire.
Toutefois, le fait que les capitalistes – et leurs agents au sein du mouvement ouvrier – tentent d’utiliser les revendications démocratiques pour duper les masses, n’implique pas que les communistes doivent rejeter tous les mots d’ordre démocratiques. Comme l’expliquait Trotsky :
« Si la crise révolutionnaire devait éclater [...] la masse des travailleurs, ouvriers et paysans, ferait suivre ses revendications économiques de mots d’ordre démocratiques (liberté de réunion, de presse, liberté syndicale, représentation démocratique au Parlement comme dans les municipalités). Est-ce que le Parti Communiste devrait rejeter ces revendications ? Tout au contraire. Il devrait leur donner le caractère le plus audacieux et le plus résolu possible. La dictature du prolétariat, en effet, ne peut pas être imposée aux masses populaires. Elle ne peut se réaliser qu’en menant une bataille – une bataille acharnée à la tête des masses – en faveur de toutes les revendications, toutes les exigences et tous les besoins transitoires des masses. » [6]
En 1938, dans le Programme de transition, le document central du Congrès fondateur de la IVe Internationale, Trotsky formulait encore plus concrètement les tâches des communistes dans les pays fascistes :
« Une fois qu’il aura éclaté au grand jour, le mouvement révolutionnaire dans les pays fascistes prendra d’un seul coup une envergure grandiose et, en aucun cas, ne s’arrêtera à des tentatives de faire revivre un quelconque cadavre [de régime démocratique-bourgeois]. [...]
« Cela ne signifie évidemment pas que la IVe Internationale rejette les mots d’ordre démocratiques. Au contraire, ils peuvent, à certains moments, jouer un rôle énorme. Mais les formules de la démocratie (liberté d’association, de presse, etc.) ne sont pour nous que des mots d’ordre passagers ou épisodiques dans le mouvement indépendant du prolétariat, et non un nœud coulant démocratique passé autour du cou du prolétariat par les agents de la bourgeoisie (Espagne !). Dès que le mouvement prendra un quelconque caractère de masse, les mots d’ordre transitoires se mêleront aux mots d’ordre démocratiques : les comités d’usine surgiront, il faut le penser, avant que les vieux bonzes se soient mis, de leurs bureaux, à l’édification de syndicats ; les soviets couvriront l’Allemagne avant que se soit réunie à Weimar une nouvelle Assemblée constituante. Il en sera de même pour l’Italie et les autres pays totalitaires et semi-totalitaires. »
Il est clair que les communistes italiens, en 1943, auraient dû maintenir une complète indépendance de classe par rapport à la bourgeoisie – tout en étant les combattants les plus déterminés contre le nazisme et le fascisme. Dans ces conditions, il aurait fallu défendre des revendications démocratiques fondamentales, telles que l’abolition de la monarchie et la convocation d’une Assemblée constituante. Il aurait fallu appeler à une complète restauration des libertés démocratiques, comme le droit de se réunir, de manifester, de s’organiser en partis et en syndicats. À la campagne, les communistes auraient dû lutter pour une véritable réforme agraire, l’expropriation des domaines fonciers et la redistribution des terres.
Toutefois, ces revendications démocratiques auraient dû être combinées avec des revendications mettant au premier plan la question du pouvoir de la classe ouvrière : l’expropriation des capitalistes, le contrôle ouvrier dans les usines et la formation de conseils ouvriers comme organes de la lutte.
Le fait est que, de 1943 à la fin des années 40, un mouvement de masse pour des comités d’usine s’est développé dans les villes italiennes – cependant que, dans les campagnes, une vague d’occupation des terres se propageait.
Un programme offensif aurait permis de forger l’alliance de la classe ouvrière et des autres couches opprimées de la société italienne, en particulier la paysannerie, en les gagnant à la lutte révolutionnaire pour le socialisme.
Au lieu de cela, le PCI dirigé par Togliatti a développé la ligne d’une « démocratie progressiste », c’est-à-dire d’un régime de Front populaire (bourgeois) censé satisfaire les revendications des masses opprimées, dans lequel l’Assemblée constituante (un Parlement bourgeois) représenterait « le début d’une rénovation profonde et radicale de la vie du pays. » [7]
Le 22 avril 1944, conformément à cette politique, le PCI entre dans le second gouvernement Badoglio, au sein d’une coalition formée du Parti Socialiste Italien (PSIUP), des Libéraux, des Monarchistes et des Démocrates-Chrétiens. Togliatti y assume la fonction de vice-premier ministre.
Ce gouvernement intervient de façon décisive dans la stabilisation du capitalisme en Italie, ce qui passe par la reconstruction de l’État bourgeois. Aucune épuration sérieuse des fascistes n’est mise en œuvre ; les membres du haut commandement militaire ne sont pas inquiétés ; les organes de répression, à commencer par les Carabiniers, sont renforcés. Dès le départ, il s’agit d’un gouvernement de contre-révolution bourgeoise – à peine déguisée sous une forme « démocratique ».
Le mouvement des partisans
Au lendemain de l’armistice, un Comité de Libération Nationale (CLN) se met en place parallèlement au gouvernement bourgeois. Doté de structures régionales et provinciales, cet organisme est destiné à diriger les formations de partisans.

Ici aussi, le PCI adopte le modèle du « Front populaire ». Les partis qui constituent le CLN – le PCI, le PSIUP, les Démocrates-Chrétiens et trois autres partis bourgeois ou petits-bourgeois de moindre importance – y disposent d’une représentation égale. Le poids des partis bourgeois s’en trouve considérablement renforcé, alors qu’ils sont très minoritaires dans les brigades de partisans comme dans l’ensemble de la société. Le mécanisme des décisions unanimes procure un excellent prétexte aux dirigeants du PCI et du PSIUP pour renoncer à toute action estimée « trop audacieuse » par les partenaires bourgeois.
Ainsi, le CLN est loin de constituer l’embryon de soviets ; au contraire, c’est un instrument destiné à contenir le mouvement de masse des partisans. Reste à voir comment le PCI a pu jouer ce rôle contre-révolutionnaire.
Sous le fascisme, l’appareil clandestin du PCI lui a permis de se maintenir plus solidement que le Parti Socialiste. A la mort de Mussolini, le PCI devient le principal parti de la classe ouvrière. Il doit sa popularité au fait d’être considéré comme le parti qui a combattu la montée du fascisme, mais aussi à son statut de représentant direct de l’Union Soviétique.
L’écrasante majorité de ses militants sont novices en politique. On estime qu’au début de l’année 1943, le PCI comptait environ 6000 membres. En 1944, il monte rapidement à 501 000 et, en 1945, atteint le chiffre colossal de 1 770 000.
Ces jeunes et ces ouvriers sont remplis d’enthousiasme révolutionnaire, mais ils manquent grandement d’expérience.
Dans un contexte de critiques et d’explosions révolutionnaires de la base, la direction du PCI prend des mesures répressives contre les membres qui expriment des vues dissidentes. Elle les accuse de « sectarisme » ou de « trotskysme ». Mais pour l’essentiel, la direction s’efforce de tromper la base quant aux perspectives et aux tâches de la révolution.
Tel est le rôle de la théorie menchevique des « deux étapes » : les compromis du jour sont présentés comme nécessaires en vue du « règlement de compte » avec les capitalistes et des fascistes, promis pour la deuxième étape.
Dans le même temps, on promeut le mythe du prétendu « double jeu » de Togliatti. La politique opportuniste de la direction du PCI est présentée comme une série d’habiles manœuvres. La ligne officielle, très modérée, est censée tromper l’adversaire ; sous cette couverture, le parti se préparerait à la conquête du pouvoir dès que la situation le permettrait.
Ce « double jeu » vise à leurrer non la classe dirigeante, en réalité, mais les travailleurs et les partisans. Cela permet aux dirigeants d’éviter un affrontement direct avec les aspirations populaires – et, ainsi, d’empêcher la transformation des doutes sur la ligne du PCI en une opposition de gauche consciente.
L’opposition à la ligne du PCI
Outre les doutes et les critiques formulés au sein du Parti, l’opposition à la ligne de Togliatti s’exprime dans des organisations et des mouvements extérieurs au PCI.
Dans une certaine mesure, l’interdiction du PCI, en 1926, a interrompu l’histoire du mouvement communiste italien. Les nombreux militants entrés en résistance au cours des années noires du fascisme, comme ceux qui ont adhéré au communisme dans les mêmes années, ne connaissent à peu près rien de la rupture entre Staline et Trotsky, ni de l’élimination physique de toute la vieille garde bolchevique. Toutefois, à mesure qu’ils s’engagent dans la lutte politique, nombre d’entre eux redécouvrent les idées des fondateurs du Parti, comme Gramsci et Bordiga, ainsi que leur intransigeance de classe.
Ces militants reprochent au PCI sa politique de collaboration de classe, son acceptation de la monarchie et son manque d’internationalisme. Beaucoup font à juste titre le lien entre le combat contre le fascisme et la perspective d’une transformation révolutionnaire de la société.
Il ne s’agit pas de groupes insignifiants. À Rome, pendant la période de clandestinité, le Mouvement Communiste d’Italie, mieux connu par le nom de son journal, Bandiera rossa (Drapeau rouge), atteint une taille similaire à celle du PCI. En 1944, il compte toujours 5000 militants. A Turin, l’organisation Stella rossa (Étoile rouge) compte environ 2000 membres. Dans le sud, à l’été 1944, la Fraction de Gauche des Communistes et Socialistes italiens compte environ 10 000 militants, dont un millier à Naples. Ses fondateurs sont aussi les principaux dirigeants de la CGL Rossa (Confédération Générale du Travail – Rouge).
Mais la Fraction de Gauche est entravée par son sectarisme. Son refus de défendre des mots d’ordre démocratiques, par exemple, la coupe de cette large composante des masses qui rejoint la lutte révolutionnaire à l’occasion du combat contre le fascisme.
Les autres organisations qui se tiennent sur la gauche du PCI souffrent d’une compréhension déficiente de la nature de l’URSS. Pour elles, Staline poursuit la politique de Lénine ; Togliatti et les autres dirigeants du PCI ne feraient que trahir les directives de l’Union Soviétique.
Lorsqu’il apparaît clairement que le PCI et Moscou sont en parfait accord, nombre de ces groupes se retrouvent dans une impasse. L’autorité de Togliatti et des autres dirigeants du PCI est liée à celle de l’Union Soviétique et de l’Armée Rouge, qui est en train de vaincre le nazisme en Europe. Elle est donc au-dessus de toute critique aux yeux de la jeunesse et des travailleurs italiens.
Le problème fondamental est que Bandiera Rossa, Stella Rossa, la Fraction de Gauche et les autres organisations qui se tiennent sur la gauche du PCI ne disposent pas vraiment d’un cadre théorique alternatif au stalinisme. Quant aux militants qui se considèrent comme des trotskystes, ils sont peu nombreux et isolés.
Dans ces circonstances, le stalinisme s’impose comme la tendance politique dominante au sein du mouvement ouvrier italien – et ce, pour toute une période historique.
Mars 1944 : la grève générale
Lors des grèves de mars 1943, la digue qui retenait la classe ouvrière s’est rompue. Depuis lors, l’agitation se poursuit sans relâche. Mais c’est la reprise de la production sous l’occupation allemande à l’automne 1943, dans le but d’alimenter l’effort de guerre du Reich, qui ouvre une nouvelle étape de la lutte.
Après des semaines d’agitation et de réunions clandestines, le Comité secret d’agitation du Piémont, de Lombardie et de Ligurie – organisation promue par le PCI et le PSIUP – publie un manifeste appelant à la grève générale.
À 10 heures du matin, le 1er mars 1944, un an après les grèves de 1943, 300 000 ouvriers à Milan et 50 000 à Turin cessent le travail. Le mouvement ne mobilise pas seulement les ouvriers de l’industrie, mais aussi les travailleurs des transports et de l’imprimerie. La grève s’étend rapidement à beaucoup d’autres villes du nord de l’Italie.
C’est la plus grande grève organisée dans l’Europe occupée par les nazis. On estime qu’entre 500 000 et un million de travailleurs cessent le travail, ignorant le lock-out des patrons et les menaces des autorités fascistes et nazies.
La plateforme revendicative de la grève a un contenu clairement politique : le renversement du nazisme et du fascisme en est le principal mot d’ordre. Mais les masses comprennent aussi que la responsabilité de la guerre et de la misère n’incombe pas uniquement au fascisme, mais aussi aux capitalistes italiens qui ont choisi d’utiliser les baïonnettes nazies pour maintenir la paix sociale dans les usines.
Au cours de la lutte, les travailleurs formulent avec audace leurs propres revendications de classe. Ils posent directement la question du contrôle ouvrier. Les jours précédant la grève, un tract distribué par le comité de grève milanais avance les revendications suivantes :
« Rattrapage intégral du pouvoir d’achat ; suspension de tous les licenciements et réduction de la semaine de travail à moins de 40 heures ; libération de tous les partisans, qu’ils soient ouvriers ou non [...] ; arrêt des déportations de travailleurs vers l’Allemagne. [...] Création de comités de grève dans les ateliers ! Création de détachements ouvriers de défense contre la violence des fascistes et des nazis. » [8]
Une grève générale sous occupation militaire pose inévitablement la question de l’insurrection et de l’armement des travailleurs. Les ouvriers ont décidé de se mettre en grève avec la conviction que le mouvement des partisans soutiendrait leur action. Pourtant, l’intervention des Groupes d’Action Patriotique (les formations de partisans actives dans les villes) reste très limitée.
L’absence d’un soutien armé substantiel empêche les grévistes, à quelques exceptions près, de descendre dans la rue et de défier ouvertement les autorités d’occupation. La démoralisation gagne les travailleurs et la grève prend fin le 8 mars.
Lutte des classes et guerre de partisans
Ce n’est pas par hasard que les groupes armés de partisans font défaut. La coalition du CLN, y compris la direction du PCI, insiste sur le fait que la Résistance ne doit pas prendre un caractère de classe, mais seulement le caractère d’une lutte de libération nationale.
Dans ces conditions, le centre du conflit se déplace des villes vers les montagnes. Cela implique le transfert de cadres et de militants du parti vers la campagne – ou des usines vers les groupes armés.
Dans les ville s, l’action des partisans repose exclusivement sur le sabotage et les attentats. Les partisans doivent opérer dans la clandestinité et, de ce fait, sont isolés des grèves et des manifestations de masse.
s, l’action des partisans repose exclusivement sur le sabotage et les attentats. Les partisans doivent opérer dans la clandestinité et, de ce fait, sont isolés des grèves et des manifestations de masse.
Cet éloignement des villes n’a pas toujours été bien accueilli par certains des meilleurs cadres du PCI sur le terrain, comme on peut le voir dans un rapport d’Arturo Colombi, un militant turinois, le 27 novembre 1943 :
« Nos forces politiques sont terriblement réduites : les cadres intermédiaires font défaut et le fait d’expédier hors de Turin les meilleurs camarades, en affectant ceux qui restent au travail militaire, affaiblit la direction. Il ne reste plus qu’une poignée d’hommes qui, entre autres choses, sont complètement étrangers à l’environnement ou en ont été absents depuis des années. Aucun d’entre nous n’a jamais dirigé de grandes grèves, publié des journaux, etc. Vous nous bombardez d’incitations à tout donner au travail militaire et aujourd’hui nous voyons bien que nous aurions dû lui donner un peu moins, parce que la possibilité d’impulser dans un grand centre des grèves politiques de masse, la grève générale, etc., a une énorme répercussion sur la lutte générale. » [9]
Sous l’occupation militaire, la lutte armée des partisans est absolument nécessaire. Toutefois, la question qui se pose est celle-ci : de quelle stratégie a-t-on besoin pour orienter la lutte militaire d’ensemble ?
Il aurait fallu souder la lutte des travailleurs à celle des formations de partisans opérant à la campagne et dans les montagnes. Compte tenu de son rôle dans la production, la classe ouvrière devait être reconnue comme la force dirigeante de la lutte antifasciste. Les comités clandestins d’agitation auraient dû être transformés en embryons de conseils ouvriers, grâce auxquels les travailleurs conscients auraient pu diriger les grèves, organiser des détachements d’ouvriers armés et prendre en main la gestion de la production, dans le but de conquérir le pouvoir politique.
Les possibilités de construire de telles milices ouvrières étaient considérables. Dans les semaines précédant la libération de Rome, Bandiera Rossa a appelé à mettre sur pied une « Armée rouge » dans la capitale. Plus de 40 000 « camarades de toutes tendances communistes », y compris quelques officiers supérieurs de l’Armée, répondirent à cet appel, et pas moins que 34 divisions furent constituées. Mais les dirigeants du PCI étaient terrifiés par ce développement, et exercèrent une pression politique et matérielle maximale sur la direction de Bandiera Rossa. Ils allèrent jusqu’à menacer de couper l’aide provenant des Alliés. Au final, ils contraignirent Bandiera Rossa à renoncer à cette initiative.
« Libération nationale » contre guerre de classe
Le printemps 1944 donne à la lutte des partisans un élan considérable. La répression qui suit la grève de mars 1944 a pour effet de grossir les rangs des partisans, car elle force de nombreux ouvriers à rejoindre leurs brigades pour échapper à la déportation en Allemagne.
Autre facteur clé : le « Bando Graziani », la conscription obligatoire des jeunes Italiens dans la nouvelle armée du régime fasciste reconstitué dans le nord. Quiconque ne répond pas à l’appel aux armes encourt la peine de mort. Sur les 180 000 appelés, quelques dizaines de milliers seulement se présentent. Tous les autres désertent, et nombre d’entre eux vont rejoindre les premières brigades de partisans.
La milice des partisans compte près de 100 000 combattants à l’été 1944. Sa composition sociale est majoritairement prolétarienne, l’âge moyen est très jeune. L’idée que l’on se trouve à la veille de l’insurrection armée est communément partagée.
Dirigées par les communistes, les « Brigades Garibaldi » sont les plus nombreuses et représentent près de 50 % des forces des partisans. La radicalisation à gauche est de plus en plus évidente.
A ce moment, la direction du PCI use de toute son autorité pour contenir la mobilisation. Dans une de ses directives, Togliatti est très clair ; il recommande de
« toujours garder à l’esprit que l’insurrection que nous voulons n’a pas pour but d’imposer des transformations sociales et politiques dans le sens du socialisme et du communisme, mais que son but est la libération nationale et la destruction du fascisme. » [10]
Le PCI a toutefois du mal à empêcher la radicalisation. Comme l’écrit l’historien Claudio Pavone, le rouge est largement présent « dans la symbolique des foulards, des chemises, des étoiles, des marteaux et des faucilles, du poing levé et des chansons. »
Mais ce n’est pas du goût du commandant des Brigades Garibaldi de la Valteline :
« Enlevons les étoiles rouges immédiatement. Aucun autre signe que la belle cocarde tricolore ne doit être autorisé. Même chose pour les chants, qui doivent être à caractère national et non des chansons du parti. » [11]
La subordination du CLN aux partis bourgeois a des conséquences pratiques majeures, dont l’échec de la libération de Rome par les partisans. Les 4 et 5 juin 1944, Rome est libérée par les troupes alliées ; c’est la seule ville italienne d’importance à ne pas être libérée par les partisans.
La raison en est claire. Si la capitale du pays avait été libérée par la jeunesse et les travailleurs en armes, qui aurait pu arrêter un soulèvement populaire dans le reste du pays ? Ainsi, les démocrates-chrétiens et les libéraux, sur les conseils des Alliés et du Vatican, s’opposent aux plans de libération de la « ville éternelle » par les partisans.
Cependant, en dépit de la ligne conciliatrice adoptée par la direction du mouvement ouvrier, la base s’oriente de plus en plus vers une insurrection armée. Si le PCI avait lancé l’appel à l’insurrection entre l’été et l’automne 1944, les 100 000 partisans des montagnes et des campagnes auraient été rejoints par des millions de travailleurs qui n’attendaient que le signal du parti.
A l’époque, la résistance armée au nazisme et au fascisme n’est pas un phénomène exclusivement italien. Un mouvement de masse de partisans existe aussi en Grèce, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. En Yougoslavie, les partisans de Tito libèrent Belgrade le 20 octobre 1944 ; c’est le premier pas vers la libération de l’ensemble du pays.
L’armée allemande est repoussée sur tous les fronts ; les cas de désertion se multiplient. Mais c’est précisément à ce moment, au seuil de la victoire, que les armées alliées arrêtent brusquement leur progression, laissant isolés les partisans du nord.
Le 9 octobre 1944, à Moscou, Staline a donné l’assurance à Churchill que l’Italie resterait dans l’orbite de l’Occident. Il n’est donc plus nécessaire, pour les Alliés, d’avancer aussi vite que possible en vue d’étouffer les velléités révolutionnaires des partisans. Assurés que leur allié, Staline, saura retenir le mouvement, ils peuvent consacrer toute leur énergie à la stabilisation du régime bourgeois.
De fait, les Alliés abandonnent les partisans aux nazis. C’est à l’automne et au début de l’hiver 1944 que les nazis et les fascistes déchaînent leurs représailles les plus féroces – avec, entre autres, les 1830 morts des massacres de civils à Marzabotto, dans les Apennins bolonais, et les 560 morts de Saint’Anna di Stazzema, dans le nord de la Toscane.
En décembre 1944, la direction du CLN signe sa complète capitulation face aux impérialistes. L’accord, proposé par le commandement allié et signé par Pajetta, pour le PCI, garantit le désarmement total des partisans à court terme. En outre, selon l’accord, les dirigeants des partis antifascistes doivent être exclus du commandement militaire du CLN et y être remplacés par Cadorna, un ancien général fasciste.
Le 25 avril 1945, jour de la Libération
Les Alliés tentent d’appliquer à toute l’Italie la stratégie adoptée pour la libération de Rome, mais la pression de la base ouvrière et paysanne est trop forte.
Au printemps 1945, les effectifs des partisans atteignent les 240 000 hommes. Face au risque d’être submergé par l’élan révolutionnaire des masses, la direction du PCI s’efforce de maintenir le soulèvement dans un cadre bien déterminé. C’est dans cette perspective qu’il lance l’appel à l’insurrection.
Le CLN communique l’ordre par un télégramme codé devenu célèbre : « Aldo dit 26x1 ». Ce qui signifie : l’insurrection est programmée pour le 26 avril à 1 heure du matin. Mais « dans les faits », écrit Pietro Secchia, l’un des dirigeants communistes du haut commandement des Brigades Garibaldi, « les partisans se soulèvent presque partout avant l’heure prévue. » [12]
Dans la mesure où Togliatti veut donner à l’insurrection un caractère purement « national », il n’envisage pas que la classe ouvrière joue un rôle décisif, ni que les partisans soient davantage qu’une force auxiliaire des troupes alliées.
Néanmoins, les masses ouvrières jouent un rôle central. Le 18 avril, la grève démarre à Turin. Entre le 21 et le 23, Modène, Bologne, Ferrare, Reggio Emilia et La Spezia se soulèvent. Gênes est libérée entre le 23 et le 26 ; Milan le 25.
Milan est la plus grande ville de l’Italie du Nord ; en raison de son importance, cette journée du 25 avril sera choisie, après coup, comme la date symbolique de la Libération.
Le soir même, Mussolini s’enfuit de Milan et tente de quitter le pays par le nord. Avec 50 autres dignitaires fascistes, il rejoint une colonne allemande qui se replie vers la frontière suisse. Bien que la suite des événements soit controversée, on pense en général qu’ils ont été interceptés par des partisans communistes, le 27 avril, et exécutés le lendemain.
Dans la région du Piémont, l’insurrection n’est lancée que le 26 avril, mais la ville principale, Turin, est libérée par les travailleurs avant même l’arrivée des partisans.
L’historien Guido Quazza, à l’époque membre du Parti d’Action, un parti antifasciste petit-bourgeois, décrit ainsi la situation de double pouvoir qui s’instaure en avril 1945 :
« Avant le 25 avril, pendant dix jours, les troupes alliées étant encore loin, les masses laborieuses détiennent la réalité du pouvoir en Italie du Nord et ce sont elles qui, pendant un certain temps encore, bénéficient du soutien enthousiaste de la majorité de la population, du contrôle des usines et d’un grand mouvement paysan dans de nombreuses zones. » [13]
En d’autres termes, bien que le pouvoir officiel soit entre les mains de l’armée (celle des Alliés ou celle des nazis), le pouvoir réel est entre les mains des masses.
Toutes les villes et municipalités du nord sont libérées, avant l’arrivée des forces alliées, par les partisans et les masses ouvrières. Pour beaucoup, la libération du nazisme et du fascisme n’est que le premier acte ; le second doit être la révolution communiste. L’appel à prendre le pouvoir est attendu avec impatience. Les travailleurs des villes, les paysans et les ouvriers agricoles ont dressé des listes de patrons et de propriétaires fonciers auxquels réclamer des comptes.
L’humeur des masses est bien résumée par un membre du PCI de Bologne :
« Mais nous voulions détruire la propriété privée, nous voulions que le travail soit la propriété de tous, le droit de tous. Nous aspirions à une société sans exploités ni exploiteurs, et il me semble que nous en sommes encore loin. »
Dans le même sens, un métallurgiste de Reggiane se souvient :
« A cette époque, nous étions sans cesse en train de discuter du développement d’une société socialiste, sur le modèle de l’Union Soviétique. Nous étions convaincus que nous y arriverions bientôt et que nous construirions un homme nouveau : engagé, travaillant dur, capable de bâtir un monde sans exploités ni exploiteurs… » [14]
Cette « prochaine étape » était celle que les dirigeants du PCI et du PSIUP avaient promise. C’était pour elle que les « compromis temporaires » avaient été acceptés. C’était pour elle que beaucoup de partisans – hommes, femmes et jeunes – avaient sacrifié leur vie : les chiffres officiels sur la Résistance font état de 44 700 morts et 22 000 blessés.
La contre-révolution sous une forme démocratique
La bourgeoisie et ses partis sont trop faibles pour écraser eux-mêmes la poussée révolutionnaire des masses. Ils comptent donc, à titre transitoire, sur le « gouvernement du CLN » installé en avril 1945 – et sur les gouvernements de coalition qui suivront jusqu’en 1947 – pour rétablir l’ordre, tout en discréditant les dirigeants du mouvement ouvrier. Entre-temps, ils utilisent ce répit pour construire une « alternative modérée » autour du parti de la Démocratie Chrétienne (DC) nouvellement créé.
Comme c’est souvent le cas avec ces alliances de type Front populaire en période révolutionnaire, les représentants de la classe dominante préfèrent ne pas apparaître au grand jour. Ils laissent les dirigeants reconnus de la classe ouvrière faire le « sale boulot » à leur place, tout en dirigeant en coulisses la politique qu’ils mènent.
La coalition du CLN constituée dans la foulée de la Libération jouit d’une énorme autorité aux yeux des masses. La plupart des travailleurs estiment qu’avec comme chef du gouvernement Feruccio Parri, l’un des dirigeants des partisans les plus connus, la Résistance est arrivée au pouvoir.
La « gauche » dispose des postes les plus prestigieux dans le nouveau gouvernement. Parri est non seulement Premier ministre, mais aussi ministre de l’Intérieur ; le socialiste Nenni est vice-premier ministre chargé de l’épuration des fascistes, tandis que le PCI est représenté par Palmiro Togliatti (ministre de la Justice), Gullo (ministre de l’Agriculture) et Scoccimarro (ministre des Finances).
Le gouvernement du CLN donne l’impression d’être dans une position très enviable pour engager un changement radical. Les usines sont sous le contrôle des travailleurs ; les terres sont occupées par les paysans et les ouvriers agricoles. La bourgeoisie est en pleine débâcle.
Mais les dirigeants communistes et socialistes n’ont aucune intention de mener à bien une révolution. Au contraire, ils jouent les pompiers pour éteindre l’incendie.
Avant le 25 avril, l’état-major des Brigades Garibaldi se sent obligé de rappeler aux combattants qu’il leur est interdit d’exproprier « quiconque n’est pas pro-nazi ». Mais il est très difficile, en 1945, de trouver en Italie un seul capitaliste qui continue de s’afficher comme fasciste !
Le mot d’ordre de « démocratie progressiste » est central dans la ligne du Parti Communiste. Il est censé désigner une démocratie dans laquelle les masses opprimées auraient à jouer un rôle dirigeant, modifiant ainsi le rapport des forces en leur faveur. Cette formule va rester l’axe de la politique du PCI dans les décennies suivantes.
Fatalement, dans un régime de démocratie bourgeoise, la propriété capitaliste des moyens de production doit rester intacte. Mais toute l’histoire des sociétés de classe démontre qu’il n’est pas possible à deux classes dirigeantes de coexister. L’une finit toujours par l’emporter sur l’autre, et aucune classe ne peut dominer économiquement sans s’emparer aussi du pouvoir politique.
Les objectifs de la bourgeoisie sont pleinement atteints : les communistes jouent un rôle décisif dans la reconstruction de l’appareil d’Etat bourgeois au lendemain de la chute de Mussolini et de la libération du nazisme et du fascisme.
A leur plus grande honte, les dirigeants du PCI ont célébré cette période comme celle d’une transition victorieuse du fascisme à la « démocratie ». Il s’agissait en réalité de cette « contre-révolution sous le masque de la démocratie » que Trotsky avait anticipée dès 1930. Et pourtant, après l’assassinat de Trotsky en 1940, la direction de la IVe Internationale a mécaniquement répété qu’il serait impossible de restaurer en Europe des régimes de démocratie bourgeoise au cours de cette période.
Seul Ted Grant analysa correctement la nature du processus qui se déroulait. Comme il l’expliquait à l’époque :
« [Les capitalistes] trouvent un instrument commode, dans les organisations sociales-démocrates et staliniennes, pour faire barrage à la poussée révolutionnaire des masses et la canaliser vers les voies sûres et inoffensives de la collaboration de classe, sous une forme de Front populaire encore plus dégénérée que par le passé. Ainsi, ils combineront la répression et les réformes illusoires, écrasant les organes embryonnaires de pouvoir ouvrier et désarmant les masses, tout en proclamant leur désir d’un gouvernement “représentatif” et de libertés “démocratiques”. [...] La contre-révolution du capital dans sa phase initiale prendra bientôt une forme “démocratique”, peu de temps après l’établissement d’un gouvernement militaire. » [15]
La révolution trahie
Signée par Togliatti, ministre de la Justice, l’amnistie générale des fascistes permet à des milliers de ces criminels d’échapper à un procès. Par ailleurs, l’élimination de tous les préfets et commissaires de police issus de la Résistance, dès 1946, replace l’appareil d’Etat sous le contrôle de la bourgeoisie.
Le PCI ordonne aussi le désarmement des brigades de partisans et la restitution des usines occupées à leurs propriétaires « légitimes ».
Giorgio Amendola, figure clé de la droite du PCI et député de 1948 à sa mort, en 1980, expliquait en 1962 ce que furent les objectifs fondamentaux des dirigeants communistes dans la foulée de la Libération :
« Lors des journées d’insurrection, les patrons [...] avaient abandonné leur poste. Les ouvriers, les techniciens, les cadres, rassemblés autour des Comités de Libération Nationale dans les entreprises, avaient pris la direction des usines. » Or, poursuit Amendola, l’objectif n’était pas « d’établir un régime de classe par l’élimination des propriétaires, mais de les remplacer dans l’intérêt de la communauté nationale. » Il s’agissait « d’obtenir le retour des propriétaires dans les usines [...] afin qu’ils puissent y assumer leurs responsabilités » et réinvestir « dans les entreprises le capital qu’ils avaient caché, en acceptant la surveillance des conseils de gestion. » [16]
Des « conseils de gestion » avaient surgi dans nombre d’usines désertées par leurs patrons. Mais les dirigeants du PCI insistaient sur leur caractère strictement « consultatif », tout en facilitant le retour des capitalistes. Bien sûr, Amendola ne s’étend pas sur le fait qu’une fois ces patrons revenus « assumer leurs responsabilités », ils ne tardèrent pas à licencier les ouvriers qui avaient joué un rôle essentiel dans la protection des usines lors du retrait des troupes nazies.
Au début de l’année 1946, en pleine crise inflationniste, le PCI approuve la fin du gel des licenciements. Quant à la réforme agraire, bien que passée dans la loi, elle n’est pas appliquée.
Aux élections de juin 1946 pour l’Assemblée constituante (qui coïncident avec le référendum sur l’abolition de la monarchie), la Démocratie Chrétienne arrive en tête. Le PSIUP est le premier parti de gauche à Milan et à Turin ; il obtient 21 % des voix au niveau national. Le PCI arrive en troisième position avec 19 %. La « gauche » confirme sa force dans les villes et au nord, mais elle paie le prix de sa politique de collaboration de classe.
Un gouvernement d’« unité nationale » est formé pour conduire la politique de la nouvelle République italienne. Il va durer jusqu’au voyage aux États-Unis de De Gasperi, Premier ministre démocrate-chrétien, en janvier 1947. Washington lui accorde un soutien total, y compris une aide financière dans le cadre du « plan Marshall », mais à condition que le PCI et le PSIUP soient écartés du gouvernement – ce qui est fait en mai 1947.
Le même processus se déroule dans toute l’Europe. Les coalitions issues de la Résistance prennent fin avec l’éviction des communistes et des socialistes. Le plus fort de la lutte des classes étant passé, les partis de gauche ont épuisé le rôle qu’ils pouvaient jouer pour le compte de la bourgeoisie.
1948 : une dernière opportunité
La longue période révolutionnaire prend fin en 1948. Le 18 avril, la gauche subit une défaite électorale : la liste commune PCI-PSIUP ne recueille que 31 % des voix, contre 48 % pour la Démocratie Chrétienne.
En dépit de ce revers, une nouvelle opportunité révolutionnaire se présente soudainement. Le matin du 14 juillet, Togliatti est gravement blessé par un anticommuniste fanatique. Du jour au lendemain, c’est toute l’Italie qui s’arrête. Il n’y a guère d’ouvrier, de paysan ou d’ouvrier agricole qui ne se joigne aux manifestations.
A Turin, toutes les usines sont occupées et gardées par des ouvriers en armes. A Gênes, les ouvriers occupent les places et les rues ; ils dressent des barricades. Ils l’emportent facilement dans les affrontements avec la police, tandis que les stations de radio et les journaux sont saisis par les insurgés.
A Milan, des centaines de milliers de travailleurs se rassemblent à Piazza del Duomo. Toutes les usines sont occupées. Sesto San Giovanni, la ville industrielle la plus importante de Lombardie, est entre les mains des travailleurs. La même situation se développe dans des villes de toute l’Italie, dont Bologne, Florence, Venise et Naples. A Rome, des affrontements avec la police éclatent dans tous les quartiers.
Une fois de plus, le PCI trahit l’élan révolutionnaire des masses. « Il ne faut pas céder aux suggestions insurrectionnelles », décrète la direction du parti.
Malgré cela, au cours des trois jours de grève générale qui suivent, la classe ouvrière montre qu’elle est fermement déterminée à aller jusqu’au bout. La petite bourgeoisie sympathise avec les travailleurs et la bourgeoisie se trouve impuissante, du moins les deux premiers jours. La police est débordée.
Ce qui manque, c’est un véritable parti communiste, une avant-garde révolutionnaire prête à diriger la classe ouvrière vers la conquête du pouvoir. C’est le facteur qui, tragiquement, a manqué tout au long de cette période extraordinaire.
Après la grève générale, la bourgeoisie se remet de sa frayeur, relève la tête et déclenche une répression impitoyable : il y a des milliers d’arrestations et des dizaines de milliers de licenciements.
Il ne fallut pas moins de 20 ans au mouvement ouvrier italien, jusqu’à « l’automne chaud » de 1969, pour se relever de cette défaite historique.
Aujourd’hui, 80 ans après la Libération, les contradictions sont explosives en Italie comme dans le reste du monde. De nouvelles situations révolutionnaires sont en train de mûrir. Cependant, le Parti Communiste Italien – dont les dirigeants exerçaient un contrôle quasi total sur la classe ouvrière – n’existe plus.
Il y a toujours besoin de construire un parti communiste, un parti doté d’un programme révolutionnaire, un parti ayant absorbé toutes les leçons de la révolution trahie de 1943-48, et qui les enseigne aux jeunes et aux travailleurs. Si un tel parti se construit en Italie, la prochaine période révolutionnaire verra la classe ouvrière conquérir le pouvoir et en finir avec le capitalisme une fois pour toutes.
[1] P. Badoglio, Italy in the Second World War, Oxford, 1948, p.15 [Traduction libre].
[2] P. Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, vol. 4, Einaudi, 1973, p. 186 [Traduction libre].
[3] T. Grant, « The Italian revolution and the tasks of British workers », Workers’ International News, Vol. 5, n°12, août 1943, p. 2-3 [Traduction libre].
[4] P. Togliatti, Da Radio Milano Libertà, Editori Riuniti, 1974, p. 113 [Traduction libre].
[5] US Congress, A Decade of American Foreign Policy, Greenwood Press, 1968, p. 12 [Traduction libre].
[6] L. Trotsky, « Une Lettre sur la révolution italienne », New International, Vol. 10, juillet 1944, p. 217-218 [Traduction libre].
[7] Il comunismo italiano nella seconda guerra mondiale, Einaudi, 1963, p. 107 [Traduction libre].
[8] in Città e fabbrica nella Resistenza. Sesto San Giovanni 1943-1945. Documenti, Istituto milanese per la storia della Resistenza e del Movimento Operaio, 1995, p. 56 [Traduction libre].
[9] P. Spriano, op. cit., vol. 5, p. 227 [Traduction libre].
[10] P. Secchia, Storia della Resistenza, Editori Riuniti, 1965, p. 509 [Traduction libre].
[11] C. Pavone, A Civil War : A History of the Italian Resistance, Verso, 2014, p. 472 [Traduction libre].
[12] P. Secchia, op. cit., p.1009 [Traduction libre].
[13] G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, Feltrinelli, 1976, p. 331 [Traduction libre].
[14] C. Pavone, op. cit., p. 428 [Traduction libre].
[15] T. Grant, « The Changed Relationship of Forces in Europe and the Role of the Fourth International », Writings, Vol. 2, Wellred Books, 2012, p. 176 [Traduction libre].
[16] G. Amendola, Lotta di classe e sviluppo economico, Editori Riuniti, 1962, pp. 30-32 [Traduction libre].