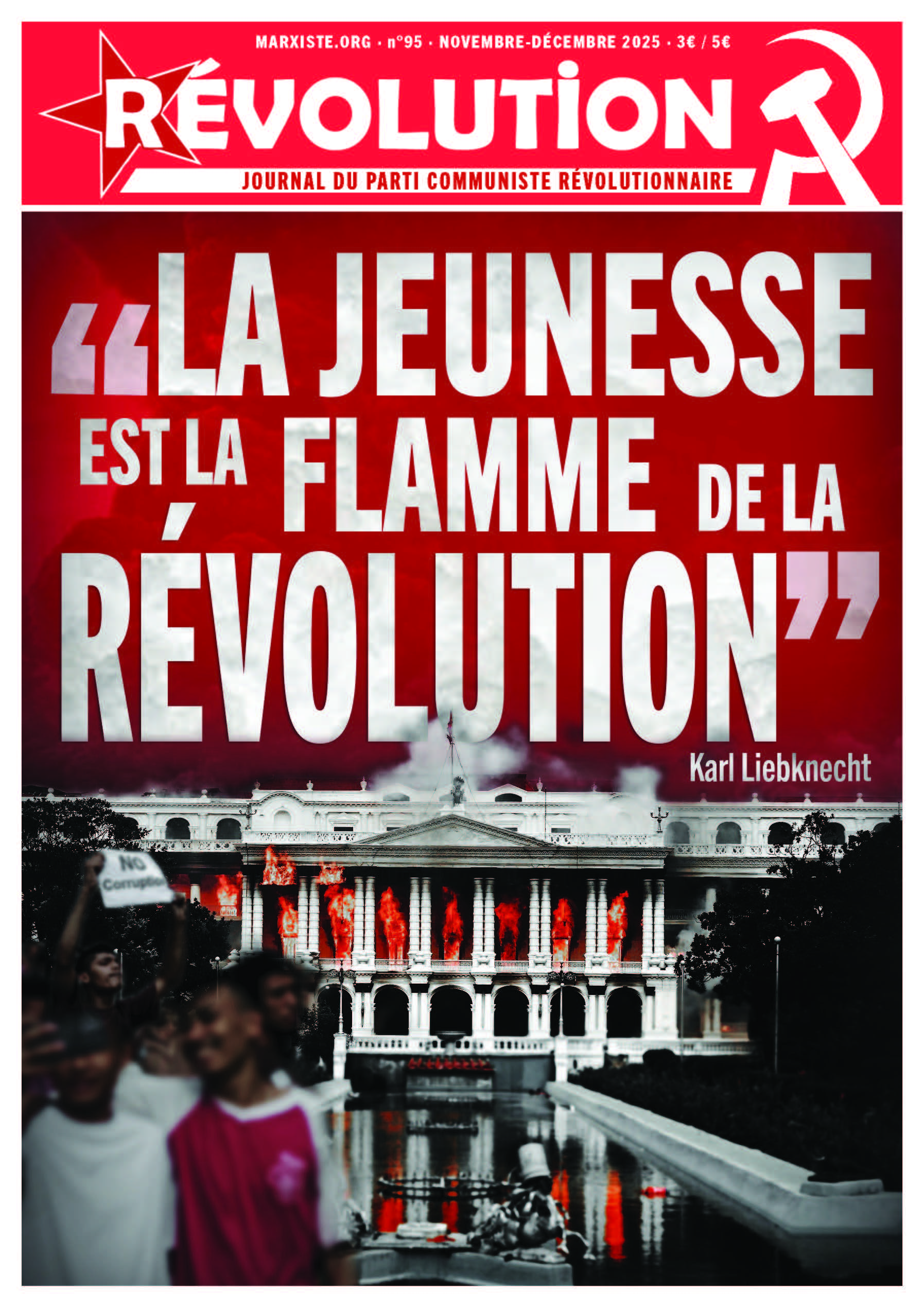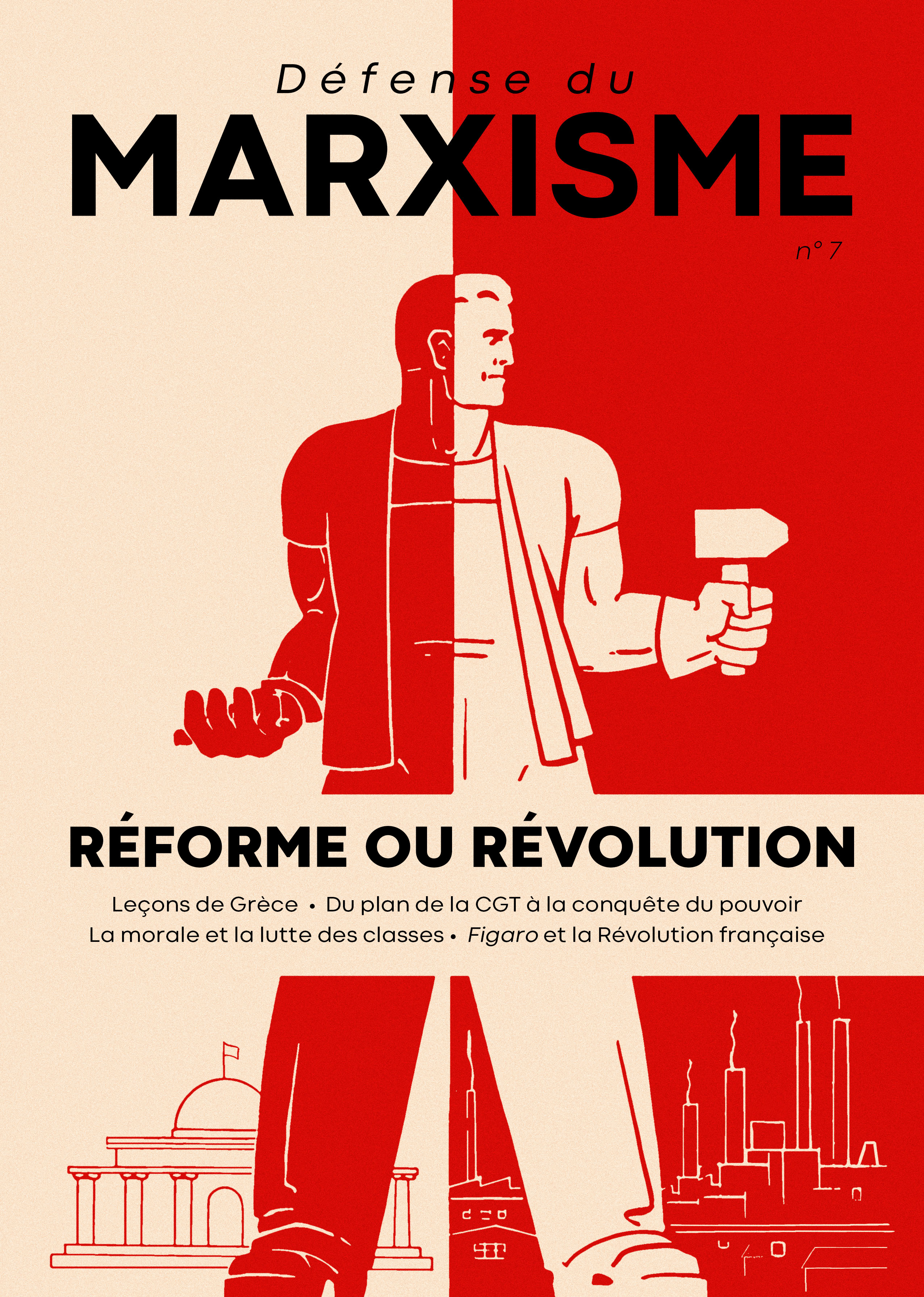La question qui nous est posée aujourd’hui n’est pas seulement théorique.
Avant la crise de 2008, les économistes et la classe dirigeante proclamaient avec assurance la fin des crises du capitalisme. Ils prédisaient une croissance stable et durable.
La récession mondiale de 2008 a montré que ces prédictions étaient erronées.
*
Les jeunes générations n’ont connu que la crise, le chômage de masse, la stagnation des salaires et l’augmentation du coût de la vie.
Les masses ont subis une série d’attaques sur leur condition de vie et de travail, en France et à l’échelle mondiale.
Les inégalités n’ont jamais été aussi fortes à l’échelle mondiale : 1,6 % des plus riches détiennent 48,1 % de la richesse globale. 40 % de la population ne possède que 0,6 % de cette richesse (Enquête UBS, 2025).
*
Mais pour bien comprendre les causes des crises sous le capitalisme, nous devons d’abord aborder deux questions essentielles :
Qu’est-ce que la valeur ? Et d’où vient le profit des capitalistes ?
*
I. Qu’est-ce que la valeur ?
L’œuvre maitresse de Marx sur l’économie, Le Capital, s’ouvre sur un simple constat : le capitalisme se caractérise par une immense production/circulation de marchandises.
Dans ce système, la production n’est pas directement dirigée vers les besoins des masses.
La production est dirigée vers la demande solvable. Lord Stokes (British Leyland) : « je fais de l’argent, pas des voitures ».
Les marchandises sont donc produites pour être échangées contre une marchandise spéciale, « l’argent », qui lui-même permet d’acheter tous les types de marchandises.
Argent : marchandise particulière : « équivalent universel ». Joue le rôle d’intermédiaire dans l’échange des marchandises.
Le problème du troc, cad de l’échange direct de marchandises : acheter une baguette avec… quoi ? Un briquet ? Une paire de chaussettes ? Peu de chances que ça marche !
*
Donc, Marx commence par une analyse de la marchandise : elle contient deux types de valeurs.
La valeur d’usage/valeur d’échange.
Valeur d’usage. « Utilité » au sens large (bijoux en or / pain). Sans valeur d’usage, fut-elle très subjective, pas d’échange possible.
Valeur d’échange. Plus difficile. Qu’est-ce qui la détermine ? (Faisons ici abstraction de l’argent).
Admettons qu’1 vélo s’échange contre 5 paires de chaussures ou contre 10 chemises.
Il doit y avoir quelque chose de commun qui détermine ce rapport d’équivalence entre 1 vélo, 5 paires de chaussures et 10 chemises.
Pas l’utilité. Par exemple : l’eau est moins chère qu’un bijoux – mais plus utile !
Ce n’est pas non plus la rareté : toutes sortes d’objet sont rares, et n’ont pourtant aucune valeur d’échange. Exemple : trèfle à quatre feuilles.
Réponse : toutes les marchandises sont le produit du travail humain.
Quantité de travail incorporée. Cette quantité se mesure en temps de travail.
*
Objection : travailleur fainéant, qui met 20 heures au lieu de 10 heures pour produire une marchandise donnée…
Mais celui qui mettrait 20 heures au lieu de 10 ne pourrait pas la vendre 2 fois plus cher.
Avec la concurrence, il serait ruiné.
Donc, valeur d’échange : temps de travail socialement nécessaire. A un niveau de productivité donnée, dans une société.
Bien sûr, le temps de travail socialement nécessaire à la production d’une marchandise donnée évolue constamment en fonction de la concurrence et des progrès de la technologie.
*
Quelle différence entre la valeur et le prix ?
Le prix : expression monétaire de la valeur d’une marchandise.
Mais attention : la valeur d’une marchandise n’est égale à son prix.
Fluctuations du prix autour de la valeur : rapport entre l’offre et la demande, rôle des monopoles…
Economistes bourgeois : prix fixé uniquement par le rapport offre / demande.
Faux : le prix fluctue autour d’un certain point (cad la valeur), qui est déterminé par la quantité de travail, etc. Un Airbus A380 vaudra toujours plus cher qu’une boite d’allumettes.
Analogie avec le phénomène des marées : elles sont plus ou moins importantes, mais cela ne change pas le niveau de la mer (abstraction faite des effets du réchauffement climatique !).
*
II. D’où vient le profit ?
Nous avons donc répondu à notre première question. Jusqu’ici, Marx s’est appuyé sur l’économie classique et ses principaux auteurs : Adam Smith et David Ricardo.
Le problème, c’est que Ricardo et Smith n’ont pas identifié l’origine des profits du capitaliste.
Seul Marx a su résoudre ce problème, car il comprenait l’économie non simplement comme une relation entre les choses, mais comme une relation sociale entre les deux principales classes sociales du capitalisme : la bourgeoisie et la classe ouvrière.
Marx ne se contente pas de décrire ce qu’on voit à la surface du système économique capitaliste.
Son but était de dévoiler les contradictions de ce système et les véritables rapports d’exploitation qui sont au cœur des lois fondamentales de l’économie capitaliste.
*
Alors, d’où vient le profit ? Réponse apparemment simple : du travail ! Mais cela n’épuise pas la question.
Si le capitaliste et le travailleur s’échangent deux valeurs équivalentes (« travail » contre « salaire »), d’où vient le profit ? Jamais l’échange de deux valeurs équivalentes ne peut créer un excédent, un surplus, une plus-value.
Solution : le capitaliste n’achète pas le travail, en réalité, mais la force de travail. Capacité de travailler. Or ça change tout.
La force de travail est la seule marchandise dont la consommation – le travail effectif du salarié – créé de la valeur. Or elle peut en créer davantage que sa propre valeur.
La valeur de la force de travail est déterminée (comme celle de toutes les marchandises) par le temps de travail socialement nécessaire à sa production = temps de travail socialement nécessaire à la production de toutes les marchandises dont le travailleur a besoin pour vivre et donc être en capacité de travailleur : nourriture, logement, vêtements, etc.
A quoi s’ajoute les frais de reproduction de la classe ouvrière : nourrir, vêtir, etc. les enfants d’ouvriers.
Eh bien, la valeur de la force de travail est une chose. Autre chose (potentiellement) est la quantité de valeur que cette force de travail peut produire.
Précisons que la force de travail est louée par le capitaliste – et non acquise pour toujours (sinon, c’est autre chose : de l’esclavage).
Si, sur une période donnée (un jour, une semaine, un mois : peu importe), la force de travail créé plus de valeur qu’elle n’en coute au capitaliste, celui-ci réalise un profit.
Les capitalistes n’expliquent jamais cela. Ils disent : « j’ai payé mes salariés à la hauteur de leur travail ».
Si on étudie une journée de travail d’un salarié :
|
SCHEMA SUR PAPIER D’UNE JOURNEE de 8 HEURES
Après avoir produit (en 4 heures, par exemple) la valeur de sa force de travail, cad la valeur de son salaire, le salarié continue de travailler. Le capitaliste ne dit pas : « c’est bon, maintenant tu peux rentrer chez toi ».
Il continue le travail de la même façon et sans discontinuité pendant 4 heures de plus (journée de 8 heures). Ces 4 heures de plus créent la plus-value.
Une journée de travail se divise donc en deux parties : une partie constitue le travail nécessaire, c’est-à-dire qui rembourse le salaire payé à l’ouvrier ; la deuxième partie constitue le surtravail, qui constitue le profit du capitaliste.
C’est en étudiant les rapports de production entre ouvrier et capitaliste, que Marx a découvert les origines de la plus-value. C’est à travers l’exploitation de la classe ouvrière que les capitalistes réalisent leur profit. Pour le dire autrement : la plus-value, c’est le travail impayé à la classe ouvrière. |
*
Les capitalistes produisent pour réaliser le maximum de plus-value, ils cherchent à accroître leurs profits le plus possible.
Nous comprenons alors la base économique sur laquelle se développe la lutte des classes : les capitalistes tentent constamment d’accroître la part de surtravail, tandis que les ouvriers tentent toujours d’augmenter la part de « travail nécessaire », cad le prix de leur force de travail (au détriment de la plus-value du capitaliste, forcément).
Le capitaliste à deux grands moyens d’augmenter la plus-value.
1° En augmentant la journée de travail – en passant de 8 heures à 10 heures – nous passons de 4 heures à 6 heures de surtravail. Nous parlons alors de plus-value absolue.
Mais l’augmentation de la plus-value absolue rencontre des limites physiques (on ne peut pas travailler 24 heures sur 24).
Marx décrit très bien cela dans le Capital : des jeunes enfants qui sont exténués par des journées de plus de 10 heures dans les usines.
Depuis, les capitalistes n’ont pas abandonné l’idée de nous faire « travailler plus » : depuis la fin des années 2000, le nombre d’heures travaillées est en hausse. Aujourd’hui, 54 % des salariés à temps complets effectuent des heures supplémentaires.
*
Comment les capitalistes peuvent-ils obtenir davantage de profits sans prolonger la journée de travail (ou sans baisser les salaires, ce qui revient au même : plus-value absolue) ?
2° En augmentant la plus-value relative, c.a.d en intensifiant l’exploitation des travailleurs. Cela revient à garder une journée de 8 heures, mais en réduisant la part de travail nécessaire. En conséquence, la part de surtravail augmente sans augmenter la journée de travail.
Avec une journée de travail de 8 heures, si nous réduisons le travail nécessaire de 4 heures à 2 heures, nous passons le surtravail de 4 heures à 6 heures.
Pour augmenter la plus-value relative, les capitalistes introduisent des machines qui permettent d’intensifier la production.
L’augmentation de la plus-value relative repose sur l’augmentation de la productivité du travail.
Prenons comme exemple l’industrie automobile : si Henry Ford a considérablement réduit le prix de ses voitures dans les années 1920, c’est en inventant des chaînes de montage qui ont permis de réduire les temps de production.
En 1908, il fallait 12 heures pour produire une voiture ; avec le modèle fordiste, un peu plus d’1 heures 30 était nécessaire pour en produire une.
Le même résultat peut être atteint en augmentant l’intensité du travail : augmentation des cadences, de la charge de travail, etc. C’est ce qui explique notamment l’augmentation des burn-out, et plus généralement du stress au travail.
*
III. Les crises de surproduction
Nous connaissons maintenant l’origine des profits des capitalistes.
Mais il faut souligner un point : à la fin de la journée, le capitaliste est seulement propriétaire d’un profit potentiel.
Pour que le capitaliste réalise un profit, il doit vendre la marchandise, c’est-à-dire l’échanger contre de l’argent. Tant que la plus-value est cristallisée dans une marchandise donnée (voiture, par ex), le capitaliste n’a pas réalisé son profit et ne peut donc pas le réinvestir.
C’est seulement sous forme d’argent qu’une partie de la plus-value va pouvoir être réinvestie par le capitaliste (l’autre partie étant consommée par le capitaliste).
*
En comprenant l’origine de la plus-value, Marx a pu comprendre pourquoi ce système économique finit toujours par traverser des périodes de crises.
Les capitalistes doivent vendre aux travailleurs eux-mêmes la plus grande partie des marchandises produites par les travailleurs – qui ne sont pas que des producteurs de marchandises, mais aussi des consommateurs.
Or, comme on l’a vu, les travailleurs n’ont reçu sous forme de salaire qu’une fraction de la valeur totale qu’ils ont créée.
Cette différence entre la valeur de leur salaire et la valeur totale des marchandises qu’ils ont créées finit nécessairement par se manifester sous la forme d’une crise de surproduction : le marché ne peut pas absorber l’ensemble des richesses produites par les travailleurs.
*
Les capitalistes préfèrent détruire des moyens de production en fermant des usines, licenciant des travailleurs, etc. – uniquement dans le but de sauvegarder la rentabilité de leurs investissements.
Karl Marx décrit très bien ce phénomène dans le Manifeste du PC où il compare les crises de surproduction à une « épidémie » qui purge l’économie de ces « excès » : aux yeux des marchés, il y a « trop » d’industrie, « trop » de richesse.
*
Nous devons cependant répondre à l’objection suivante : pourquoi pas de crises de surproduction en permanence ?
Il y a trois raisons fondamentales à cela :
- Tous les travailleurs ne produisent pas directement des biens de consommation.
Une faction significative des travailleurs produit des moyens de productions (usine, machine, outils, etc.) et non des biens de consommation.
Ces produits sont destinés aux entreprises, et non directement aux consommateurs.
Or, pendant qu’ils produisent des moyens de production, les travailleurs concernés par ce secteur sont payés et peuvent donc consommer des biens de consommation qu’ils n’ont pas produits.
- La deuxième façon pour les capitalistes de retarder les crises de surproduction est d’élargir leurs marchés au-delà des frontières de leurs Etats (Exemple : la France et la colonisation d’une grande partie de l’Afrique).
- Enfin, il y a le rôle du crédit, de la dette. Marx explique que le crédit permet de stimuler artificiellement la demande, et donc la production.
La dette peut temporairement relancer la production, mais elle amplifie les crises une fois qu’elles éclatent.
Ces différents facteurs ne peuvent que retarder la crise – au prix de l’aggraver.
Conclusion
Le socialisme : nationalisation des principaux moyens de production : les banques, les principales entreprises et industries seront sous le contrôle démocratique des travailleurs.
Sous le socialisme : il n’y aura plus de crise de surproduction, car la production et la consommation ne seront plus soumis à la course aux profits.
Donc il n’y aura plus de chômage de masse, et l’automatisation permettra à l’humanité d’échapper toujours plus au fardeau du travail contraint/pénible.
Les richesses créées ne seront plus accaparées par une poignée de parasites, mais bénéficieront à la population tout entière.
L’économie ne sera plus dirigée vers les profits de quelqu’un, mais vers les besoins de tous.
Le socialisme ouvrira la voie à une société réellement humaine : la baisse graduelle du temps de travail, permettra un accès massif à la culture, à la science à la philosophie, à l’art, et au sport.
*
Mais le capitalisme ne cessera pas d’exister par lui-même : il doit être renversé.
Pour cela, le révolutionnaire russe Léon Trotsky nous donne un précieux conseil : « Comprendre la situation présente, c'est déjà la moitié de la victoire ».
Comprendre la situation présente, c’est précisément le rôle de la théorie marxiste.
Il faut armer de ces idées les jeunes et les travailleurs – à commencer par les plus combatifs.
Nous devons les organiser, les former, et nous serons ainsi capable de construire un puissant parti révolutionnaire, qui nous permettra d’en finir une fois pour toutes avec les crises du capitalisme et ses conséquences sociales.