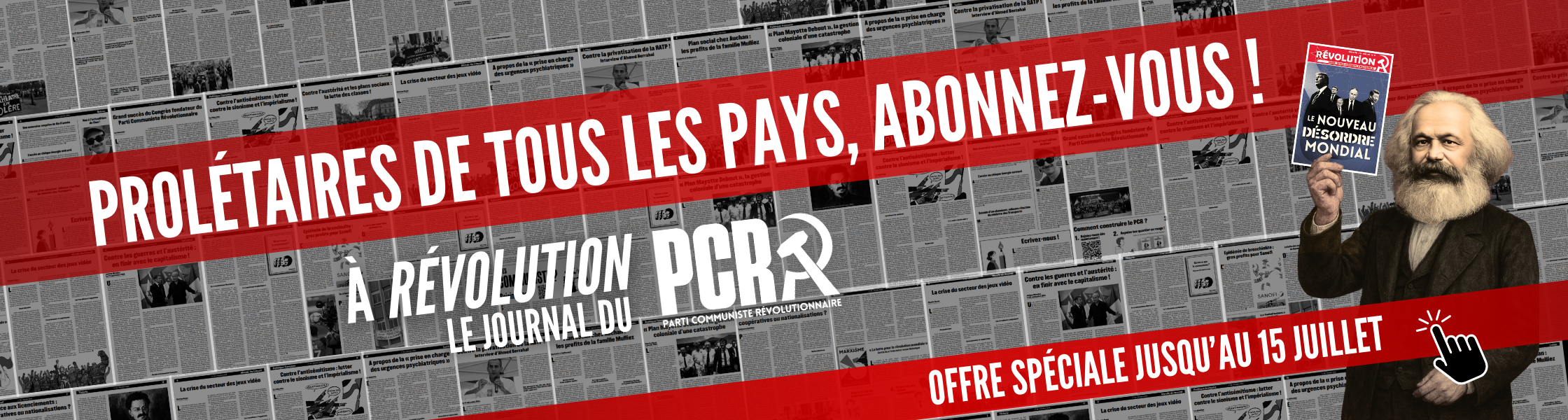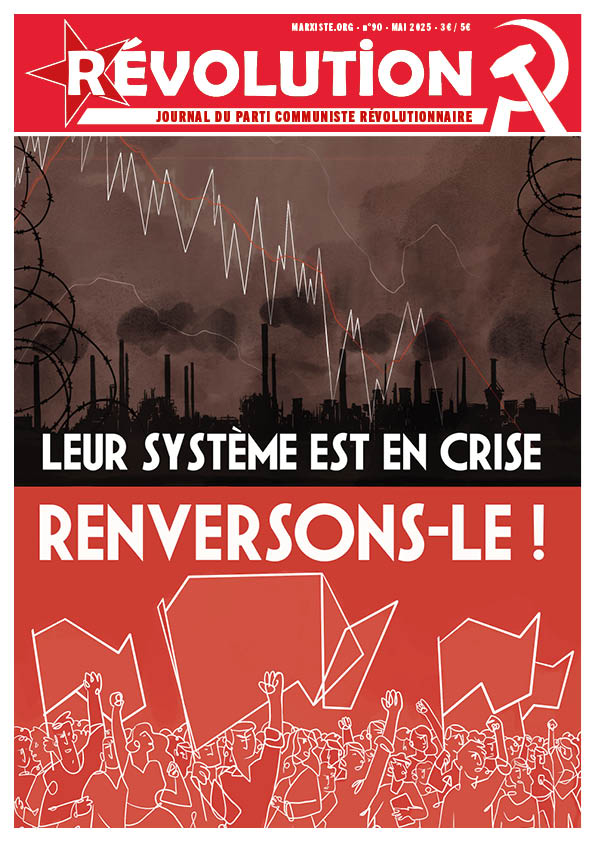En Corée du Sud comme ailleurs, la crise du capitalisme aggrave les violences sexistes et sexuelles. Deux affaires récentes ont donné un aperçu de l’ampleur et de la gravité de ce fléau social.
La première, dite des Nth Room, s’est déroulée entre 2018 et 2020. Sur la messagerie Telegram, des « salons » ont permis à plus de 260 000 hommes d’échanger des vidéos à caractère sexuel qui avaient été obtenues au moyen d’un chantage. Des femmes, souvent mineures, étaient forcées de se filmer en train de réaliser des actes sexuels, parfois jusqu’à l’automutilation, sous la menace de la diffusion de leurs données personnelles.
Cette affaire a été largement médiatisée ; un documentaire est même disponible sur Netflix. Plus de 100 victimes ont été identifiées. Les deux principaux instigateurs de ce trafic ont été jugés et condamnés, mais il est clair que cette violence numérique structurée, organisée, ne disparaîtra pas dans une société qui opprime systématiquement les femmes.
En août 2024, un nouveau scandale a éclaté, cette fois-ci autour de deepfakes pornographiques. Toujours sur Telegram, des « salles » virtuelles – liées à des établissements scolaires – étaient accessibles aux hommes capables de fournir des photos de femmes de leur entourage (amies, collègues, sœurs, etc.), accompagnées de leurs informations personnelles. En échange, ils obtenaient un accès illimité à l’ensemble des salons du réseau, sur lesquels étaient diffusées des vidéos pornographiques générées par l’intelligence artificielle, et parfois modifiées sur demande (poses, morphologie, vêtements, etc.).
Certaines « chatrooms », comme l’« humiliation room », contenaient des contenus particulièrement dégradants. Près de 400 établissements scolaires, de très nombreuses étudiantes et plus de 170 enseignantes ont été victimes de ce réseau.
Ces affaires font écho à celle des viols de Mazan, en France. La nature des faits et leur échelle ne sont pas les mêmes – mais il s’agit, dans tous ces cas, de véritables trafics organisés via internet, avec la complicité d’individus qui ne se connaissent pas et dont les profils sociaux sont très divers.
Ce que Révolution écrivait, à l’époque, s’applique aussi aux deux affaires sud-coréennes : « La grande diversité des profils des accusés confirme que nous n’avons pas affaire à une barbarie marginale, grouillant aux confins d’une société qui en serait globalement protégée. Non : le martyre de Gisèle Pelicot est organiquement lié à un ordre économique et social qui nourrit en permanence le terreau des violences faites aux femmes, qu’elles soient sexuelles ou non. »