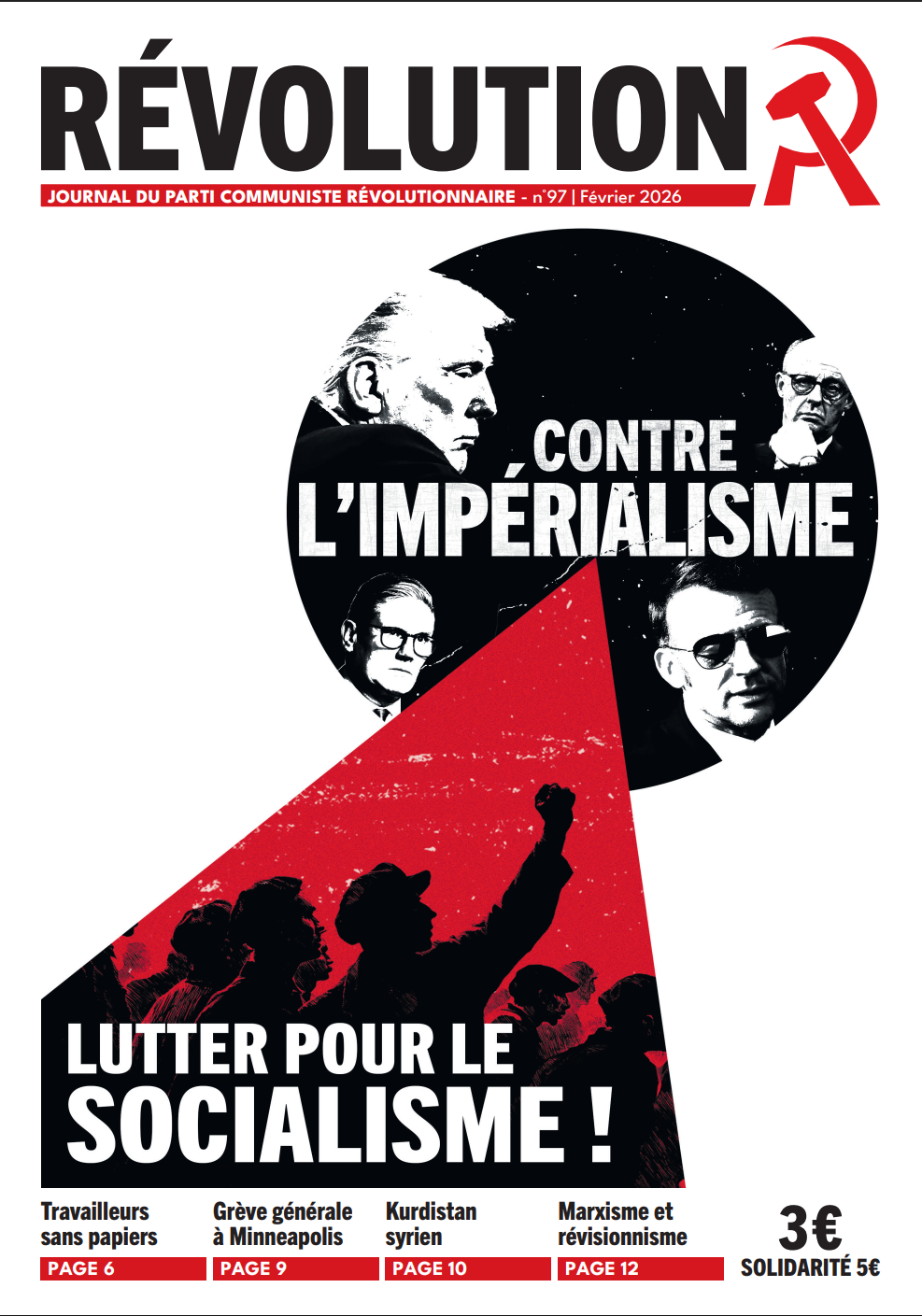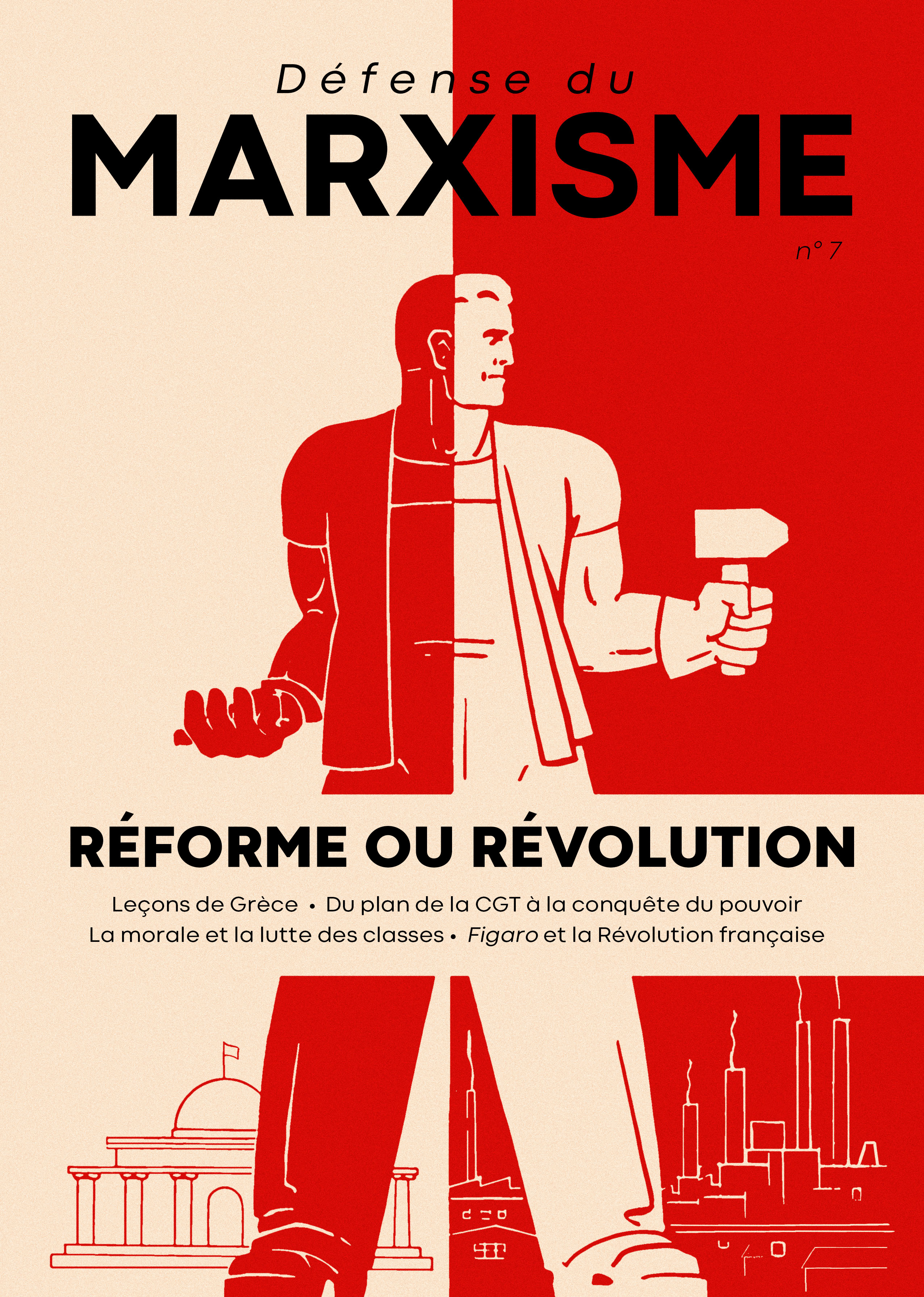« C’est eux les ennemis du peuple. » – Stepniak, vieux bolchevique.
Le réalisateur Sergei Loznitsa revient avec Deux Procureurs, un film glaçant sur les purges staliniennes de 1937 en URSS. Adapté du roman du même nom par Gueorgui Demidov, le film suit le parcours d’un jeune procureur soviétique récemment diplômé en droit, Kornev.
Sorti le mercredi 5 novembre dans les salles françaises, il dresse un portrait plutôt rare de la bureaucratie soviétique, sans filtres ni commentaires, à travers les yeux d’un jeune procureur sincèrement dévoué à la justice soviétique.
Le massacre d’une génération
Entre 1936 et 1938, l’Union soviétique a connu ce que l’historien marxiste Pierre Broué a appelé « le massacre d’une génération » : la liquidation systématique de vieux bolcheviks, de cadres ouvriers, de militants de l’Opposition de gauche, et en général de quiconque représentait une menace – réelle ou imaginaire – pour Staline et la bureaucratie. Cela concernait aussi bien les soi-disant « ennemis du peuple » que les « membres de la famille d’un traître à la patrie ».
Plus de 700 000 personnes ont été envoyées dans des camps de détention et de travail, où elles ont trouvé la mort soit par la faim, l’épuisement, les conséquences des blessures infligées par la torture, ou encore les brigades d’exécution.
Dans la première moitié des années 1930, l’autorité de Staline et de la bureaucratie était minée par le désastre provoqué par la collectivisation forcée des terres. Cette même bureaucratie avait aussi joué un rôle fatal – via la politique insensée de l’Internationale communiste – dans l’arrivée au pouvoir de Hitler et la destruction du puissant Parti communiste allemand. Par ailleurs, la nouvelle poussée de la révolution espagnole, en 1936, ravivait la flamme de la révolution internationale dans le cœur de la classe ouvrière soviétique. Staline était terrifié à l’idée qu’une nouvelle vague révolutionnaire, en Occident, n’attise les sentiments révolutionnaires des masses soviétiques et leur lutte contre la bureaucratie.
Pour consolider son pouvoir, Staline s’engageait dans la totale liquidation du Parti bolchevique à travers les Grandes Purges. Quiconque se souvenait des anciennes traditions démocratiques et internationalistes du léninisme était considéré comme un danger. Comme tout criminel ordinaire, Staline comprenait la nécessité d’éliminer tous les témoins des crimes de la bureaucratie. Ainsi, les purges marquaient l’aboutissement d’un processus décrit par Trotsky dans La Révolution trahie Pour comprendre toute l’histoire des événements qui ont conduit aux purges et ce que dépeint Deux Procureurs, la lecture de cet ouvrage de Trotsky est vivement conseillée. : la cristallisation d’une caste privilégiée, issue de l’Etat ouvrier, mais désormais hostile à sa base sociale. C’est dans ce contexte que se situe l’histoire des Deux Procureurs, qui se déroule au début de 1937 entre Briansk et Moscou.
La lettre sauvée du feu
Le film commence avec une lettre qui échappe à la destruction. Le nouveau procureur de la ville, Kornev, y découvre le témoignage d’un vieux bolchevik arrêté pour trahison, Stepniak, et décide de vérifier les faits en se présentant un jour aux portes de la prison. De cette enquête administrative naît un récit étouffant : des attentes et des démarches interminables – qui mènent Kornev à son destin.
En tant que spectateurs, nous savons plus ou moins où les vont les choses, car nous avons le recul de l’histoire. Ce n’est pas un film d’action classique ; il n’y a pas de grandes scènes dramatiques. Néanmoins, la tension monte lentement et inexorablement, entre Briansk et Moscou. Elle est entretenue par les scènes d’attente pénibles que Kornev doit endurer, et nous avec lui.
Le temps est lui-même un personnage du film. La lenteur imposée par le directeur de la prison, puis par le bureau du procureur général, est caractéristique de la monstruosité bureaucratique elle-même. L’attente devient une forme de domination bureaucratique : une manière de rappeler à chacun sa place, de briser toute action. Pour l’essentiel, l’histoire ne couvre que 48 heures de la vie de Kornev, mais l’incertitude qui plane sur ce qui va se passer est précisément ce qui crée la tension.
Les rouages du silence
Loznitsa ne commente rien : il filme les gestes, les silences, les attentes, les échanges de papiers, les regards vers les horloges, les portes qui s’ouvrent lentement. En observant sans juger, il laisse au spectateur le soin de constater la monstruosité du système – non à travers les cris, mais les silences.
Tout au long du film, chacun semble ne faire que son travail, conformément aux ordres donnés. Il n’y a pratiquement rien d’illégal qui soit montré, et nous ne voyons jamais de violence directe. Même la manière dont Kornev est livré à son destin, à la fin, se déroule sans cris ni coups de feu. La bureaucratie apparaît non pas comme une somme de décisions injustes, mais comme un organisme cohérent, autonome, où la peur circule comme un cachet administratif.
Comme procureur, Kornev n’est ni un héros ni un rebelle : il est un fonctionnaire sincère et appliqué, convaincu de servir la « justice socialiste ». Il croit que le droit soviétique est une arme du peuple, et c’est cette sincérité qui le condamne. Il représente une génération d’hommes honnêtes, au service de la construction du socialisme, qui constituent un danger aux yeux d’une bureaucratie engagée dans la plus grande campagne de diffamation et de terreur jamais lancée en URSS.
Kornev restait fidèle aux anciennes traditions de discussion ouverte et honnête, de démocratie ouvrière et d’autres principes élémentaires du marxisme authentique. Mais l’objectif central des purges était précisément d’éliminer toute trace des véritables traditions du bolchevisme, de rompre le lien avec cette histoire, de ne permettre à personne de rappeler aux générations futures la véritable signification d’Octobre 1917. Telle est la contradiction fatale que Deux Procureurs nous donne à voir sous une forme très concrète, mais d’autant plus glaçante et puissante.