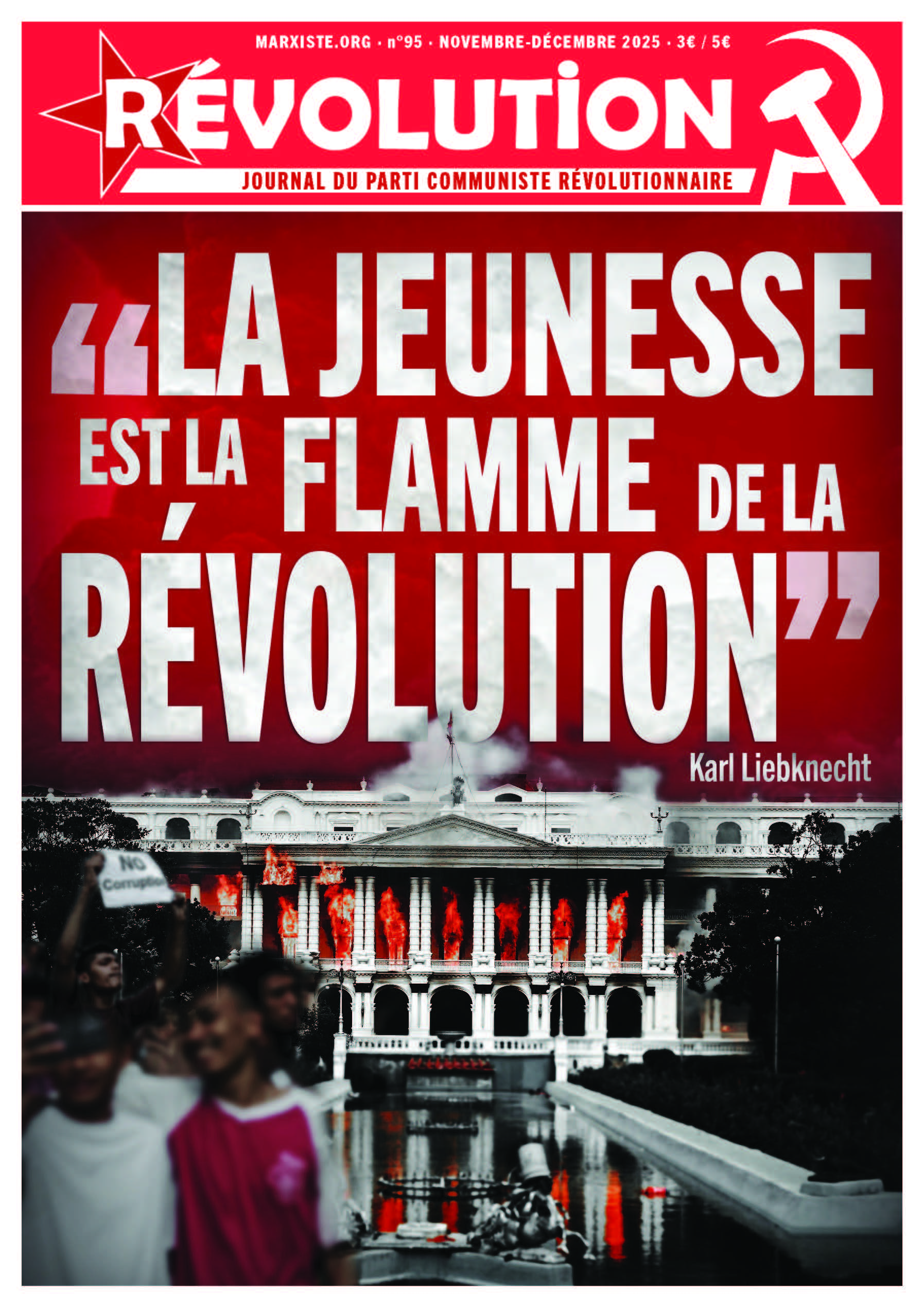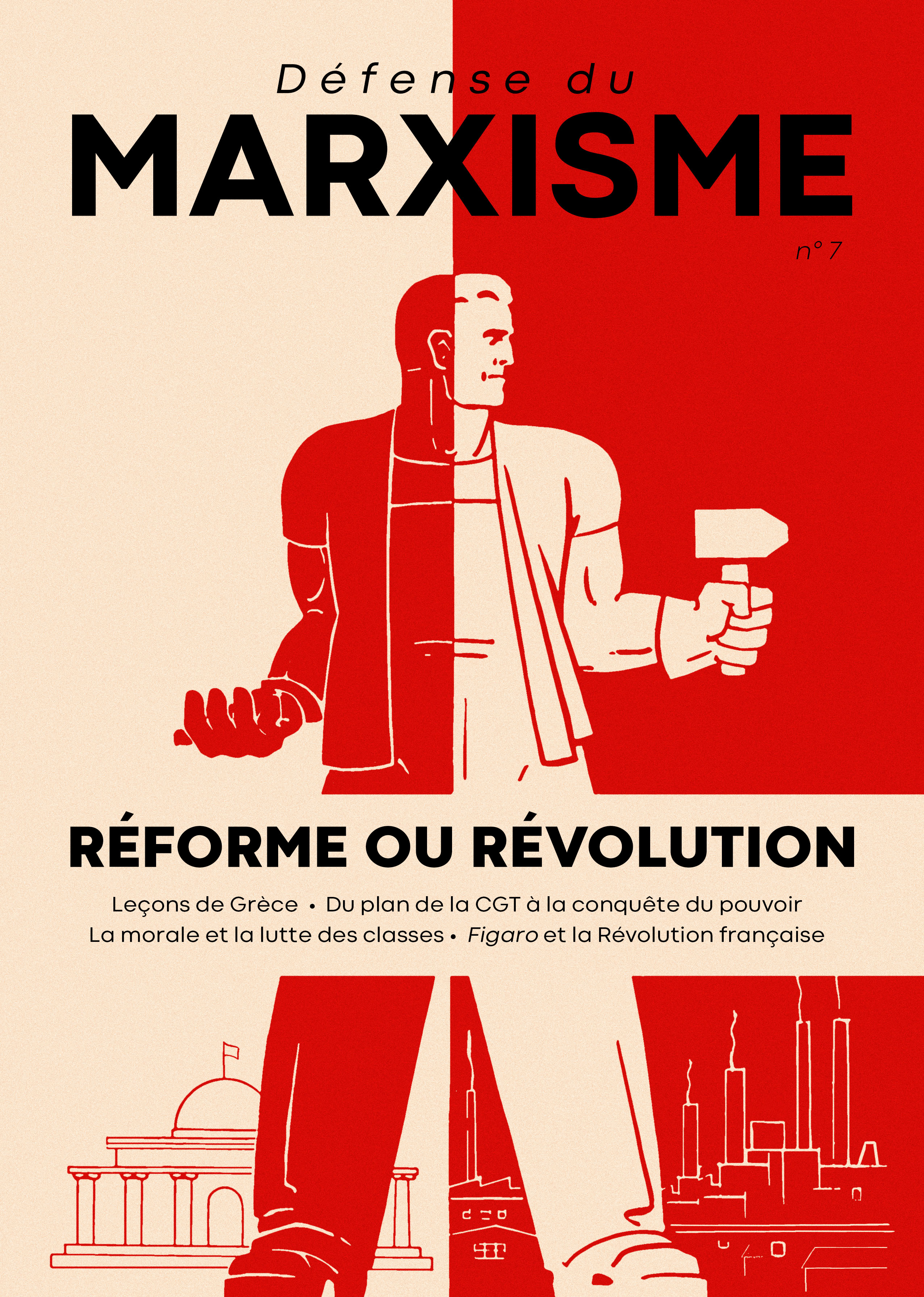J e travaille comme conducteur d’autobus et d’autocars au sein d’une des nombreuses entreprises privées qui exploitent les lignes urbaines, interurbaines et scolaires du pays d’Aix, dans les Bouches-du-Rhône. Je considère mon activité comme un métier de passion. Comme beaucoup de mes collègues, je suis non seulement féru de conduite, mais aussi très fier de rendre un service essentiel en transportant quotidiennement plusieurs centaines de personnes vers leurs lieux de vie, d’étude, de travail et de loisir. Je considère aussi que cette passion est indispensable pour quiconque veut exercer ce métier sur la durée : en effet, les conditions de travail et de rémunération d’un conducteur de bus sont si mauvaises que, sans passion, il est très difficile de tenir.
Un accès difficile à un travail précaire
Le transport routier de voyageurs est un secteur de plus en plus en tension, qui peine à recruter et à maintenir le personnel nécessaire à son bon fonctionnement, aussi bien au niveau national que dans la plupart des régions et localités. Cette situation s’explique en partie par la complexité de l’accès à ce métier. Dans la plupart des cas, il faut passer par une formation professionnelle exigeante, d’au moins 399 heures (réparties sur trois mois) et coûtant environ 8500 euros pour quiconque ne parvient pas à obtenir une aide financière de France Travail.
Une fois le diplôme en poche, ceux qui sont allés jusqu’au bout de cette aventure découvrent avec déception qu’ils ne peuvent prétendre qu’à un emploi précaire et mal payé.
Le salaire des nouveaux entrants dépasse rarement le SMIC, avec un taux horaire de 12 à 13 euros brut, soit un revenu situé entre 1400 et 1600 euros net par mois pour un temps plein de 35 heures.
De plus, si la plupart des régies de bus – qui sont publiques – affichent leur volonté de recruter de nouveaux conducteurs, elles sont réticentes à ouvrir de nouveaux postes à temps plein et en CDI. Pour mes nouveaux collègues, intégrer une régie signifie donc, bien souvent, enchaîner plusieurs contrats de trois mois sur des postes de remplacement, entrecoupés de longues périodes de chômage. Ce n’est qu’au bout d’un long moment, parfois plusieurs années, lorsqu’un recrutement interne finit par se présenter, qu’ils parviennent parfois à obtenir enfin un CDI.
Ce type de contrat est, en revanche, bien plus facile à obtenir lorsqu’on se tourne, comme je l’ai fait, vers les entreprises privées du secteur. Mais là encore, la précarité reste la règle, car ces CDI sont toujours des postes à temps partiel. La raison en est simple : les entreprises privées bénéficient d’abattements patronaux sur les contrats à temps partiel et sur les heures supplémentaires. Ainsi, si la plupart des salariés de mon entreprise sont officiellement embauchés pour 30 heures, nous dépassons en réalité tous largement les 40 heures de travail hebdomadaire… Et sur les heures supplémentaires, l’entreprise ne paye aucun impôt !
Journées interminables
La prédominance des heures supplémentaires, dans notre travail, a de nombreuses conséquences néfastes sur notre qualité de vie. Comme ce sont ces heures qui nous permettent d’atteindre un salaire décent, chaque mois, nous sommes toujours réticents à tout ce qui pourrait en réduire le nombre. Concrètement, cela signifie que nous devons mettre de l’argent de côté pour pouvoir prendre assez de jours de congé chaque mois.
Cette situation pousse certains collègues en difficulté financière à repousser sans cesse leurs vacances, voire à venir travailler malades. Pourtant, il est impératif que chacun puisse bénéficier d’un repos suffisant, tant nos conditions de travail sont exigeantes.
Les conditions de travail d’un conducteur de transport routier de voyageurs sont déjà difficiles en elles-mêmes. Conduire plusieurs heures par jour est une activité déjà éprouvante, physiquement. Dans notre cas, cela s’accompagne du stress lié aux dangers de la route, à la responsabilité de la sécurité des passagers et à la gestion des conflits ou des incivilités auxquels nous sommes quotidiennement confrontés.
Pour compenser la fatigue de la conduite, le Code de la route recommande aux automobilistes d’effectuer une pause de vingt minutes toutes les deux heures de conduite continue. Mais ce conseil de bon sens, adressé aux particuliers, n’est jamais appliqué aux conducteurs professionnels. Au contraire, les entreprises s’appuient sur des astuces juridiques et des textes de loi contradictoires pour pousser l’exploitation de leurs salariés jusqu’aux limites de ce qui est physiquement supportable – et cela, en toute légalité. Ainsi, il est fréquent que nos amplitudes de travail atteignent 13 heures par jour, comprenant 8 à 9 heures de conduite, parfois effectuées par blocs de 4 ou 5 heures sans la moindre pause.
Manque de moyens
La fatigue liée à notre métier est aggravée par le manque de moyens alloués à l’entretien et à la qualité des véhicules. Dans mon entreprise, pas un seul bus ou car n’échappe aux casses et aux défaillances techniques. Et même lorsque ces pannes semblent bénignes, elles peuvent représenter un grave danger pour la santé et la sécurité du conducteur et des passagers.
Chaque été, par exemple, les systèmes de climatisation tombent régulièrement en panne. Faute de réparations rapides ou de véhicules de remplacement, nous sommes contraints de rouler sans clim. De ce fait, la température se rapproche dangereusement des 40 degrés dans de nombreux véhicules aux heures les plus chaudes de juin, juillet et août. C’est très éprouvant et dangereux pour tout le monde.
Cette situation découle directement de la politique du moindre coût. L’entreprise achète ses véhicules aux prix – et donc à la qualité – les plus bas possibles, et prive les travailleurs de l’atelier des moyens humains et matériels nécessaires pour assurer des réparations rapides et efficaces. Là encore, si la loi impose un contrôle technique tous les six mois aux véhicules lourds, les entreprises disposent de nombreuses astuces pour dissimuler les dysfonctionnements et passer au contrôle des bus qui devraient, normalement, partir directement à la casse.
Pour un service public du transport en commun
La précarité et la maltraitance que nous subissons, mes collègues et moi, ont une origine simple à comprendre : c’est la logique de rentabilité des régies et des entreprises privées qui sont en concurrence pour l’exploitation des services de transport de voyageurs. La gestion des lignes urbaines, interurbaines et scolaires d’Aix-en-Provence et des communes alentour est depuis longtemps presque intégralement ouverte à la concurrence.
Tous les six à neuf ans, la métropole d’Aix-Marseille vend par lots ces lignes aux entreprises qui proposent l’exploitation la plus rentable, au prix d’une dégradation continue du service. Sur les lignes assurées par mon entreprise, il arrive régulièrement que des bus ne passent pas, ou accusent des retards de plusieurs dizaines de minutes, faute de personnel et de véhicules suffisants.
Les syndicats et les grands partis de gauche défendent souvent la nécessité de renforcer les contrôles administratifs et judiciaires sur les entreprises, pour lutter contre les abus. Mon expérience m’a convaincu de l’inefficacité de ces mesures. Ces contrôles existent déjà : la métropole d’Aix-Marseille inflige régulièrement des sanctions à mon entreprise, pour ses manquements. Les amendes atteignent parfois plusieurs centaines de milliers d’euros par mois. Pourtant, cela ne change rien à l’attitude de la direction. Pourquoi ? Parce que, d’une part, ces sommes ne sont qu’une part modeste des profits colossaux réalisés par mon entreprise. Et parce que, d’autre part, l’entreprise récupère l’argent perdu… sur le dos des salariés, au moins en partie. En effet, mon entreprise réagit immédiatement en diminuant ou en supprimant les primes de qualité dont bénéficient les salariés en reconnaissance de la bonne exécution de leur travail. Les profits des actionnaires ne sont donc jamais menacés : ces contraventions ne servent qu’à renflouer les caisses de la métropole en présentant la facture aux travailleurs.
Il est impératif d’organiser la riposte face à toutes ces pratiques. Cependant, la division des travailleurs du secteur en dizaines d'entreprises concurrentes est une difficulté à prendre en compte. Même quand une entreprise cède à une mobilisation locale et octroie des concessions substantielles à ses salariés, la baisse de compétitivité qui s’ensuit se traduit, invariablement, par la perte d’au moins une partie de ses lignes et la réaffectation d'une large couche de ses employés dans les entreprises qui les récupèrent. Ces dernières ne sont alors jamais bien longues à renégocier les contrats et à revenir sur les acquis obtenus précédemment.
Il faut en tirer les leçons. La stratégie actuelle des syndicats, qui consiste à limiter les revendications et les actions aux murs étroits des dépôts de bus ou des entreprises individuelles, revient à désarmer les travailleurs face aux manœuvres des patrons et de leurs complices dans l’administration. Ils devraient, au contraire, travailler à mobiliser l'ensemble des salariés du secteur autour d'un unique programme combatif.
Un tel programme ne peut s'articuler qu'autour de l'idée que la course aux profits des entreprises privées et les logiques austéritaires des pouvoirs publics domineront le secteur des transports en commun, il n’y aura aucune amélioration sérieuse, ni dans la qualité du service, ni dans les conditions de vie de ceux qui le font vivre au quotidien.
Il faut lutter dès à présent pour la nationalisation sans compensation de toutes les grandes entreprises privées du transport routier de voyageurs. Ces entreprises nationalisées doivent être fusionnées avec les régies pour former un service public unique des bus et des cars, contrôlé démocratiquement par les travailleurs et les usagers. Seules de telles mesures permettront de garantir aux conducteurs des conditions de vie dignes et d’assurer un service sûr, de qualité et gratuit pour tous.