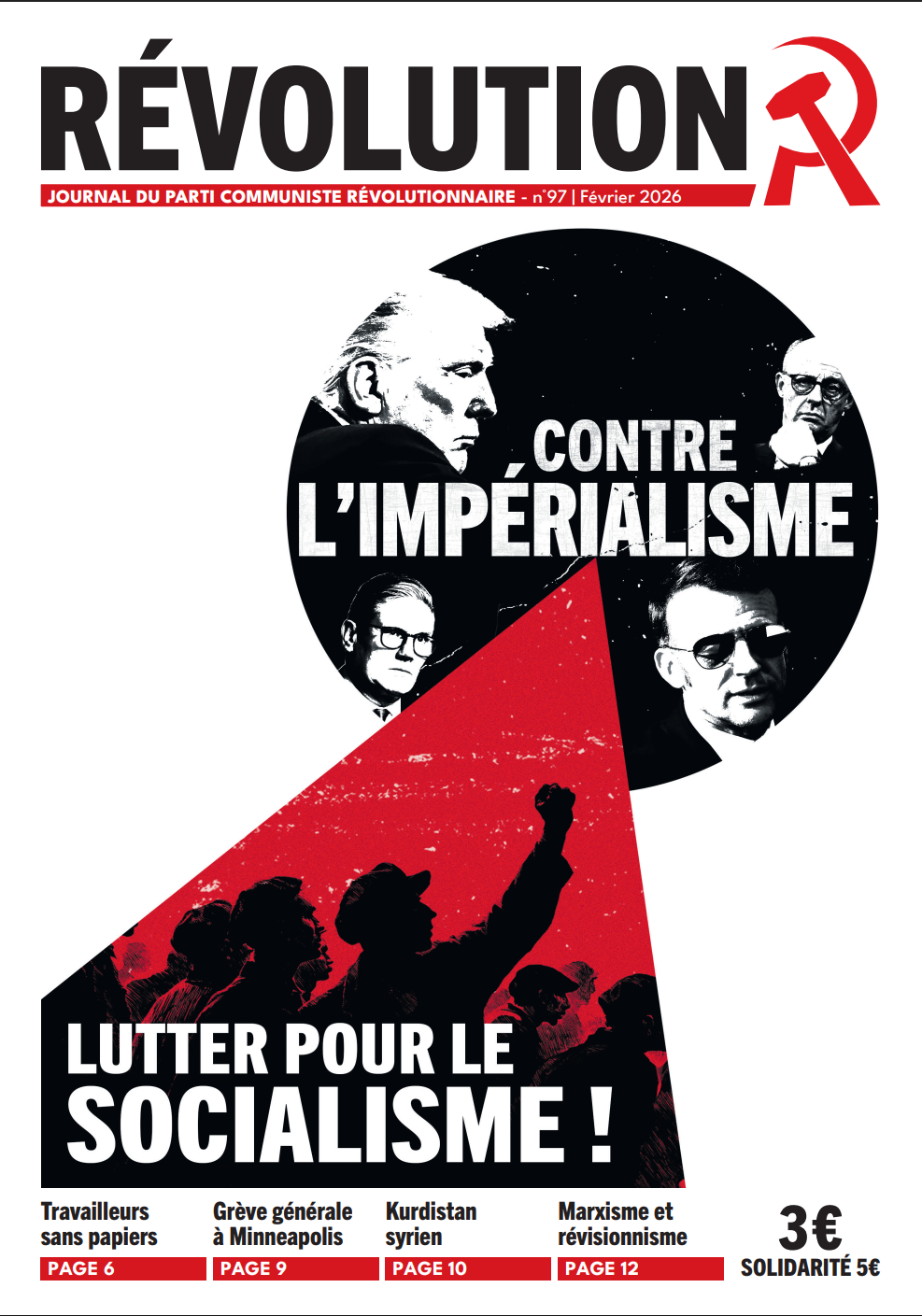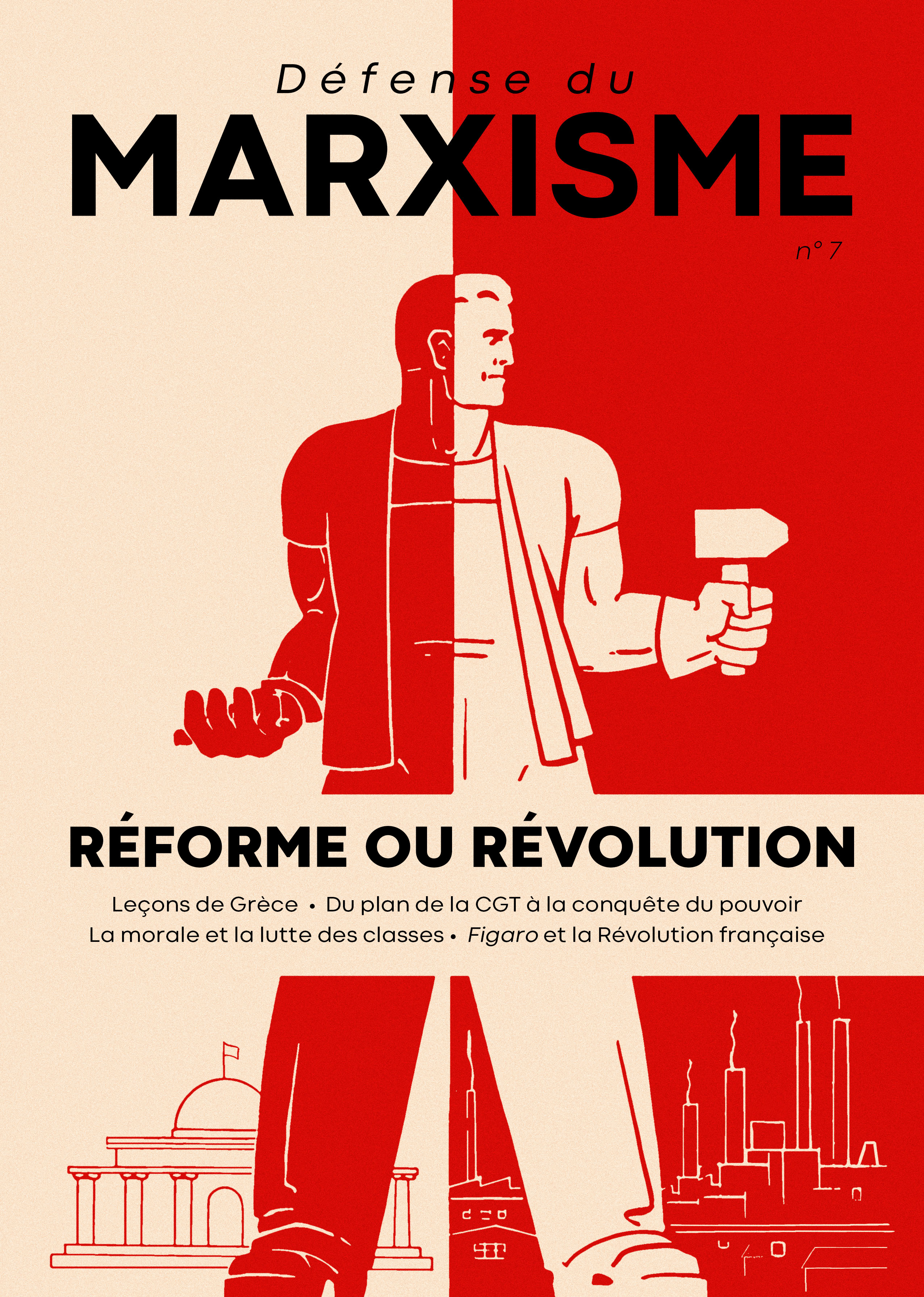Notre parti diffuse sous forme de brochure un long article d’Alan Woods intitulé Chostakovitch : la conscience musicale de la révolution russe.
Dimitri Chostakovitch (1906-1975) est souvent considéré comme l’un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Cependant, son œuvre est parfois l’objet de critiques motivées par des considérations politiques. Et pour cause : cet artiste soviétique était passionnément attaché aux idéaux de la révolution d’Octobre 1917.
L’article d’Alan Woods réfute deux thèses mensongères et symétriques : celle qui présente Chostakovitch comme un valet de la bureaucratie stalinienne, et celle qui en fait un admirateur du système capitaliste.
L’art et la bureaucratie
Sous Staline sévissaient les plus absurdes injonctions esthétiques issues du Comité Central lui-même, qui exigeait des artistes une expression simpliste du « folklore national » russe. Tout ce qui s’en écartait un peu trop était taxé de « formalisme bourgeois ». Chostakovitch, comme d’autres, dut confesser publiquement ce péché – le fusil sur la tempe – à plusieurs reprises. Ignorante, bornée, redoutant la force subversive de l’art authentique, la bureaucratie stalinienne sermonnait et menaçait régulièrement les meilleurs artistes soviétiques.
Chostakovitch « confessa », donc. Mais que valent quelques phrases d’autocritique forcée lorsque la musique, elle, continue d’exprimer avec sincérité les espoirs, les souffrances et les sentiments de tout un peuple ? Le compositeur prit sans cesse la bureaucratie à contre-pied.
Par exemple, sa Cinquième symphonie (1937) marque une évolution vers un style plus classique, moins moderniste. Mais le triomphalisme de son finale ne manque pas de sarcasme et d’ambiguïté. Comme l’écrit Alan Woods : « Staline parlait de la “vie heureuse” des Soviétiques – pendant que la folie de la collectivisation forcée provoquait une famine qui emporta quelque 10 millions de vies. Staline violait systématiquement chaque principe du léninisme et de la démocratie soviétique, mais dans le même temps caractérisait la Constitution de 1936 comme “la plus démocratique au monde”. Toute la situation se prêtait à la plus mordante des ironies. […] Chostakovitch lui-même dit un jour du finale de sa Cinquième : c’est comme si quelqu’un nous frappe la tête en criant : “Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous !” ».
Ce compositeur se fit mondialement connaître avec sa Septième symphonie (1941). Son thème est le siège de Leningrad et la lutte contre la barbarie nazie. Malgré sa santé fragile, Chostakovitch participa directement à la résistance du peuple de Leningrad. A la différence du finale de la Cinquième, celui de la Septième est exempt d’ironie : il exprime avec passion l’héroïsme des masses.
Mais deux ans plus tard, en 1943, alors que l’Armée rouge infligeait défaite sur défaite aux forces hitlériennes, Chostakovitch écrivit une Huitième symphonie très différente de ce qu’attendait la bureaucratie : « C’est une œuvre extrêmement sombre », explique Alan Woods. « Elle est comme un immense paysage dévasté par la guerre – et pas seulement par la guerre. Le premier mouvement, très long, montre progressivement vers un paroxysme qui est comme un cri de douleur et de détresse inouï. Ce n’est pas ce que les autorités voulaient entendre. Certains disent que le scherzo, rapide et violent, est un portrait de Staline. C’est possible. Ce qui est sûr, c’est que cette symphonie était un défi jeté aux autorités, qui l’ont bien compris. Elle fut interdite de représentation jusqu’en 1960. »
Alan évoque d’autres symphonies qui sont autant de critiques musicales du stalinisme : la Neuvième (1945), pleine d’une ironie espiègle ; la Dixième (1953), qui célèbre implicitement la mort de Staline ; la Onzième (1956), dont le thème est la révolution russe de 1905, mais dont le sous-texte est la révolution hongroise de 1956 ; la Treizième (1962), qui est une puissante protestation contre la propagande antisémite du régime.
Replis tactiques
Tout au long de sa carrière, Chostakovitch dut louvoyer, passant parfois à l’offensive, d’autres fois opérant un repli tactique pour gagner sa vie – et éviter de la perdre dans un peloton d’exécution. N’oublions pas que de nombreux artistes furent physiquement éliminés par la bureaucratie, dont Vsevolod Meyerhold, Isaac Babel et Ossip Mandelstam.
Alan Woods répond aux critiques contemporains qui, paisiblement installés dans leurs pantoufles, reprochent à Chostakovitch ses « compromissions » avec la dictature stalinienne : « Si un homme comme Rakovsky, ce vétéran du mouvement révolutionnaire doté d’une profonde compréhension du marxisme, si un tel homme a capitulé sous les pressions colossales de l’appareil stalinien, comment peut-on reprocher à Chostakovitch de ne pas avoir tenu tête ? Chostakovitch a plié sous la pression, mais n’a jamais rompu. Il demeura fidèle à lui-même jusqu’à la fin de sa vie, en adversaire résolu du stalinisme. »
De fait, Chostakovitch n’a jamais renoncé à la sincérité de son art, quitte à prendre d’énormes risques. Il infligeait des migraines à la bureaucratie chaque fois qu’une œuvre lui venait du cœur – et non d’un oukase du Comité Central. L’article d’Alan Woods replace ce compositeur à sa véritable hauteur, celle d’un génie qui, toute sa vie, lutta contre la bêtise, le mensonge, l’oppression et les injustices.