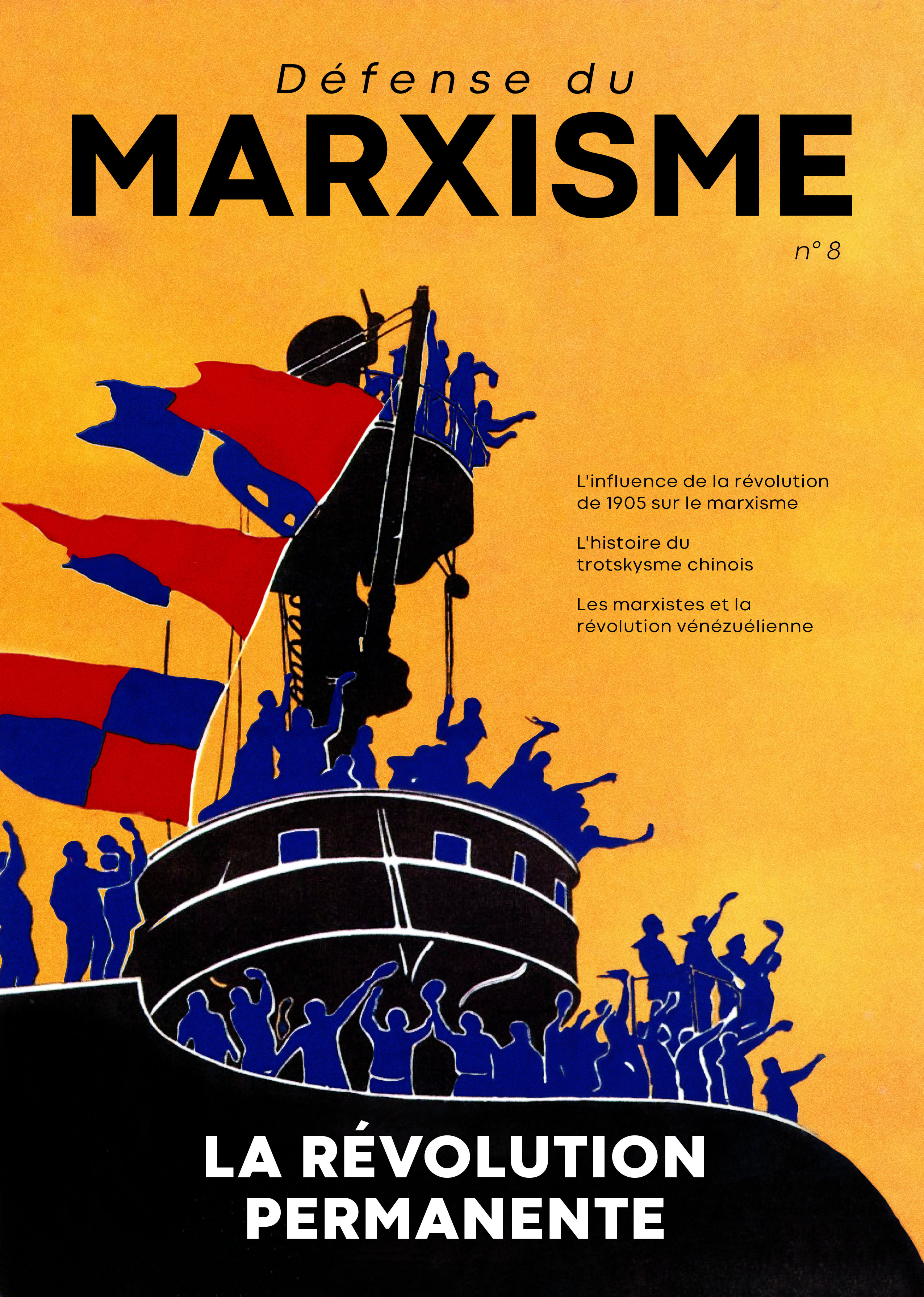L’agression impérialiste contre le Venezuela suscite des discussions, à gauche, sur la révolution qui s’est développée dans ce pays à partir de la victoire électorale d’Hugo Chavez, en 1998.
Pour clarifier cette question, nous republions ci-dessous l’excellent article d’Alan Woods, rédigé en mai 2004, qui était une réponse aux positions sectaires, ultra-gauchistes, d’un certain nombre d’organisations se réclamant du marxisme.
Sur le virage droitier du régime vénézuélien, sous la présidence de Nicolas Maduro, nous conseillons de lire notre article de 2018 intitulé : Venezuela : la crise économique s’aggrave - Quelle voie suivre ?
« Ceux qui espèrent voir une révolution sociale "pure" ne la verront jamais. Ces gens parlent sans cesse de révolution, sans comprendre ce qu’est une révolution. » (Lénine)
Il existe toutes sortes de marxistes : certains ont beaucoup lu, d’autres moins. Certains ont pris la peine de pénétrer l’essence de la méthode marxiste, d’étudier sérieusement la dialectique ; d’autres n’en ont qu’une connaissance superficielle et se contentent d’un déterminisme économique vulgaire qui, s’il peut servir à des fins d’agitation, est étranger au marxisme.
Lorsqu’on lit des écrits « marxistes » de ce genre, on a toujours l’impression de descendre dans l’obscur sous-sol d’une bibliothèque restée fermée pendant des années. C’est mal aéré, poussiéreux et stérile. Ce « marxisme » est dépourvu de dialectique, c’est-à-dire privé de son âme révolutionnaire. A ce titre, il est entièrement compatible avec le réformisme et la passivité, car en dépit de sa terminologie radicale, jamais il ne quitte son fauteuil ni n’ôte ses pantoufles.
Un révolutionnaire doit « sentir » le mouvement des masses et le porter en son âme. A l’inverse, les pédants studieux ne comprennent le processus historique qu’en termes de « forces objectives » déterminant tout à l’avance. Ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires, mais d’éternels observateurs dont le point de vue est beaucoup plus proche de la notion calviniste de prédestination que de la dialectique révolutionnaire du marxisme.
L’idée de prédestination a joué un rôle progressiste dans les premières phases des révolutions bourgeoises en Hollande et en Angleterre, aux XVIe et XVIIe siècles. Cependant, elle est aujourd’hui complètement obsolète. La dialectique marxiste accorde une grande marge de manœuvre à la créativité des hommes et des femmes dans le processus historique. Seulement, le marxisme précise qu’ils ne sont jamais tout à fait indépendants des circonstances objectives de la période historique dans laquelle ils vivent.
Un révolutionnaire doit comprendre la méthode dialectique, qui ne part pas de définitions ou d’axiomes abstraits, mais de la réalité vivante – avec toutes ses particularités, sa richesse et ses contradictions. Il doit aborder le mouvement des masses tel qu’il est, tel qu’il s’est développé historiquement, et s’efforcer d’établir un dialogue avec lui pour le fertiliser avec les idées du marxisme.
Celui qui n’est pas disposé à suivre les masses à travers ce processus contradictoire, et au lieu de cela se contente de réciter son prêche en marge du mouvement, celui-là n’a rien d’un révolutionnaire et tout d’un pitoyable formaliste. Une approche mécaniste et doctrinaire vis-à-vis du mouvement ouvrier exclut toute possibilité d’avoir sur lui une quelconque influence.
Le facteur subjectif
Le marxisme n’a jamais nié le rôle de l’individu dans l’histoire. A certains stades du processus historique, des individus ou des groupes d’individus peuvent jouer un rôle absolument décisif. Ce que Marx expliquait, à juste titre, c’est qu’en dernière analyse la viabilité d’un système socio-économique donné dépend de sa capacité à développer les forces productives. L’actuelle crise du capitalisme mondial reflète, au fond, l’incapacité de ce système à développer les forces productives comme auparavant.
Ce fait indéniable détermine le vaste contexte historique où se déroule le grand drame de la politique mondiale. Il détermine de façon absolue les processus généraux ; il en fixe les limites. Mais dans le cadre de ces processus généraux, il peut y avoir toutes sortes de développements contradictoires, de flux et des reflux, dans lesquels des individus peuvent jouer un rôle décisif.
De fait, la faiblesse du facteur subjectif – de la direction révolutionnaire – est un facteur décisif, dans la mesure où cela retarde et déforme le mouvement vers la révolution socialiste. L’absence d’une direction marxiste forte et influente est aujourd’hui le facteur le plus important, à l’échelle mondiale. La tendance marxiste authentique a été marginalisée pendant des décennies. Elle ne représente aujourd’hui qu’une petite minorité ; elle n’est pas encore en mesure de mener les masses à la victoire.
Cependant, les problèmes des masses sont intolérables. Elles ne peuvent pas attendre l’émergence d’une direction marxiste. Elles essaieront par tous les moyens de changer la société, de trouver une voie hors de l’impasse. C’est particulièrement vrai dans le cas des ex-colonies d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, où il n’y a aucune possibilité de faire avancer la société sur la base du capitalisme.
En l’absence d’une tendance marxiste de masse, toutes sortes de développements particuliers sont possibles et même inévitables. Il faut comprendre la nature de ces développements et distinguer, à chaque étape, ce qui est progressiste de ce qui est réactionnaire.
Pour un esprit sectaire, une révolution doit correspondre à un schéma préétabli. Par exemple, « elle doit être dirigée par un parti marxiste ». Nous sommes loin de sous-estimer l’importance vitale d’une direction et d’un parti révolutionnaires, mais pour construire un tel parti, nous devons évaluer de façon réaliste le stade atteint par le mouvement et le rôle que nous pouvons y jouer. Nous reviendrons là-dessus un peu plus loin.
Le problème de l’approche sectaire, c’est qu’elle substitue aux processus vivants des formules toutes faites, des définitions abstraites et des normes universelles. En d’autres termes, il s’agit d’une approche idéaliste et métaphysique – et non matérialiste et dialectique. Elle établit une norme idéale de ce qu’est une révolution et rejette tout ce qui ne correspond pas à cette norme. Pour un esprit idéaliste, c’est parfait. Mais on sait bien, depuis Platon, qu’une telle perfection idéale se heurte souvent à la réalité.
Le succès de la révolution serait effectivement garanti s’il existait un parti marxiste de masse capable de se placer à la tête de la classe ouvrière et de l’armer d’un programme adéquat. Mais la construction d’un tel parti ne peut pas se décreter. L’avant-garde révolutionnaire ne peut conquérir la majorité qu’en se soumettant à l’épreuve des événements et en gagnant la confiance des masses. Cela ne peut se faire en prêchant la bonne parole à partir du banc de touche. Et avant de pouvoir influencer les masses, il faut d’abord comprendre la nature de leur mouvement, le stade qu’il a atteint, les diverses tendances (contradictoires) qui coexistent en son sein, ainsi que la direction vers laquelle il évolue. Autrement dit, il faut une approche dialectique.
La première loi de la dialectique, c’est l’objectivité absolue. Quand on étudie un phénomène donné, on doit partir d’un examen rigoureux des faits, et non d’idées ou de définitions préconçues. Si l’on veut comprendre ce qui se passe au Venezuela et le rôle qu’y jouent des mouvements et des individus, il faut partir des faits eux-mêmes.
Telle était la méthode de Trotsky. Dans la préface de son Histoire de la révolution russe, il écrivait :
« L’histoire d’une révolution, comme toute histoire, doit, avant tout, relater ce qui s’est passé et dire comment. Mais cela ne suffit pas. D’après le récit même, il faut qu’on voie nettement pourquoi les choses se sont passées ainsi et non autrement. Les événements ne sauraient être considérés comme un enchaînement d’aventures, ni être insérés, les uns après les autres, sur le fil d’une morale préconçue. Ils doivent se conformer à leur propre loi rationnelle. C’est dans la découverte de cette loi intime que l’auteur voit sa tâche. »
Ces lignes sont une excellente formulation de la méthode dialectique. Les penseurs formalistes, à l’inverse, ne s’encombrent pas d’une étude rigoureuse des faits et des processus. Ils ne se donnent pas la peine, non plus, de découvrir les lois du mouvement d’une révolution donnée, car ils connaissent déjà – ou s’imaginent connaître – les lois de la révolution en général. Armés de cette « connaissance » très générale, ils n’ont plus besoin de perdre leur temps à étudier les faits. Ils se contentent de plaquer leurs idées et leurs définitions préconçues sur les faits, un peu comme un chimiste verse un liquide sur du papier pH : si le papier devient rouge, nous avons un liquide acide ; s’il devient bleu, le liquide est basique.
Une telle méthode est très simple, et même enfantine, de sorte qu’elle convient parfaitement aux petits enfants. Armé d’un tel « savoir », les formalistes peuvent facilement décider si ce qui se déroule au Venezuela – ou ailleurs sur le globe terrestre – est ou n’est pas une révolution. Perchés sur les hauteurs de l’Olympe, ils refusent d’accorder un certificat de naissance à la révolution vénézuélienne.
Qu’est-ce qu’une révolution ?
La faiblesse de la position des sectes sur le Venezuela – dans la mesure où elles ont une position – réside dans leurs idées préconçues sur ce qu’une révolution « devrait être », alors même qu’elles trahissent une complète ignorance de ce qu’est une révolution.
Qu’est-ce qu’une révolution ? Cette question élémentaire est rarement posée. Pourtant, si l’on y répond pas, on ne peut déterminer ce qui se passe au Venezuela.
Comme l’expliquait Trotsky dans son Histoire de la révolution russe, une révolution est une situation dans laquelle les masses commencent à prendre en main leur propre destinée. C’est clairement le cas du Venezuela aujourd’hui. La participation active des masses à la vie politique est la caractéristique la plus évidente de la révolution vénézuélienne, ainsi que le secret de ses succès.
Dans le même ouvrage, Léon Trotsky – qui, après tout, s’y connaissait en révolutions – écrivait :
« Le trait le plus incontestable d’une révolution, c’est l’intervention directe des masses dans les événements historiques. D’ordinaire, l’État, monarchique ou démocratique, domine la nation ; l’histoire est faite par des spécialistes du métier : monarques, ministres, bureaucrates, parlementaires, journalistes. Mais, aux tournants décisifs, quand un vieux régime devient intolérable pour les masses, celles-ci brisent les palissades qui les séparent de l’arène politique, renversent leurs représentants traditionnels, et, en intervenant ainsi, créent une position de départ pour un nouveau régime. Qu’il en soit bien ou mal, aux moralistes d’en juger. Quant à nous, nous prenons les faits tels qu’ils se présentent, dans leur développement objectif. L’histoire de la révolution est pour nous, avant tout, le récit d’une irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs propres destinées. »
Habituellement, les masses ne participent pas à la vie politique. Les conditions de vie sous le capitalisme placent sur leur chemin des barrières insurmontables : les longues heures de travail, la fatigue physique et mentale, etc. Les gens se contentent de confier à d’autres les décisions qui affectent leurs vies : au conseiller municipal, aux professionnels de la politique, aux permanents syndicaux, etc.
Cependant, à certains moments critiques, les masses font irruption sur la scène de l’histoire, prennent en mains leurs propres destinées. Elles cessent d’être des agents passifs du processus historique ; elles en deviennent les protagonistes. Il faut être particulièrement obtus pour ne pas voir que c’est précisément ce qui se passe au Venezuela. Ces dernières années, et surtout depuis le coup d’Etat manqué d’avril 2002, des millions de travailleurs et de paysans ont commencé à se mobiliser et à lutter pour changer la société. Si ce n’est pas une révolution, alors nous ne verrons jamais de révolution.
Au Venezuela comme ailleurs, les masses n’apprennent que graduellement, sur la base de leur propre expérience. La classe ouvrière doit passer par l’expérience de la révolution pour apprendre à distinguer les diverses tendances, les divers programmes et dirigeants. Comme l’expliquait Trotsky :
« Les différentes étapes du processus révolutionnaire, caractérisées par la substitution à tels partis d’autres toujours plus extrémistes, traduisent la poussée constamment renforcée des masses vers la gauche, aussi longtemps que cet élan ne se brise pas contre des obstacles objectifs. Alors commence la réaction : désenchantement dans certains milieux de la classe révolutionnaire, multiplication des indifférents, et, par suite, consolidation des forces contre-révolutionnaires. Tel est du moins le schéma des anciennes révolutions. »
Trotsky poursuit :
« C’est seulement par l’étude des processus politiques dans les masses que l’on peut comprendre le rôle des partis et des leaders, que nous ne sommes pas le moins du monde enclins à ignorer. Ils constituent un élément non autonome, mais très important du processus. Sans organisation dirigeante, l’énergie des masses se volatiliserait comme de la vapeur non enfermée dans un cylindre à piston. Cependant le mouvement ne vient ni du cylindre ni du piston, mais de la vapeur. »
Au Venezuela, précisément, le mouvement des masses constitue la principale force motrice de la révolution. Il est impossible de comprendre ce processus si on se limite à une analyse des dirigeants, de leurs origines de classe, de leurs déclarations et de leurs programmes. Ceux-ci sont comme l’écume de l’océan : ils ne constituent qu’un reflet superficiel des courants qui agissent dans les profondeurs.
Hugo Chavez
En l’absence d’un parti marxiste de masse, les forces de la révolution se sont regroupées autour de Chavez et du mouvement bolivarien. Hugo Chavez est l’homme au centre de la tourmente. On peut penser ce qu’on veut de cet homme, mais c’est lui qui a ouvert les vannes de la révolution. Il a osé se confronter au pouvoir de l’oligarchie et défier le puissant impérialisme nord-américain. Même ses ennemis et ses critiques reconnaissent qu’il a fait preuve d’un courage colossal. Ce faisant, il a libéré des forces énormes, retenues pendant des générations dans les profondeurs de la société vénézuélienne. C’est là un fait d’une immense importance.
Les masses sentent que le gouvernement est entre les mains de gens qui souhaitent défendre leurs intérêts. Jusqu’alors, le gouvernement a toujours été un pouvoir qui leur était étranger et hostile. Les masses ne veulent pas le retour des vieux partis corrompus. Les habitants des bidonvilles, les chômeurs, les travailleurs, les paysans, les indigènes et les noirs se sont arrachés à leur apathie et se sont levés. Ils ont découvert un nouveau sens à la vie, un nouveau sentiment de dignité, un nouvel espoir. Du jour au lendemain, ils sont devenus « chavistes », même s’ils ne comprenaient pas très bien ce que cela signifie.
Les masses n’ont peut-être qu’une très vague idée de ce qu’elles veulent vraiment, mais elles ont une idée très claire de ce qu’elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas le retour du vieil ordre, des vieux partis corrompus et des vieux politiciens capitalistes. Elles ont goûté à la liberté et ne veulent pas le retour du vieil esclavage. Elles aspirent passionnément à un changement fondamental de la société. Voilà ce que, pour elles, signifie le chavisme. Et dans leur esprit, ce grand rêve de changement s’incarne en un seul homme : Hugo Chavez.
Beaucoup de gens sont surpris par la ferveur – quasi-religieuse – que les masses vouent à leur président. Pour lui, elles sont prêtes à sacrifier tous leurs biens et à risquer leurs vies, comme elles l’ont fait en avril 2002. Cela représente un pouvoir formidable, qui explique que Chavez ait pu déjouer toutes les tentatives de le renverser. Le secret de son succès ne réside pas en lui-même, mais dans les masses, et c’est également la puissance des masses qui détermine le cours de la révolution et en constitue le principal moteur.
Les ennemis de droite de Chavez ne comprennent pas cela, car ils sont organiquement incapables de comprendre la dynamique de la révolution elle-même. La classe dominante et ses intellectuels n’accepteront jamais l’idée que les masses ont un esprit et une personnalité propres, qu’elles sont une force extrêmement créative, capable non seulement de changer la société, mais également de l’administrer. Ils ne peuvent pas admettre une telle chose, car s’ils l’admettaient, ils reconnaîtraient du même coup leur propre faillite et révéleraient qu’ils ne sont pas un groupe social indispensable, doué du droit divin de gouverner – mais, au contraire, une classe superflue et parasitaire, qui fait obstacle au progrès.
Les sectaires : incapables de comprendre
Mais ses ennemis bourgeois ne sont pas les seuls à ne pas comprendre la révolution vénézuélienne. Nombreux, à gauche (y compris des soi-disant marxistes), ont montré une semblable incapacité à comprendre ce qui se passe au Venezuela. Ces gens, qui se sont auto-proclamés dirigeants de la classe ouvrière, sont mortifiés et mystifiés par le soutien enthousiaste que les masses accordent à Chavez. Ils boudent dans leur coin, marmonnent quelque chose à propos du « populisme », et démontrent une incapacité absolue à se connecter avec le mouvement réel des masses. Telle est d’ailleurs, partout, la principale caractéristique des sectaires.
Ce qu’aucun d’entre eux ne comprend, c’est la relation dialectique entre Chavez et les masses. Ils ont une approche formaliste et mécaniste de la révolution. Ils ne la perçoivent pas comme un processus vivant, plein de contradictions et d’irrégularités. Comme elle ne s’ajuste pas à leurs schémas préconçus, ils lui tournent le dos avec mépris. Ils sont comme les premiers Européens qui ont vu une girafe – et se sont écriés : « Je n’y crois pas ! »
Une révolution ne se développe pas de façon harmonieuse, suivant un plan préconçu, ou à la façon d’un orchestre qui suit la baguette du maestro. Une révolution obéit à ses propres règles et ses propres lois internes. Or ces lois ne figurent dans aucun livre de cuisine révolutionnaire : elles trouvent leurs racines dans les contradictions de la société, qui s’élaborent graduellement à travers l’action collective des masses elles-mêmes, lesquelles n’apprennent pas dans des manuels, mais dans l’expérience de la lutte, ce douloureux processus fait d’essais et d’erreurs.
« Mais Chavez est un bourgeois », protestent les sectaires. Ces gens pensent toujours en termes simplistes : noir ou blanc, oui ou non, bourgeois ou prolétaire. C’est à ce type de formalisme que songeait le vieil Engels lorsqu’il citait la Bible : « Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. » A première vue, l’exigence d’une définition tranchée semble sage et raisonnable. Hélas, il n’est pas toujours possible de s’en tenir à définitions tranchées.
Même du simple point de vue sociologique, il est incorrect de dire que « Chavez est un bourgeois. » Il ne vient pas de la bourgeoisie, mais plutôt de la classe moyenne. Il se qualifie lui-même de paysan. Quoi qu’il en soit, d’un point de vue marxiste, cela n’épuise pas la question. La classe moyenne n’est pas une classe homogène. Ses couches supérieures – les riches avocats, médecins, professeurs d’université, etc. – sont proches de la bourgeoisie et la servent, en général. A l’inverse, ses couches plus basses – les petits commerçants, les petits paysans et les intellectuels de rang moins élevé – sont plus proches de la classe ouvrière. Dans certaines circonstances, ils peuvent être gagnés à la cause de la révolution socialiste.
Cependant, pour caractériser un parti ou un mouvement donné, les origines de classe des dirigeants ne sont pas décisives. En dernière analyse, ce qui détermine la nature de classe d’un mouvement politique, c’est son programme, sa politique et sa base sociale. On peut caractériser le programme et la politique du mouvement bolivarien, en gros, comme ceux de la démocratie petite-bourgeoise révolutionnaire. En tant que tels, ils ne vont pas au-delà des limites d’une démocratie bourgeoise très avancée. La révolution a mené à bien un programme ambitieux de réformes dans l’intérêt des masses, mais elle n’a pas aboli le capitalisme. Ceci constitue sa principale faiblesse – et la plus grande menace qui pèse sur elle, à l’avenir.
La question de l’Etat
« Mais l’Etat demeure bourgeois ! », insistent nos amis formalistes. Dans la mesure où l’oligarchie n’a pas encore été expropriée et où une grande partie du pouvoir économique reste entre ses mains – oui, le Venezuela demeure capitaliste, et nous devons pareillement définir la nature de classe de son Etat. En outre, une grande partie de la vieille bureaucratie reste en place : le système judiciaire est celui dont le régime a hérité, la police métropolitaine agit comme un Etat dans l’Etat, et la loyauté d’un certain nombre d’officiers n’est pas sûre. Cela signifie qu’un changement qualitatif n’a pas encore eu lieu, de sorte que la situation actuelle peut encore se retourner.
Cependant, la définition générale de l’Etat vénézuélien comme Etat bourgeois ne nous dit rien sur le véritable rapport de force, sur la réalité concrète de cet Etat, ou encore sur la façon dont la situation se développe. La vérité, c’est que l’Etat vénézuélien n’est plus sous le contrôle de la classe capitaliste. Pour tenter d’en reprendre le contrôle, l’oligarchie bourgeoise est obligée de recourir à des méthodes illégales et extra-parlementaires. La majorité des forces armées, y compris une importante section des officiers, soutient la révolution. Cela crée d’énormes difficultés à la contre-révolution, ainsi que des conditions potentiellement favorables pour ceux qui veulent pousser la révolution plus avant.
Lénine (après Engels) soulignait que l’Etat est, en dernière instance, un corps d’hommes en armes (l’armée, la police, etc.). Dans les périodes normales, l’Etat est sous le contrôle de la classe dirigeante. Mais dans les périodes exceptionnelles, quand la lutte de classes atteint des sommets d’intensité, l’Etat peut acquérir un degré important d’indépendance, et s’élever au-dessus de la société. Telle est la situation aujourd’hui au Venezuela.
L’argument suprême des sectaires concerne les forces armées : « Nous ne devons rien avoir à faire avec les officiers militaires », disent-ils. Ce n’est pas un argument, mais un préjugé stupide. Dans toute grande révolution, l’armée est affectée par le mouvement des masses. Elle a tendance à se diviser suivant des lignes de classes. Si ce n’était pas le cas, les révolutions en général seraient impossibles. L’effervescence révolutionnaire n’affecte pas uniquement les soldats ou les sous-officiers, mais aussi une partie des officiers. Dans des circonstances particulièrement favorables, nombre d’officiers peuvent refuser de lutter pour l’ancien régime, voire passer dans le camp de la révolution – comme fut le cas de l’officier tsariste Tukhachevsky, par exemple.
En outre, il est arrivé plus d’une fois qu’un mouvement révolutionnaire commence par le haut, par une révolte d’une section des officiers, avant de se répandre aux masses. C’est surtout le cas dans les vieux régimes en faillite et notoirement corrompus. L’histoire de l’Espagne du XIXe siècle est pleine de ce genre d’événements, connus sous le nom de pronunciamiento, et qui ont souvent ouvert les vannes de la révolution. Mais il y a d’autres exemples plus récents de ce même processus.
La révolution portugaise
La révolution bolivarienne a ses particularités propres, mais elle n’est pas absolument originale. En fait, toutes les révolutions ont des caractéristiques communes. Si ce n’était pas le cas, il serait impossible d’apprendre quoi que ce soit d’utile des révolutions passées. Mais c’est très loin d’être le cas. Il y a exactement 30 ans, au Portugal, s’est déroulé un processus remarquablement similaire à celui du Venezuela.
En 1974, le peuple portugais renversait la dictature détestée de Caetano et s’engageait sur la voie de la révolution. Comment cela a-t-il commencé ? Par un coup d’Etat mené par des officiers de gauche. Ceci n’est pas du tout conforme à la norme : généralement, les officiers jouent un rôle contre-révolutionnaire. Mais ici, la norme a été rompue. En 1975, le théoricien marxiste Ted Grant écrivait à ce propos :
« La véritable particularité de la révolution portugaise, si on la compare aux révolutions passées, réside dans l’implication de la masse des officiers de premier rang et de rang intermédiaire, et même de quelques généraux et amiraux.
« Si les pouvoirs de l’Etat, comme l’expliquaient Marx et Lénine, se ramènent au contrôle des corps d’hommes en armes, alors la décadence du régime portugais apparaît de la manière la plus flagrante. La bourgeoisie a tout misé sur son arme ultime : la répression féroce et totalitaire. En conséquence, pendant plus de deux générations, la bourgeoisie a perdu le soutien des classes moyennes, puis, par contagion, d’une grande partie de la caste des officiers. La guerre insensée menée en Afrique a joué un rôle, mais elle n’explique pas tout. Le massacre, plus absurde encore, de la Première Guerre mondiale n’a pas poussé la majorité des officiers russes à abandonner le tsarisme. Ils n’ont pas hésité à passer à la contre-révolution et à soutenir les guerres d’intervention contre leur propre pays.
« En 1918, la révolution allemande s’est heurtée au gros de la caste des officiers. La contre-révolution hitlérienne jouissait de l’appui d’une écrasante majorité des officiers. »
« Pendant la révolution espagnole de 1931-1937, 99 % des officiers se rangèrent derrière Franco. Et pour revenir au Portugal, en 1926, la grande majorité des officiers a soutenu Salazar. »
« Le pendule politique a violemment viré vers la gauche. Au cours des trois dernières décennies, même la petite-bourgeoisie portugaise a viré à gauche, comme le montre le mouvement étudiant. Au Portugal, l’impasse du capitalisme et la haine à l’égard des cliques du capital monopolistique, qui ont tiré leurs fortunes du sang et de la souffrance du peuple et des soldats, s’est reflétée dans l’isolement des cercles les plus riches. Ceux-ci ont profité du régime totalitaire et l’ont appuyé jusqu’au bout. La haine envers ces odieux parasites s’est étendue à des couches de la caste des officiers. C’est là une indication du fait que le capitalisme a épuisé sa mission historique, et devient toujours plus un frein à la production. Ainsi, au Portugal, même l’Etat-major s’est divisé, comme en témoigne l’épisode du malheureux Spinola. »
Ces lignes pourraient avoir été écrites hier à propos de la révolution vénézuélienne. La tendance marxiste a expliqué ce phénomène il y a des dizaines d’années, mais cela reste un livre fermé pour tous les sectaires et tous les formalistes, qui dès lors sont incapables de comprendre la révolution, sans parler d’y intervenir. Ils sont aveuglés par leur propre méthode formaliste, qui les empêche de voir ce qui se passe sous leur nez. Ils font constamment référence aux citations bien connues des classiques marxistes : « nous devons détruire le vieil Etat », etc. Mais entre leurs mains, ces formules scientifiques se transforment en incantations religieuses. Au lieu de nous aider à comprendre le processus réel, elles constituent un obstacle à toute compréhension.
En 1975, dans un document sur la révolution portugaise, Ted Grant écrivait :
« Marx disait que, dans les écrits denses et apparemment obscurs de Hegel, on peut entrevoir les processus complexes par lesquels une révolution survient à un stade donné de l’histoire. Or le génie créatif de l’histoire nous a offert le spectacle d’une révolution qui passe par le truchement des généraux et des amiraux ! La raison en est que le Portugal – pays semi-colonial et semi-impérialiste – se trouve dans une impasse, sous le capitalisme, depuis la perte de son empire. En même temps, l’expérience de 50 ans de dictature a complètement discrédité l’option d’une dictature militaire et bourgeoise, y compris parmi certains secteurs de la caste militaire. »
« Mais la raison principale du rôle énorme qu’ont joué les militaires est la paralysie des organisations ouvrières, du fait de l’absence d’un authentique parti marxiste. Dès le début de la révolution, le pouvoir de fait a été entre les mains des travailleurs et des soldats. Le Mouvement de Forces Armées (MFA) n’a fait que remplir le vide laissé par la faillite des dirigeants du Parti Socialiste et du Parti Communiste portugais. »
La nature a horreur du vide, dit-on, et cela vaut également pour la société et la politique. Dans certaines circonstances, en l’absence d’un parti révolutionnaire de masse, d’autres tendances remplissent ce vide politique. Après que les officiers portugais ont déclenché le processus, que les vannes de la révolution ont été ouvertes, les masses et la classe ouvrière ont marqué la révolution de leur empreinte. Au Portugal, toutes les conditions pour une révolution socialiste pacifique étaient réunies, surtout après le coup d’Etat réactionnaire du général Spinola, en mars 1975. Ce coup d’Etat fut très semblable à celui du 11 avril 2002, au Venezuela, et s’est terminé de la même façon. Comme l’expliquait Ted Grant :
« Face aux manifestations massives des travailleurs, les forces du coup d’Etat de droite se sont évaporées. Les parachutistes et les commandos sont en général la force la plus conservatrice de l’armée. Ils sont habituellement composés des éléments les plus aventuriers et téméraires de la population, formant une sorte de troupe de choc, la plus fiable et la dernière à se diviser (comme les cosaques en Russie). Et pourtant, lors du coup d’Etat de mars 75, les parachutistes portugais se tournaient vers les manifestants en leur criant : "nous ne sommes pas fascistes !" Ils ont fraternisé avec les travailleurs et avec les troupes du régiment d’artillerie. Certains leur ont même donné leurs fusils comme gage de leur bonne foi. »
« Quelques heures après le lancement du coup d’Etat, la base aérienne était reprise. Spinola et de nombreux officiers ayant soutenu le coup ont fui vers l’Espagne. Le coup tournait au fiasco. Sa durée peut être estimée en minutes plutôt qu’en jours. Ce fut peut-être la tentative contre-révolutionnaire la plus grotesque de l’histoire. Mais si ce fut un tel fiasco, c’est précisément du fait de l’atmosphère brûlante de la révolution, qui n’affectait pas seulement les travailleurs et les paysans, mais aussi pratiquement toute la base des forces armées. Il n’y avait pas, dans tout le Portugal, un seul régiment prêt à servir la contre-révolution. »
Encore une fois, ces lignes s’appliquent parfaitement au coup d’Etat d’avril 2002, au Venezuela. Et comme au Portugal, après la défaite du coup d’Etat, il aurait été possible de mener à bien une transformation pacifique de la société. Mais cela n’a pas été fait, et une opportunité très favorable a été gâchée. Ce fait souligne la nécessité d’une direction révolutionnaire expérimentée, dotée d’une ligne et d’une stratégie claires. Ces erreurs se paieront dans le futur, et leur montant sera très élevé.
Nos amis les sectaires s’écrient triomphalement : « Cela prouve que l’on ne peut faire aucune confiance aux officiers ! » Mais ce n’est pas une question de confiance. La confiance est une catégorie morale, et non scientifique. Ce qui est décisif, ce n’est pas le caractère moral des dirigeants, mais le programme et la politique qu’ils mènent. Nombre d’officiers portugais étaient des hommes honnêtes, qui se sont sincèrement placés du côté des masses. Ils voulaient mener à bien une profonde transformation sociale du Portugal, mais ne savaient pas comment faire.
La véritable responsabilité de l’échec de la révolution portugaise retombe, non sur les officiers de gauche, mais sur la politique réformiste des dirigeants des Partis Socialiste et Communiste, qui ont ruiné la révolution. Ajoutons que les sectes ultra-gauchistes ont également joué un rôle lamentable : elles furent incapables de proposer une alternative aux travailleurs et aux officiers radicalisés qui, en fait, en cherchaient une.
La crise du capitalisme
De tels développements découlent de la crise organique du capitalisme mondial. Depuis 1974, de profondes contradictions se sont accumulées. Notre époque est celle des tournants soudains et brutaux dans tous les continents et tous les pays. Les capitalistes ont beaucoup de mal à sortir l’économie mondiale de la crise. Seuls les Etats-Unis ont connu une certaine croissance, mais celle-ci est extrêmement fragile et repose essentiellement sur la consommation, le crédit et un endettement sans précédent.
La crise s’exprime avec une force particulière dans les ex-colonies d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Toutes subissent d’énormes convulsions économiques, financières, sociales et politiques. Il n’y a pas un seul régime capitaliste stable dans toute l’Amérique latine.
S’ils disposaient de puissants partis marxistes, les travailleurs argentins, boliviens, péruviens et équatoriens auraient pu prendre le pouvoir au cours de ces dernières années. Mais de tels partis n’existent pas. A la dégénérescence des IIe et IIIe Internationales s’est ajoutée la complète faillite des organisations sectaires se réclamant du trotskisme, qui ont commis toute sorte d’erreurs opportunistes et ultra-gauchistes.
En l’absence d’un puissant parti marxiste, il était inévitable que, dans les pays capitalistes sous-développés, la révolution se développe sous diverses formes particulières. C’est la conséquence du retard de la révolution socialiste dans les pays capitalistes avancés. Les travailleurs et les paysans d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ne peuvent pas attendre : ils doivent trouver une solution à leurs problèmes les plus pressants. Et s’ils n’ont pas de parti marxiste à leur disposition, ils doivent chercher une alternative.
Dans sa « théorie de la révolution permanente », Trotsky expliquait que, dans les conditions modernes, les tâches de la révolution bourgeoise-démocratique ne peuvent être accomplies que par l’expropriation de la bourgeoisie. Le seul moyen de sauver la société de la stagnation, de la faim et de la misère réside dans l’abolition du capitalisme et du latifundisme. C’est l’impossibilité de développer pleinement les forces productives sous le capitalisme et le latifundisme qui fut à l’origine des révolutions coloniales. Sous le capitalisme, il n’y a pas d’issue.
Faute d’un parti marxiste, d’autres forces peuvent passer au premier plan. Nous l’avons vu dans le cas du Portugal, en 1974-1975. Dans son article sur cette révolution, Ted Grant remarquait la chose suivante :
« Du fait que le développement des forces productives se heurte aux éléments pro-capitalistes, qui sont subordonnés à l’impérialisme et collaborent avec lui, ils sont balayés. Dans une version déformée de la révolution permanente, la caste des officiers subalternes se transforme – pour un temps – en agent inconscient de l’histoire, et réalise les taches de la nationalisation de l’économie. »
Naturellement, cette affirmation va à l’encontre de l’idée que tous les officiers et tous les coups d’Etat sont réactionnaires – idée qui, chez certains groupes « marxistes », a pris la forme d’un préjugé comparable à l’infaillibilité papale chez les dévots catholiques. Si nous nous en tenions à cette idée, il aurait fallu condamner d’avance non seulement Chavez, mais également les dirigeants de la révolution portugaise. L’histoire est trop complexe pour rentrer dans ces schémas simplistes. Mais comme le dit un vieux proverbe anglais, « les choses simples plaisent aux simples d’esprit. »
La révolution portugaise de 1974 est allée très loin. A l’époque, à Londres, le journal The Times a même publié un article intitulé : « Le capitalisme est mort au Portugal ». Cela aurait pu être vrai. Sous la pression de la classe ouvrière, le Mouvement des Forces Armées a nationalisé les banques et les compagnies d’assurance, soit 80 % de l’économie. Malheureusement, les acquis de la révolution furent minés par les dirigeants des Partis Communiste et Socialiste portugais.
Aujourd’hui, nous voyons au Venezuela un processus semblable. Pendant des générations, le peuple vénézuélien a été gouverné par des partis représentant les intérêts de l’oligarchie et de l’impérialisme. Mais en 1996, une alternative a émergé sous la forme d’un nouveau mouvement politique : le Mouvement Bolivarien, fondé par Hugo Chavez. Le programme de Chavez était modeste : contre la corruption, pour des réformes sociales, etc. Mais il est immédiatement entré en conflit avec l’oligarchie et l’impérialisme.
Ce que nous voyons au Venezuela est une variante de la théorie de la révolution permanente. Il est impossible de consolider les acquis de la révolution dans le cadre du système capitaliste. Tôt ou tard, il faudra choisir : soit la révolution liquidera le pouvoir économique de l’oligarchie, expropriera les capitalistes et prendra le chemin du socialisme – soit l’oligarchie et l’impérialisme liquideront la révolution.
Chavez et les masses
Encore une fois, dans une situation où le vieil ordre établi traverse une crise profonde, où seul un changement fondamental semble pouvoir offrir une issue, mais où il n’y a pas de parti révolutionnaire de masse, toutes sortes de scenarios sont possibles. L’effervescence révolutionnaire peut gagner les catégories sociales les plus inattendues. Nous avons déjà signalé, plus haut, que qualifier Hugo Chavez de « bourgeois » est incorrect d’un point de vue sociologique. Mais même s’il était effectivement d’origine bourgeoise, ceci n’exclurait pas la possibilité d’une évolution vers la révolution socialiste.
Citons une fois de plus le fondateur du socialisme scientifique. Dans le Manifeste du Parti Communiste, Marx écrivait :
« Enfin, au moment où la lutte des classes approche de l’heure décisive, le processus de décomposition de la classe dominante, de la vieille société tout entière, prend un caractère si violent et si âpre qu’une petite fraction de la classe dominante se détache de celle-ci et se rallie à la classe révolutionnaire, à la classe qui porte en elle l’avenir. De même que, jadis, une partie de la noblesse passa à la bourgeoisie, de nos jours une partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et, notamment, cette partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu’à la compréhension théorique de l’ensemble du mouvement historique. »
Avec quelle clarté Marx s’exprimait ! Pour quelqu’un qui a réellement assimilé la méthode marxiste, qui ne se contente pas de répéter machinalement quelques formules mal digérées, ce qui se passe au Venezuela ne présente pas de grande difficulté. Ce n’est pas non plus la première fois que nous avons à faire un tel phénomène.
En 1975, Ted Grant écrivait :
« Le marxisme serait une théorie très simple si elle ne consistait qu’à répéter les idées du passé. Les sectaires et les opportunistes des différents sectes et groupements ignorent les méthodes et les principes qui conservent toujours leur validité, et dont les écrits grands marxistes contiennent les leçons. Ils se contentent de répéter quelques phrases glanées au hasard et s’imaginent que cela fait d’eux de grands stratèges. Les œuvres de Marx, Engels, Lénine et Trotsky représentent pour nous un héritage précieux, et il faut que nous incitions les jeunes camarades à les étudier sérieusement. Mais elles ne nous offrent pas un plan détaillé du processus historique. »
Dans l’histoire, la relation entre les facteurs objectifs et subjectifs est très complexe et contradictoire. Seule la méthode dialectique nous permet de démêler les contradictions de la situation au Venezuela. En l’absence d’un authentique courant marxiste, il est inévitable qu’apparaissent d’autres tendances. Et dans la mesure où la classe ouvrière ne dirige pas, d’autres classes entrent en scène. Ce n’est pas si difficile à comprendre !
La relation entre Hugo Chavez et les masses est très complexe et dialectique. L’enthousiasme et la ferveur des masses vis-à-vis de Chavez sont colossaux. Or le secret de cette ferveur n’est pas à chercher dans la personnalité de Chavez, mais dans les rapports de classe. Les masses considèrent Chavez comme leur propre reflet. Elles s’identifient à lui, qui les a éveillées à la vie politique et a donné une voix à leurs aspirations. A leurs yeux, il personnifie la révolution. Pour les masses, Hugo Chavez et la révolution sont une seule et même chose.
Naturellement, la perception des masses est une chose, et la logique objective des événements en est une autre. Dans une révolution, les événements se succèdent à une vitesse vertigineuse. Pendant toute une période, le pendule oscille vers la gauche. Tous les partis, courants, programmes et individus sont mis à l’épreuve. Le développement de la révolution est alors marqué par l’ascension et le déclin de dirigeants et de partis, les courants les plus radicaux tendant à remplacer les plus modérés.
Le fouet de la contre-révolution
Les masses ne se lancent pas dans une révolution avec un plan de reconstruction sociale tout prêt, mais avec le sentiment aigu qu’elles ne peuvent plus supporter le vieux régime. Les premières étapes de la révolution se caractérisent inévitablement par une perspective confuse et incohérente. Il règne un sentiment d’euphorie, de triomphe et d’irrésistible avancée. Ceci s’accompagne de l’idée d’unité : « nous sommes tous ensemble », dans une sorte de marche universelle vers la liberté et la justice sociale.
Cependant, c’est une illusion. La révolution se heurte inévitablement aux barrières de l’ordre social et des institutions existantes. La victoire électorale de Chavez, en 1998, ne signifiait pas une révolution sociale, mais elle a complètement bouleversé l’ordre établi et provoqué fermentation sociale généralisée. Lorsqu’elle a compris qu’elle ne pourrait pas corrompre ni faire pression sur Chavez, l’oligarchie a décidé de l’éliminer par la force. Cela a directement mené au coup d’Etat contre-révolutionnaire du 11 avril 2002.
Il y a exactement deux ans, les forces contre-révolutionnaires de l’oligarchie vénézuélienne lançaient un coup d’Etat avec l’appui des officiers de droite au sein de l’armée. Chavez a été arrêté et une « dictature démocratique » a été proclamée. Mais les masses se sont soulevées et ont renversé le gouvernement putschiste, ouvrant la voie à de nouvelles avancées de la révolution. Une fois de plus, les masses ont été appuyées par la section révolutionnaire de l’armée. En 48 heures, le coup d’Etat s’est effondré comme un château de cartes.
Marx soulignait que, pour avancer, la révolution a besoin du fouet de la contre-révolution. Au Venezuela, chaque tentative contre-révolutionnaire a provoqué une réaction colossale des masses, qui ont tout balayé sur leur passage. Et chaque fois, leurs sentiments devenaient plus durs, plus déterminés et militants. L’exigence d’une action définitive pour se débarrasser des contre-révolutionnaires est devenue de plus en plus insistante : « Mano dura ! » (« Pas de pitié ! »), entendait-on souvent.
Après l’échec du coup d’Etat, il était possible de mener à bien la révolution socialiste, et ce de façon pacifique. Malheureusement, l’occasion a été manquée. Les réactionnaires ont pu se regrouper et organiser une nouvelle tentative, la soi-disant « grève » de décembre 2002 et janvier 2003 (en réalité, un lock-out patronal). Cette nouvelle tentative a été balayée par les travailleurs, qui ont pris le contrôle des infrastructures de l’industrie pétrolière et en ont chassé les réactionnaires. Là encore, cela ouvrait la possibilité d’une transformation radicale, sans guerre civile. Mais de nouveau, l’occasion a été gâchée.
A présent, la société est complètement polarisée entre la droite et la gauche. Riches et pauvres, chavistas et escualidos, révolutionnaires et contre-révolutionnaires se font face dans une ambiance d’hostilité permanente. La société vit dans un état d’alarme et d’agitation constante. L’air est lourd de rumeurs de coups d’Etat, de conspirations et d’intervention étrangère. L’atmosphère est électrique, comme avant un orage. Et tôt ou tard, l’orage éclatera.
Les masses apprennent rapidement à l’école de la révolution. Elles tirent leurs conclusions. La principale conclusion est que le processus révolutionnaire doit aller de l’avant, affronter ses ennemis et éliminer tous les obstacles. Tel est le désir brûlant des masses, qui se heurtent à la résistance des éléments conservateurs et réformistes, lesquels en appellent sans cesse à la prudence, et, en pratique, freinent la révolution. L’issue de la révolution dépend de la façon dont cette contradiction va se résoudre.
Le rapport de forces entre les classes
Le rapport de forces entre les classes, au Venezuela, est toujours extrêmement favorable à la réalisation d’une révolution socialiste classique. Ce qui est nécessaire, c’est l’application énergique d’une politique du front unique. Cela ne signifie en aucun cas la dissolution du mouvement ouvrier – ou de son aile marxiste – dans un « front populaire » général. Cela signifie seulement que la classe ouvrière et son avant-garde doivent conclure une alliance stratégique avec la petite-bourgeoisie révolutionnaire, les paysans pauvres et tous les autres éléments révolutionnaires de la population pour mener à bien la lutte contre l’impérialisme et l’oligarchie.
Cette politique est-elle en contradiction avec l’objectif d’une révolution socialiste ? Seuls d’irrécupérables doctrinaires peuvent le prétendre. De tels individus n’ont pas la moindre idée de ce qu’est une révolution socialiste. Voyons ce que disait Lénine à ce sujet :
« La révolution socialiste, ce n’est pas un acte unique, une bataille unique sur un seul front, c’est toute une époque de conflits de classes aigus, une longue succession de batailles sur tous les fronts, c’est-à-dire sur toutes les questions d’économie et de politique, batailles qui ne peuvent finir que par l’expropriation de la bourgeoisie. Ce serait une erreur capitale de croire que la lutte pour la démocratie est susceptible de détourner le prolétariat de la révolution socialiste ou d’éclipser celle-ci, de l’estomper, etc. Au contraire, de même qu’il est impossible de concevoir un socialisme victorieux qui ne réaliserait pas la démocratie intégrale, de même le prolétariat ne peut se préparer à la victoire sur la bourgeoisie s’il ne mène pas une lutte générale, systématique et révolutionnaire pour la démocratie. » (Lénine, La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes, 1916)
Que signifient ces lignes ? La révolution socialiste serait impensable sans la lutte quotidienne pour l’amélioration de la situation de la classe ouvrière et des masses exploitées. C’est uniquement à travers cette lutte que la classe ouvrière peut accumuler et réunir les forces nécessaires pour mener à bien la transformation socialiste de la société. Ceci n’implique pas seulement la lutte pour de meilleurs salaires, la réduction du temps de travail, un plus grand nombre de logements, d’hôpitaux, d’écoles, etc., mais aussi la lutte pour la démocratie. Au cours de cette lutte, la classe ouvrière a la possibilité d’en prendre la direction et, ainsi, de se placer à la tête de la nation.
Au Venezuela, le secret du succès réside dans l’unité d’action entre la classe ouvrière et les forces sociales de la démocratie révolutionnaire : les paysans pauvres, les pauvres des villes et la petite bourgeoisie révolutionnaire en général. Les ennemis de la révolution s’efforcent sans cesse de briser cette unité. Les marxistes luttent pour la maintenir. Mais cela ne signifie pas que nous devons accepter la direction de la petite-bourgeoisie ou cacher nos divergences avec elle. Comme le dit une expression espagnole : « juntos pero no revueltos » ; « ensemble, mais pas mélangés ».
Le mouvement bolivarien n’est pas un parti stalinien monolithique, mais un large mouvement de masse, composé de différents tendances et courants. L’aile gauche, qui reflète les aspirations révolutionnaires des masses, s’efforce de pousser la révolution en avant, de briser la résistance de l’oligarchie et d’armer le peuple. L’aile droite (les réformistes et les sociaux-démocrates) cherche à freiner la révolution, dans l’espoir de parvenir à un accord avec l’oligarchie et l’impérialisme.
En réalité, cette deuxième option n’existe pas. Il n’y a pas de compromis possible avec les ennemis de la révolution, de même qu’on ne peut mélanger l’huile et l’eau. Toute la logique de la situation tend vers un affrontement ouvert entre les classes. Le destin de la révolution dépend du résultat de ce conflit.
Face à cette situation concrète, quelle position doivent adopter les marxistes ? A ceux qui nous rappellent constamment que les marxistes et la classe ouvrière doivent maintenir leur indépendance, nous répondons : vous nous rappelez l’ABC du marxisme, et nous vous en remercions. Mais à notre tour, nous vous signalons qu’il y a, dans l’alphabet, plusieurs lettres qui suivent A, B et C.
Bien sûr, la classe ouvrière doit maintenir son indépendance de classe à tout moment et en toutes circonstances. C’est pourquoi nous encourageons les travailleurs vénézuéliens à construire et renforcer leurs organisations de classe : syndicats, comités d’usine, etc. Le même principe vaut pour la tendance marxiste. Nous sommes favorables à la collaboration avec d’autres tendances du mouvement révolutionnaire – à une condition : que les drapeaux, les programmes et les idées ne soient pas mélangés. Les idées, la politique et le programme du marxisme doivent à tout moment être maintenus et défendus au sein du mouvement.
Ainsi, l’unique position correcte est la suivante :
1) Défense inconditionnelle de la révolution vénézuélienne contre l’oligarchie et l’impérialisme.
2) Soutien critique à la démocratie révolutionnaire et Hugo Chavez contre l’oligarchie et l’impérialisme.
3) Au sein du mouvement des masses (le mouvement bolivarien), nous soutenons l’aile gauche face aux réformistes et aux sociaux-démocrates.
4) Au sein de l’aile gauche, les marxistes défendent leurs idées, leur politique et leur programme. Ils luttent pour gagner la majorité grâce à leur travail et à la supériorité de leurs idées.
5) Au sein du mouvement, il faut lutter pour bâtir de solides organisations ouvrières indépendantes – à commencer par les syndicats – et accroître leur influence.
La nécessité d’un parti marxiste
« Il faut construire le parti ! Il faut construire le parti ! », répètent les sectaires à la façon des perroquets surexcités. Mais quand nous leur demandons comment les marxistes vénézuéliens doivent s’y prendre pour construire le parti, les perroquets deviennent soudainement plus laconiques : « Comment ? Mais en le proclamant, bien sûr ! » C’est assez amusant. Trois hommes et un chien (ou un perroquet) se réunissent dans un café de Caracas et proclament le parti révolutionnaire. Très bien. Et après ? « Nous appelons les masses à nous rejoindre ! » Excellent. Et si elles ne viennent pas à vous, et préfèrent rester dans leurs organisations bolivariennes de masse ? « Eh bien ça, c’est leur problème ! »
Ces gens extraordinairement intelligents, qui s’imaginent que la participation des marxistes au mouvement bolivarien constitue l’abandon de la lutte pour un parti marxiste, ne font que démontrer qu’ils n’ont pas la moindre idée de la façon de construire un tel parti – au Venezuela comme ailleurs.
Notre approche ne comporte pas la moindre trace de liquidationnisme ou d’opportunisme, mais consiste seulement à appliquer les véritables méthodes de Marx, Engels, Lénine et Trotsky. Citons un passage bien connu d’un document fondateur de notre mouvement, le Manifeste du Parti Communiste. Dans la section intitulée « Prolétaires et communistes », on peut lire ce qui suit :
« Quelle est la position des communistes par rapport à l’ensemble des prolétaires ? Les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. »
« Ils n’ont pas d’intérêts qui les séparent de l’ensemble du prolétariat. Ils n’établissent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier. »
« Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points : 1. Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. 2. Dans les différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité. »
« Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres ; théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l’avantage d’une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. »
On pourrait croire que c’est suffisamment clair pour qu’un enfant d’intelligence moyenne le comprenne. Malheureusement, il existe des « marxistes » qui ne possèdent pas ce niveau intellectuel. Après avoir parcouru les écrits de quelques marxistes auto-proclamés, Karl Marx a protesté et affirmé que si ce qu’il venait de lire était du marxisme, alors lui-même n’était pas marxiste. Marx, Engels, Lénine et Trotsky ne sont vraiment pas responsables des idioties écrites en leur nom, pas plus que Jésus-Christ n’est coupable de ce que font les évêques vénézuéliens.
La logique de cette situation a été décrite par Shakespeare dans la première partie de sa pièce Henri IV, lorsque le Gallois Gwain Glyndower, un homme d’un grand courage, mais imbu de tendances mystiques, tentait d’expliquer à l’impulsif anglais Hotspur qu’il avait des pouvoirs magiques :
G : « Je suis capable d’invoquer les esprits du gouffre. »
H : « Eh comment, moi aussi, et n’importe qui en est capable. Mais est-ce qu’ils viennent vraiment, lorsque tu les invoques ? »
Il est impossible de prendre au sérieux l’idée selon laquelle on peut construire au Venezuela un parti révolutionnaire en dehors du mouvement des masses. Nous préférons nous baser sur les méthodes élaborées par Marx et Engels il y a plus de 150 ans – méthodes qui, comme toutes les idées fondamentales du marxisme, conservent aujourd’hui leur validité. Il est absolument nécessaire d’unir les forces du marxisme au mouvement des masses.
La classe ouvrière doit à tout moment préserver et bâtir ses propres organisations de classe, ses syndicats, ses comités d’usine, etc. En même temps, elle travaillera à construire un vaste mouvement qui inclura les couches les plus larges des masses non-prolétariennes et semi-prolétariennes. L’aile marxiste du mouvement maintiendra sa complète indépendance politique – ses propres journaux, revues, livres et brochures – et son entière liberté de défendre son point de vue. Elle travaillera loyalement pour construire le mouvement et y attirer les couches les plus larges de la jeunesse et de la classe ouvrière, tout en luttant pour gagner les éléments les plus avancés à son programme, sa politique et ses idées.
Nous ne cherchons pas à nous imposer au mouvement. Nous ne lui présentons aucun ultimatum. Notre objectif est de le construire, de le fortifier et de le pousser vers l’avant tout en armant ses couches dirigeantes des idées, du programme et de la politique nécessaires pour vaincre l’oligarchie, vaincre l’impérialisme, et ouvrir la voie à une transformation socialiste de la société. Comme l’expliquait Lénine, une lutte consistante pour la démocratie mènera inévitablement à l’expropriation de l’oligarchie et à la transformation de la révolution démocratique en révolution socialiste.
Pour le moment, ces idées sont minoritaires. Cela ne nous inquiète pas. Nous acceptons le fait que nous soyons une minorité, et agissons en conséquence. Mais nous continuerons de défendre le programme de l’expropriation de l’oligarchie et de l’armement du peuple comme les seules garanties du succès de la révolution. Les événements nous donneront raison. Nous défendrons nos idées, et nous invitons tous les autres courants à faire de même. Seuls les staliniens et les bureaucrates craignent le débat ; pas les marxistes et les démocrates révolutionnaires honnêtes.
Nous fondons fermement notre action sur le mouvement des masses révolutionnaires. A partir de leur expérience, elles apprendront la justesse de nos idées, de nos mots d’ordre et de notre programme. C’est la seule voie vers le succès !
Nous donnerons le dernier mot au grand marxiste et théoricien Ted Grant, qui a écrit ce qui suit au sujet des organisations de masse :
« De leurs rangs, du milieu les combattants de la classe ouvrière, surgiront les forces du marxisme. En dehors de ces organisations de masse, aucune substance durable ne pourra être créée. »
Le 4 mai 2004