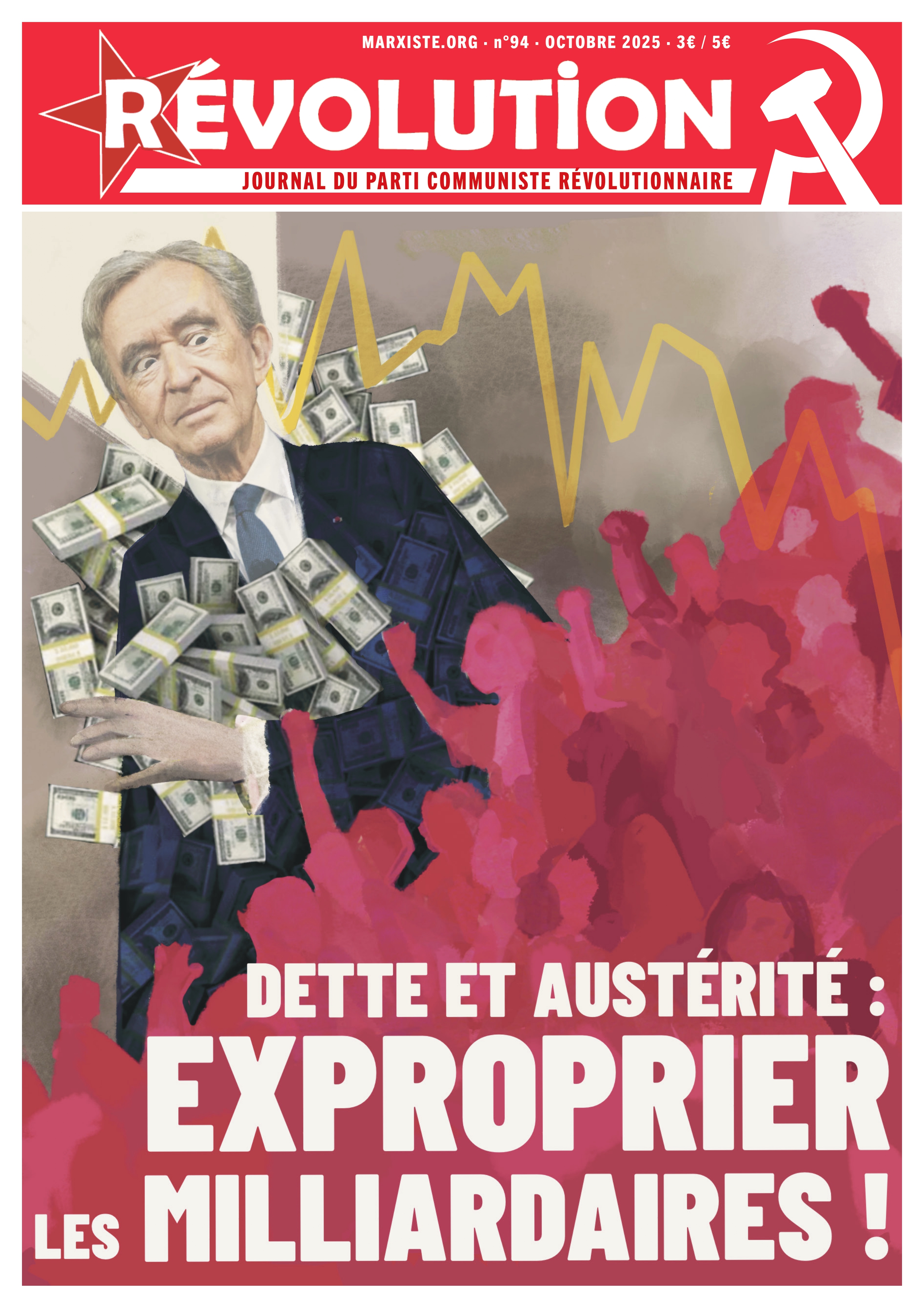Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, Giorgia Meloni semble avoir restauré la stabilité du régime politique de la bourgeoisie italienne. Son gouvernement d’union des droites compte parmi les plus durables de l’histoire récente du pays. La situation n’est pourtant pas bonne pour le capitalisme italien, avec une croissance à 0,7 % en 2024, une dette à 135 % du PIB, un effondrement de 36 % de la production automobile sur un an, et une baisse de 8 % des salaires réels sur trois ans. Les masses s’appauvrissent, l’économie décline, mais le gouvernement Meloni se maintient au pouvoir – et à 43 % de popularité dans les sondages.
Le « miracle italien »
Ce « miracle italien » fait des envieux parmi les bourgeoisies européennes, qui voient les crises s’enchaîner partout ailleurs : en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, au Portugal, en Roumanie, etc. Visiblement inspiré, le Premier ministre britannique Keir Starmer félicitait Meloni l’an dernier pour les « progrès remarquables » de sa politique migratoire – c’est-à-dire pour les réussites sanglantes de ses manœuvres de diversion raciste.
En France, Le Figaro l’érige en « modèle des droites », Laurent Wauquiez la congratule pour sa lutte contre « l’immigration illégale », « le déficit budgétaire » et « l’assistanat », Bruno Retailleau souligne sa capacité à « rassembler », et Edouard Philippe complimente son « discours […] empreint par la réalité ». Un gouvernement qui parvient à se maintenir tout en attaquant férocement la classe ouvrière : on peut comprendre que le scénario les fasse rêver.
Beaucoup à gauche voient dans l’élection et la relative popularité de Meloni le symptôme d’une « fascisation » de la société italienne. En réalité, comme nous l’expliquions déjà en 2022, Meloni a été élue avant tout parce qu’elle était la seule opposante au gouvernement d’union nationale de Mario Draghi, auquel tous les autres partis participaient. Ses opposants d’aujourd’hui – le Parti Démocrate et le Mouvement 5 Etoiles – étaient hier au pouvoir, et ont mené d’innombrables attaques contre les travailleurs.
Rejet du système et « révolte sociale »
Meloni ne se maintient au pouvoir que parce que ses adversaires sont encore plus discrédités qu’elle ne l’est elle-même. Le facteur fondamental de la politique italienne actuelle est une détestation généralisée à l’égard des institutions et des partis du système. En témoigne l’abstention, qui a atteint le niveau record de 50,3 % aux élections européennes de juin 2024, dans un pays qui votait à plus de 90 % jusqu’aux années 1980.
Réduits à choisir dans les urnes entre leurs oppresseurs du jour et ceux de la veille, les travailleurs italiens ne se sont pas « fascisés », mais lassés d’un jeu électoral où ils perdent à tous les coups. Leur véritable état d’esprit s’est exprimé cet automne à travers une série de grèves sectorielles, notamment parmi les salariés des transports publics, qui ont paralysé le pays le 8 novembre.
Le 29 novembre, des centaines de milliers de grévistes se sont rassemblés dans toute l’Italie pour une journée de « révolte sociale », à l’appel du secrétaire de la CGIL (la CGT italienne) Maurizio Landini. Inédit dans la bouche du très réformiste Landini, le mot d’ordre de « révolte sociale » a scandalisé les médias… et enthousiasmé de vastes couches de la classe ouvrière. Le gouvernement a même menacé de restreindre le droit de grève, ce qui n’a fait que renforcer la mobilisation.
L’échec du référendum
Mais la « révolte sociale » a fait long feu. Peu après le remarquable succès de cette manifestation, la CGIL a proclamé la « révolte par les urnes » : l’organisation d’un référendum d’initiative citoyenne, les 3 et 4 juin (six mois plus tard !), pour abroger une poignée de dispositions réactionnaires du Code du Travail. Boycotté par la droite et par les médias, déconnecté des luttes réelles et dénué de tout caractère programmatique positif, ce référendum aux objectifs très limités pouvait difficilement enthousiasmer les masses. D’autant plus qu’en 2011 un référendum identique avait obtenu une majorité pour repousser la privatisation de l’eau, mais que le résultat avait ensuite été tout simplement ignoré par la classe dirigeante.
Seuls 30 % des électeurs se sont finalement déplacés pour le référendum, bien loin des 50 % nécessaires pour lui donner valeur de loi. C’est la conséquence logique de la tactique erronée de la « révolte par les urnes », qui a offert un nouveau répit au gouvernement Meloni. Comme l’écrivent nos camarades italiens : « Les six mois de campagne référendaire ont mis la lutte des classes au congélateur. […] Si les innombrables tracts, les milliers d’assemblées, de conférences, de séminaires, et les centaines de comités constitués pour la campagne avaient plutôt servi à organiser une grève générale et des luttes dans les entreprises, les travailleurs auraient réagi bien différemment. »
Le potentiel pour une lutte de masse contre Meloni existe bel et bien dans la classe ouvrière italienne. Elle ne se maintient au pouvoir pour l’instant que grâce aux erreurs des dirigeants du mouvement ouvrier.