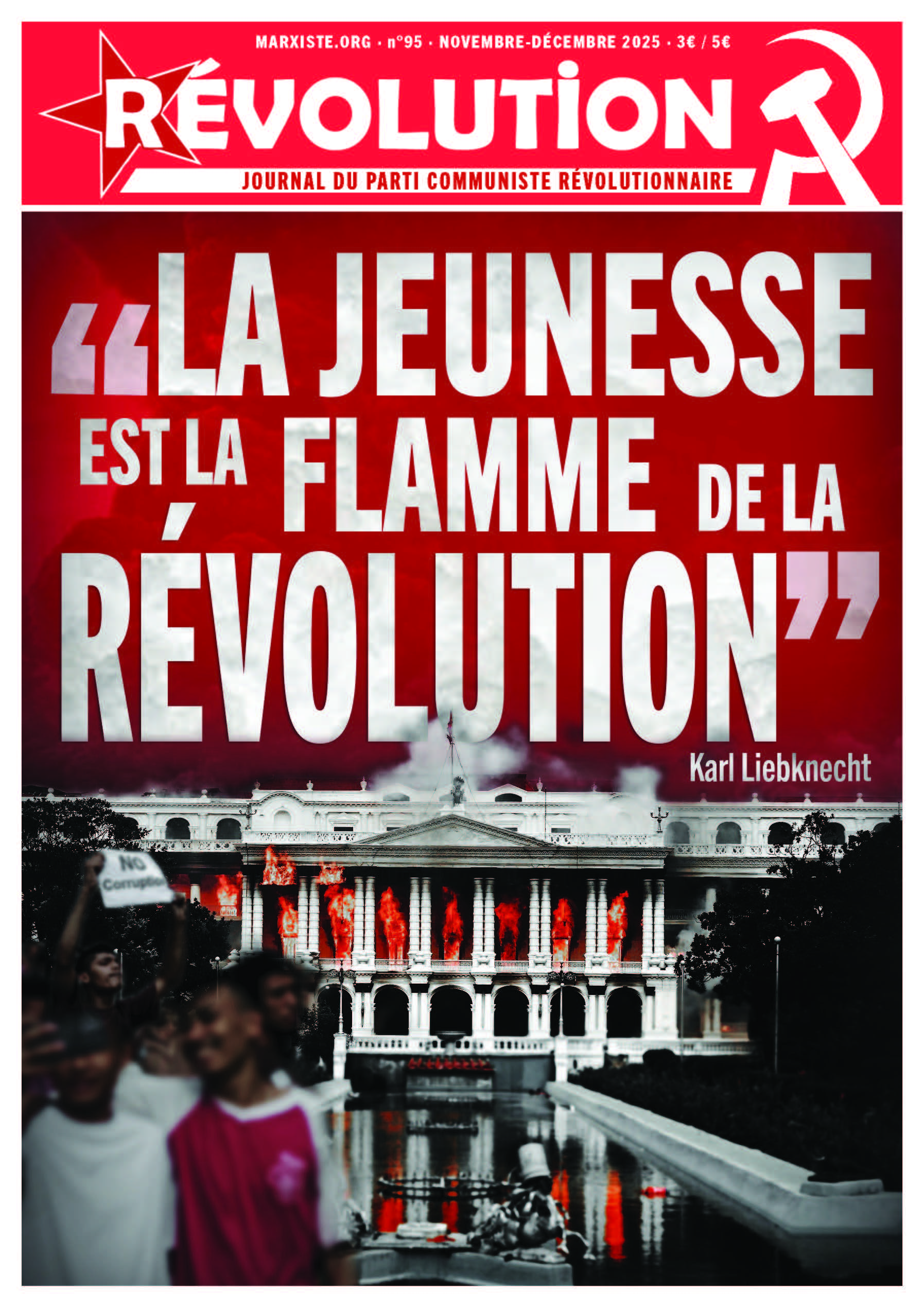Ci-dessous, nous publions pour la première fois en français « Le nouveau rapport de forces en Europe », un article écrit par Ted Grant en mars 1945. La valeur et la portée de cet article apparaîtront à sa seule lecture. Cependant, nous y ajoutons l’introduction suivante, pour fournir aux lecteurs des éléments de contexte supplémentaires.
A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’histoire du monde est entrée dans une ère qualitativement nouvelle. De tels tournants imposent aux révolutionnaires d’étudier les transformations à l’œuvre, pour développer des perspectives et une stratégie correctes.
Jusqu’alors, la IVe Internationale se basait sur une série de prédictions élaborées par Trotsky avant son assassinat en 1940. Selon lui, la question du stalinisme serait résolue soit par une contre-révolution capitaliste en URSS, soit par une révolution politique victorieuse menée par la classe ouvrière. Les partis staliniens et sociaux-démocrates en Occident allaient être complètement discrédités, sinon détruits. Enfin, une vague révolutionnaire allait balayer l’Europe et le monde. Sur cette base, les petits partis de la IVe Internationale pourraient se transformer en partis révolutionnaires de masse.
Partant de cette perspective, tous les partis de l’Internationale excluaient que la démocratie bourgeoise puisse se stabiliser, pendant comme après la guerre. Ils prévoyaient des crises économiques, des dictatures bonapartistes, des révolutions et des contre-révolutions.
Une vague révolutionnaire a bel et bien balayé l’Europe : cette prédiction de Trotsky s’est remarquablement vérifiée. Même avant la fin de la guerre, de puissants mouvements révolutionnaires des ouvriers et des paysans en armes éclatèrent en Grèce, en Yougoslavie, en Italie et en France. Toute l’Europe était agitée par une effervescence révolutionnaire.
En revanche, le stalinisme n’est pas sorti de la guerre affaibli, mais puissamment renforcé. L’Armée Rouge a réduit en pièces la machine de guerre nazie. Elle a pénétré jusqu’au cœur de l’Europe. Elle a émergé comme la seule véritable puissance en Europe de l’Est.
Même en dehors de la sphère d’influence de l’URSS, les masses dans l’Union Soviétique et l’Armée Rouge ont été les vainqueurs du fascisme en Europe. Les partis communistes staliniens, qui avaient joué un grand rôle dans la lutte clandestine contre l’occupation nazie, en tiraient une immense popularité.
Une couche de la classe ouvrière était aussi attirée par les vieux partis sociaux-démocrates. Les travailleurs se tournaient vers leurs organisations traditionnelles dans l’espoir d’obtenir de profondes améliorations de leurs conditions de vie – après les dévastations et les privations de la guerre.
L’article de Ted Grant est un véritable modèle d’application de la méthode marxiste à un tournant de grande ampleur dans la situation mondiale. Grant a commencé par analyser les conditions sociales et matérielles sur le terrain, sans plaquer d’idées préconçues sur cette réalité. Chacune des prévisions élaborées dans cet article – écrit avant la fin de la guerre – était considérée comme une hypothèse qui devait être scrupuleusement confrontée au cours réel des événements.
Parmi les prévisions de Grant, la plus importante est peut-être la perspective d’une « contre-révolution sous une forme démocratique » en Europe. Grant observait que les bases d’une réaction bonapartiste ou fasciste avaient été complètement détruites, en Europe, avec la défaite des nazis et de leurs collaborateurs. Les armées alliées d’occupation pouvaient difficilement jouer le même rôle que ces derniers.
Dans ces circonstances, les classes dirigeantes ne pouvaient pas s’appuyer sur la seule répression. Pour stabiliser leur domination, elles allaient devoir s’appuyer sur les dirigeants staliniens et sociaux-démocrates. Par leur intermédiaire, elles allaient promettre des réformes démocratiques et sociales, tout en engageant le désarmement des milices ouvrières révolutionnaires qui avaient émergé lors de la lutte contre le fascisme.
Cette perspective s’est totalement confirmée en Europe – à l’exception de la Grèce, où l’impérialisme britannique et ses sbires provoquèrent une guerre civile et une dictature sanglante contre les ouvriers et les paysans. Mais même en Grèce, la confrontation ouverte et violente n’advint qu’à partir du moment où les dirigeants staliniens eurent soumis les ouvriers et les paysans à un gouvernement transitoire « démocratique », en alliance avec les chefs de la bourgeoisie.
Grant a aussi anticipé la possibilité que la bureaucratie stalinienne d’URSS, menacée par les manœuvres des impérialistes, décide de nationaliser les économies des pays d’Europe centrale et de l’Est libérés par l’Armée Rouge. Cette perspective n’avait rien d’évident en 1945, lorsque la politique de Staline était encore de maintenir le capitalisme sous couvert de « démocratie populaire ».
Dans cet article, Grant affirme que la période qui s’ouvre, en 1945, ressemblera aux années 1917-1921 en Europe, ou à l’Espagne de 1931-1939. Cette perspective, qui ne s’est pas vérifiée, reposait sur plusieurs facteurs alors à l’œuvre.
L’économie européenne était un champ de ruines. La pénurie de nourriture et de logements était universelle. Les puissances victorieuses étaient en train de démembrer l’Allemagne, dont elles démantelaient et pillaient l’industrie. Dans le même temps, l’URSS avait conquis la moitié de l’Europe, et une guerre de libération nationale avait porté Tito et le Parti Communiste au pouvoir en Yougoslavie.
Dans ce contexte, Grant supposait que la profondeur de la crise, les revendications brûlantes des masses et le conflit croissant entre l’impérialisme américain et l’Union Soviétique préparaient de nouvelles vagues de révolutions et de contre-révolutions.
Mais c’est précisément cette menace d’un effondrement économique et de révolutions socialistes qui poussa l’impérialisme américain à adopter le plan Marshall. En 1945, nul ne pouvait anticiper avec certitude un tournant politique d’une telle ampleur historique.
En juin 1947, devant le Congrès américain, le secrétaire d’Etat George C. Marshall déclara que l’Europe devait « recevoir une aide supplémentaire très importante ou s’exposer à une dislocation économique, sociale et politique très grave ». L’impérialisme américain avait compris qu’il fallait à tout prix reconstruire l’économie européenne, sans quoi l’Allemagne, puis toute l’Europe, tomberaient dans la sphère d’influence soviétique.
En avril 1948, le plan Marshall fut adopté. Au cours des quatre années qui suivirent, 13,3 milliards de dollars (l’équivalent de 175 milliards de dollars en 2025) furent alloués à l’Europe, principalement sous la forme de subventions. Cet afflux d’aide financière contribua grandement à la reprise économique d’après-guerre. La croissance qui s’ensuivit stabilisa le capitalisme européen pendant plus de vingt ans.
En fait, Grant anticipa la possibilité d’un tel tournant dans des « Perspectives économiques » publiées en 1946, et il analysa ces processus en profondeur au cours des années suivantes. Nous invitons les lecteurs à étudier les écrits de Ted Grant à cette époque (accessibles en anglais sur tedgrant.org) pour approfondir leur compréhension de ces développements.
Ceci dit, le meilleur point de départ reste l’article suivant. Il permet à la fois de comprendre la genèse de l’ordre mondial d’après-guerre (celui qui s’effondre aujourd’hui) et la méthode authentique du marxisme. Cela en fait un véritable « classique ».
La fin de la guerre ouvre une nouvelle étape dans les développements militaires, diplomatiques, économiques et politiques à l’échelle mondiale.
Les impérialismes allemand et japonais ont été réduits en poussière par l’écrasante prépondérance militaire et économique de l’Union Soviétique, à l’Est, et de l’impérialisme américain – avec son satellite britannique – à l’Ouest.
Dans le sillage des armées « alliées » victorieuses, les ministres des Affaires étrangères et les diplomates des trois grandes puissances [Etats-Unis, Grande-Bretagne et URSS] tissent des accords secrets pour diviser l’Europe et le monde en sphères d’influence et en zones d’exploitation. Les Etats satellites ne sont invités dans les conseils de l’ONU que pour sauver les apparences : leurs votes donnent du poids aux décisions préalablement négociées en coulisses par les « trois grands ».
Mais les intrigues militaires et diplomatiques passent au second plan face à la menace d’une révolution prolétarienne en Allemagne, à travers toute l’Europe et dans les colonies d’Orient. Ce problème fondamental est la préoccupation centrale des trois grandes puissances, qui cherchent une solution radicale pour y remédier. La peur de la révolution est désormais la première justification de leur alliance, et elle le restera. Ils élaborent conjointement des plans pour conjurer ou réprimer les soulèvements révolutionnaires qui ne manqueront pas d’éclater et de défier le vieil ordre capitaliste en Allemagne et en Europe.
Le rapport de forces entre les puissances mondiales s’est transformé depuis le traité de Versailles. D’abord masquée par une évolution graduelle entre les deux guerres mondiales, cette transformation se manifeste désormais dans les destinées militaires des nations.
Le déclin de la France s’est révélé par la destruction de son armée (jadis la plus puissante d’Europe), par la désintégration de son empire colonial et par le rôle misérable de sa classe dirigeante dans sa collaboration avec l’occupant nazi. C’est désormais une puissance de troisième ordre, en Europe comme dans le monde.
La bulle des prétentions impériales bruyamment affichées par la classe dirigeante italienne a éclaté au premier test. Ses orgueilleuses légions de chemises noires reposaient sur une base économique trop faible, qui n’a pas résisté à la pression. L’Italie s’en trouve réduite au rôle d’un pays des Balkans.
D’Est en Ouest, la guerre a drastiquement diminué l’importance des nations européennes dans le nouvel équilibre des forces. La Pologne, la Tchécoslovaquie, les pays baltes et balkaniques, la Belgique, la Hollande et les pays scandinaves – tous en sortent avec un poids et un rôle amoindris dans le « concert des nations ».
L’hégémonie britannique sur la planète est révolue. Incapable de tenir ses positions sur le continent européen et d’intervenir de façon décisive dans les affrontements militaires – où ses commandants sont subordonnés à ceux de ses maîtres yankees –, la Grande-Bretagne décline au profit de ses alliés russo-américains. Face aux autres puissances, elle est devenue « la plus grande des petites nations ».
Dès son entrée dans l’arène mondiale, l’impérialisme américain s’est placé au premier rang des nations impérialistes grâce au gigantisme de son économie et de ses ressources militaires. Sa prépondérance économique et militaire lui assure une position dominante à l’Est comme à l’Ouest. L’océan Pacifique est devenu un « lac américain ». Le dollar exerce sa force d’attraction sur les possessions britanniques, qui ne sont plus que nominalement liées à leur métropole.
L’émergence de la Russie
Mais le développement mondial le plus important est, de loin, l’émergence de la Russie, qui est désormais – et pour la première fois – la plus grande puissance militaire d’Europe et d’Asie. Les extraordinaires victoires de l’Armée Rouge en Europe ont forcé la majorité de la bourgeoisie européenne à se tourner vers le Kremlin. Dans le même temps, le mouvement pro-soviétique dans les masses a fourni à l’URSS une puissante base de soutien.
Il ne reste plus de puissance, en Europe, capable de rivaliser avec l’Armée Rouge. Quelques années ne suffiraient pas à créer une force militaire capable de relever un tel défi, aussi bien matériellement que moralement. Pour regrouper les forces du capitalisme européen dans un assaut contre la Russie, il faudrait d’abord une défaite complète de la classe ouvrière, la destruction totale de ses organisations et l’instauration d’une terrible réaction yankee.
Au rapport de forces militaire s’ajoutent la lassitude des masses dans tous les pays (en particulier en Europe), ainsi que l’admiration pour l’Armée Rouge et la vive sympathie pro-soviétique qui animent des sections entières de la classe ouvrière, y compris aux Etats-Unis. Tout cela rend difficile, sinon impossible, une attaque des Alliés contre l’Union Soviétique dans l’immédiat après-guerre.
Une telle opération aurait des implications politiques bien trop risquées – non seulement en Europe et en Asie, où les masses soutiendraient l’Union Soviétique, mais aussi en Grande-Bretagne et en Amérique. D’un point de vue idéologique, mobiliser les masses pour une telle guerre est impossible, car cela dévoilerait la véritable nature de la lutte menée précédemment contre l’Axe. En outre, la puissance militaire de l’Union Soviétique en ferait une guerre longue, qui provoquerait des explosions révolutionnaires à travers la planète. Malgré leur hostilité à son égard, les Alliés seront donc forcés de tolérer un arrangement avec l’URSS dans la période à venir.
L’échec des plans impérialistes
L’impérialisme allemand anticipait avec assurance la destruction et la désintégration de l’Etat soviétique. Les impérialistes anglo-américains attendaient et espéraient l’effondrement de l’URSS, eux aussi, tout en tablant sur le fait que l’impérialisme allemand en sortirait très affaibli. Ainsi serait garantie la victoire finale des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. A minima, ils s’attendaient à ce que l’Union Soviétique sorte de la guerre brisée, ou décisivement affaiblie, et en tout cas incapable de résister aux conditions qu’ils voulaient lui imposer.
Mais leurs plans ont échoué. L’un des résultats fondamentaux de la guerre impérialiste est le suivant : l’Union Soviétique, autrefois arriérée, a durablement émergé comme la plus grande puissance militaire d’Europe. Les calculs des impérialistes des deux camps s’en sont trouvés contrariés. Les chancelleries du monde entier ont éprouvé des sueurs froides.
En Europe, la guerre s’est essentiellement ramenée à un affrontement entre l’Allemagne – armée des ressources de toute l’Europe – et l’Union Soviétique. La Russie a triomphé de cette épreuve décisive.
La bureaucratie stalinienne occupe désormais l’Europe de l’Est pour s’assurer une position de défense stratégique contre ses alliés, d’une part, et d’autre part pour défendre ses intérêts en dominant, pillant et asservissant les peuples des Balkans et d’Europe centrale. Mais l’avancée de l’Armée Rouge en Europe de l’Est a aussi déclenché un mouvement dans de larges couches d’ouvriers et des paysans opprimés. La bureaucratie stalinienne s’est servie de ce mouvement pour placer ses marionnettes à la tête des gouvernements. Pour rassurer ses alliés, Staline a maintenu le capitalisme dans les territoires occupés qu’il n’a pas incorporés à l’Union Soviétique, tout en concédant des réformes agraires aux paysans.
Si la bureaucratie stalinienne n’a pas aboli le capitalisme dans les territoires occupés, c’est aussi parce qu’elle craint les inévitables répercussions d’une mobilisation des forces de la révolution prolétarienne, même sous une forme caricaturale, dans les Balkans et à travers le continent européen. Dans cette situation hautement explosive, le mouvement pourrait échapper au contrôle de la bureaucratie. Il pourrait avoir d’importantes répercussions dans l’Armée Rouge et parmi les ouvriers et paysans d’Union Soviétique.
L’occupation de l’Allemagne et de l’Europe de l’Est répond donc à un double objectif, du point de vue de la bureaucratie. Elle doit protéger l’Union Soviétique, mais par des moyens servant les intérêts réactionnaires de la bureaucratie stalinienne. Ces méthodes n’ont rien à voir avec le léninisme ; elles en sont même la négation. L’occupation soviétique vise à étrangler et détruire la révolution du prolétariat européen.
Désormais que l’impérialisme allemand s’est effondré, le premier devoir du prolétariat d’URSS n’est plus de défendre l’Union Soviétique, comme pendant la guerre, mais de défendre la révolution européenne contre la bureaucratie soviétique. La bureaucratie bonapartiste stalinienne utilise l’Armée Rouge comme une arme contre-révolutionnaire. De manière générale, la bureaucratie représente un danger mortel pour le prolétariat européen.
Mais la situation comporte aussi de grands dangers pour la bureaucratie stalinienne. Les soldats de l’Armée Rouge finiront inévitablement par fraterniser avec les ouvriers et les paysans des pays conquis. Et en observant les conditions de vie dans les autres pays, qu’ils compareront à celles de la Russie, ils verront toute la fausseté de la propagande de la bureaucratie.
De façon générale, la période à venir posera l’alternative suivante : soit le maintien du capitalisme dans les pays d’Europe centrale et de l’Est occupés par l’URSS permettra à la bureaucratie d’acquérir la propriété de moyens de production, et dès lors servira de base à la restauration du capitalisme en Union Soviétique ; soit la bureaucratie sera forcée, au risque de se mettre à dos ses alliés impérialistes, de nationaliser les industries des pays durablement occupés – si possible par en haut, sans participation des masses.
Tout en expliquant la nature de l’Union Soviétique et la nécessité de la défendre contre l’impérialisme mondial, la IVe Internationale dévoilera le rôle contre-révolutionnaire de la bureaucratie dans la révolution européenne et mondiale. La nouvelle étape dans la défense de l’Union Soviétique consiste principalement à défendre la révolution européenne contre la conspiration de la bureaucratie stalinienne avec l’impérialisme mondial. Là où l’Armée Rouge, que la bureaucratie contrôle pour servir ses fins, est utilisée pour écraser le mouvement révolutionnaire des masses, pour réprimer des soulèvements et des insurrections des travailleurs, la IVe Internationale appellera les travailleurs à s’y opposer par tous les moyens disponibles, y compris par la grève et la force armée. Il faudra s’adresser aux soldats de l’Armée Rouge pour leur rappeler les idéaux d’Octobre et les appeler à rejoindre le camp de la classe ouvrière. La meilleure façon de défendre l’Union Soviétique est d’étendre Octobre et de restaurer la démocratie soviétique en URSS.
La position de la bureaucratie stalinienne
La bureaucratie grand-russe étouffe les aspirations nationales des minorités d’Union Soviétique. Tout en subordonnant la lutte pour l’indépendance à la défense de l’Union Soviétique, le Revolutionary Communist Party [1] défend le droit des minorités ukrainiennes, baltes, etc., à se séparer de l’Union Soviétique stalinienne et à former des Etats socialistes indépendants. Mais la sécession est une utopie réactionnaire si elle ne s’inscrit pas dans une lutte pour la démocratie soviétique, le renversement du stalinisme et l’unification d’une URSS démocratisée avec des Etats-Unis socialistes d’Europe.
Au cours de la guerre, l’écart entre la caste bureaucratique et les masses s’est profondément creusé. De toutes les conquêtes d’Octobre, il ne reste que la plus fondamentale : la nationalisation des moyens de production. Le pouvoir est passé de la bureaucratie civile à la bureaucratie militaire, dirigée par une galaxie de maréchaux. Des processus contradictoires sont à l’œuvre en Union Soviétique. D’une part, la guerre a accéléré la prolétarisation de nouvelles couches de la population, de femmes et même d’enfants. Le prolétariat soviétique ne doit plus être très loin des effectifs du prolétariat américain. D’autre part, la différenciation entre la bureaucratie et les masses acquiert un caractère de plus en plus capitaliste.
Deux tendances opposées sont donc à l’œuvre. Les tendances bourgeoises se tournent toujours plus vers l’Occident capitaliste, dont la bureaucratie soviétique a adopté tous les vices. Mais les masses soviétiques sont bien conscientes des crimes de la bureaucratie et la haïssent profondément. Les ouvriers, les paysans et les soldats victorieux lui demanderont bientôt de rendre des comptes. Les victoires de l’Armée Rouge ont donné de la confiance et de l’élan aux masses soviétiques. Elles n’accepteront pas facilement les ordres et les excuses de la bureaucratie, une fois écarté le danger d’une intervention capitaliste. La guerre et ses luttes herculéennes ont arraché la masse de la population au désespoir et à l’apathie. La société soviétique n’a pas été moins bouleversée par la guerre que les sociétés des pays capitalistes.
Les victoires de l’Union Soviétique sont un capital pour la révolution mondiale, aussi bien par leurs effets dans les masses du monde entier que pour le rôle qu’elles jouent dans la préservation de l’économie nationalisée. Mais il faut que les classes laborieuses comprennent le caractère double et contradictoire de ce processus.
D’un côté, les victoires de l’Armée Rouge suscitent des échos de la révolution d’Octobre dans les masses européennes. D’autre part, la bureaucratie utilise l’Armée Rouge et ses relais – les partis communistes – pour étrangler la révolution prolétarienne.
D’un point de vue purement économique, malgré les excès bureaucratiques et l’étouffement de l’initiative des masses, l’Union Soviétique parviendra probablement, d’ici quelques années, à restaurer la production à son niveau d’avant-guerre. Les succès économiques pourraient encore se poursuivre au-delà, mais cela ne veut pas dire que la guerre n’aura pas eu de profonds effets sur la vie économique soviétique, ni que les développements économiques d’après-guerre, en Union Soviétique, seront sans heurts et sans crises.
Au cours des quatre dernières années, l’économie a été tournée quasi exclusivement vers la production d’équipements militaires. Les remarquables résultats productifs qui en ont résulté ont coûté cher : les machines sont usées, des industries de consommation courante ont été éliminées, les travailleurs sont épuisés. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que les disproportions de l’économie soviétique provoquent des crises sévères, comparables à celles qui ont éclaté avant la guerre. La « planification » bureaucratique ne pourra pas les résoudre, car elles découlent de l’isolement de l’économie nationalisée.
La guerre a nettement accentué les disproportions qui existaient déjà entre les différents secteurs de l’économie soviétique – entre l’industrie lourde et l’industrie légère, entre l’industrie et l’agriculture. En 1941, déjà, l’agriculture ne s’était pas complètement remise des ravages de la collectivisation forcée. Depuis, elle a été massivement dévastée par la guerre. Il n’y a aucune solution définitive à ce problème dans le cadre de l’économie isolée de l’Union Soviétique.
Cependant, les avantages de l’économie nationalisée sont tels que, malgré les contradictions économiques et dans ce cadre précaire, elle pourrait tout de même connaître des accomplissements productifs à une échelle et à une vitesse dont même les Etats capitalistes les plus avancés sont incapables.
Les inégalités en Union Soviétique ont atteint de telles proportions que les perspectives se ramènent à trois possibilités :
- Théoriquement, sur fond de croissance économique, il n’est pas exclu que la bureaucratie se maintienne au pouvoir pendant un certain nombre d’années.
- La poursuite de la dégénérescence de la bureaucratie soviétique pourrait paver la voie à une restauration du capitalisme.
- Le réveil du prolétariat pourrait conduire au renversement de la bureaucratie et au rétablissement de la démocratie soviétique.
La bourgeoisie mondiale, et en particulier l’impérialisme anglo-américain, mise sur la dégénérescence interne de l’Union Soviétique. Les impérialistes espèrent que la combinaison d’une pression économique extérieure et de la réaction à l’intérieur aboutira au rétablissement du capitalisme. Si la réaction l’emporte en Europe et en Asie, ils pensent pouvoir accomplir cette restauration, si nécessaire par des moyens militaires. Mais pour l’heure, malgré les rivalités, il leur faut attendre, car ils ont besoin du Kremlin pour étrangler la révolution qui menace le capitalisme en Europe et en Asie. En cette heure de grand péril, la bourgeoisie utilise les services de la bureaucratie, mais c’est pour mieux tenter d’étrangler l’Union Soviétique quand la crise sera surmontée.
Bien que la bureaucratie ait atteint des proportions immenses, la situation comprend aussi des facteurs favorables à la renaissance du pouvoir des travailleurs. Les conquêtes économiques entrent en contradiction avec la mainmise de la bureaucratie, qui devient un fardeau grandissant pour l’économie du pays. La guerre a montré la puissance des traditions d’Octobre, même souillées par la bureaucratie.
Les événements surprendront autant la bourgeoisie mondiale que la bureaucratie stalinienne. La propriété collective, qui a montré sa supériorité dans la paix comme dans la guerre, deviendra de plus en plus incompatible avec la bureaucratie. La faiblesse de celle-ci s’exprimera dans une crise politique après la guerre. Il est inévitable que des affrontements éclatent entre les ouvriers, les paysans, les soldats, qui réclameront les fruits de leur victoire, et les usurpateurs. Dans ces luttes, le puissant prolétariat soviétique, guidé par la IVe Internationale et trempé par trois révolutions et deux guerres victorieuses, reprendra conscience de sa force.
La question nationale en Europe
La machine de guerre nazie n’a eu aucun mal à s’emparer de l’Europe, mais cette conquête s’est avérée illusoire en quelques années. Les nazis ne parvenaient pas à soumettre les peuples souffrants sous leur joug – qui était synonyme de pauvreté, de famine et d’une intolérable oppression totalitaire. Malgré l’absence d’un programme de classe clair et au prix d’innombrables victimes, les masses ont lutté et sapé la domination nazie sur le continent.
Bon gré mal gré, les bourgeoisies des pays conquis avaient fait allégeance aux nazis. A l’heure de la défaite, les champions de la « dignité patriotique » et de « l’unité nationale » sont devenus les gestionnaires des conquérants. Ils se sont unis aux oppresseurs contre les masses de leurs propres nations. Les intérêts de classe finissent toujours par primer sur tout le reste.
Les nazis réussirent temporairement à stabiliser la situation grâce aux régimes collaborateurs, à la torture et à la terreur SS. Mais ils bénéficièrent aussi de la politique des dirigeants sociaux-démocrates et staliniens, qui attisaient le chauvinisme national. Cela ne pouvait qu’aider les impérialistes allemands à conserver le soutien des ouvriers et des paysans allemands, au nom de la « lutte des races ». Elle joua le rôle de ciment national pour les bandits nazis et la bourgeoisie allemande.
Les soldats allemands devaient choisir quelle nation serait asservie : la leur ou les autres. Ils continuèrent donc d’agir – souvent à contrecœur – comme des forces d’occupation. Si les organisations clandestines de masse de la classe ouvrière ou les dirigeants de l’Union Soviétique en avaient appelé à l’internationalisme socialiste et avaient organisé une campagne systématique de fraternisation de classe, ils auraient été entendus. Les résultats s’en seraient fait sentir jusqu’aux confins du Reich et de l’empire nazi. Mais ils s’y refusèrent et ne firent rien pour permettre la fraternisation de classe.
Notre rapport aux mouvements de résistance
Les staliniens, les sociaux-démocrates, des partis petits-bourgeois et certaines sections de la bourgeoisie ont organisé la résistance à l’oppression étrangère. Ces groupes hétérogènes étaient traversés par des contradictions de classes, qui ont pris la forme de conflits ouverts et organisés, allant dans certains pays jusqu’à la guerre civile.
En Pologne, en Yougoslavie et en Grèce, cette division a conduit à la formation de mouvements de résistance distincts et rivaux. Zérvas et l’EDES représentaient la vieille réaction capitaliste-féodale ; ils se sont même appuyés sur les nazis, à un certain stade, pour lutter contre Tito et Siantos, qui représentaient les masses plébéiennes. Dans une moindre mesure, on retrouve les mêmes divisions dans tous les pays occupés, comme en France avec les maquis et les FTP [2].
Les éléments constituant l’aile « gauche » de la Résistance, qui s’appuyaient directement sur les couches révolutionnaires de la population, furent parfois forcés par la pression de la lutte des classes à entrer en conflit avec les éléments représentant la bourgeoisie. Malgré la politique « nationale » de trahison et de collaboration de classe de leurs directions, ces mouvements représentaient les aspirations et la pression des masses pour une solution de classe. C’est pourquoi les marxistes révolutionnaires avaient le devoir d’apporter un soutien critique à cette aile gauche, contre l’aile droite.
Cependant, même cette aile gauche des mouvements de résistance ne reposait pas sur de larges comités. C’était un bloc entre partis, une caricature de Front populaire constituée face à la collaboration de la majorité de la bourgeoisie. Malgré le soutien dont elle jouissait auprès de milliers de combattants prolétariens loyaux, qui voyaient dans l’aile gauche de la Résistance une réponse à leurs aspirations de classe, le programme, la direction et les méthodes petites-bourgeoises chauvines de la Résistance en firent un instrument direct de l’impérialisme.
En pleine guerre impérialiste, les conditions objectives étaient telles qu’une véritable lutte pour la libération nationale et pour la rupture de l’alliance avec les impérialistes n’aurait été possible que sur la base d’un programme socialiste et du mot d’ordre des Etats-Unis socialistes d’Europe. Organiser la lutte sur d’autres bases, comme le firent les deux ailes de la Résistance, revenait à soutenir un des deux camps impérialistes dans le conflit.
Les trotskystes ne devaient pas souiller leur bannière en entrant dans ce bloc de partis et en soutenant cette caricature de Front populaire. Ils devaient soutenir et, si possible, diriger les véritables initiatives des masses – grèves, manifestations et affrontements armés – tout en dénonçant le bloc de la Résistance et sa direction comme des agents de l’impérialisme anglo-américain, dont les intérêts s’opposent à ceux de la classe ouvrière.
Pour s’opposer aux organisations militaires de la Résistance d’inspiration bourgeoise et petite-bourgeoise, le parti prolétarien devait soutenir – et si possible former lui-même – des organisations militaires ouvrières indépendantes et ses propres corps armés.
Cette implacable hostilité à l’égard du « bloc résistant » devait s’accompagner d’une tactique flexible dans l’application de la ligne du parti. Les organisations de résistance étaient d’importants terrains d’activité révolutionnaire. Le parti révolutionnaire devait y envoyer ses cadres pour opposer un programme prolétarien à celui de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, miner l’influence de la bourgeoisie sur les couches combatives de la classe ouvrière, et organiser une opposition prolétarienne consciente à la politique chauvine des dirigeants.
La « libération » du continent par l’impérialisme anglo-américain a posé la question de la lutte des classes sous une forme aiguë. Avec la fin de l’oppression totalitaire allemande, la question nationale est passée au second plan. Il faudrait que l’occupation militaire par les impérialistes anglo-américains ou la bureaucratie soviétique se prolonge pendant des années pour que cette question redevienne un sujet politique en Europe. En revanche, l’oppression indirecte et l’exploitation des peuples européens par les trois grandes puissances – ainsi que leur intervention militaire aux côtés des anciennes classes dirigeantes contre le prolétariat – font revenir la question de classe au premier plan dans les consciences. Il n’y a qu’en Allemagne que la question nationale se pose avec acuité, du fait du démembrement et de l’assujettissement du pays par les Alliés.
Les conditions classiques de la révolution prolétarienne
Déjà secouées par les grands mouvements de masses des années d’avant-guerre, la plupart des bourgeoisies européennes échouèrent à mener leurs nations dans la « défense de la patrie ». Démoralisées par la défaite militaire, privées de perspectives et remplies de haine à l’égard de leurs propres classes ouvrières, les classes dirigeantes de presque tous les pays conquis ont fraternisé avec l’ennemi. Elles ont collaboré avec l’oppresseur étranger pour organiser l’exploitation des masses de leurs propres nations. C’est ainsi que la bourgeoisie « collabo » s’attira la haine de la grande masse des travailleurs et de la petite bourgeoisie.
Face à la victoire des Alliés, la bourgeoisie cherche maintenant à jouer auprès de ces « libérateurs » le même rôle qu’elle a joué auprès des « conquérants ». Dépourvue d’organes stables de répression étatique, privée de la confiance dont toute classe exploiteuse a besoin, démoralisée et terrifiée par la colère montante des masses, elle dépend entièrement des baïonnettes alliées pour se maintenir au pouvoir.
A l’autre pôle, la masse des travailleurs ne veut plus de l’ancien régime. Elle a fait l’expérience d’une génération sous domination capitaliste depuis la Première Guerre mondiale, puis du rôle de sa classe dirigeante sous l’occupation nazie. Elle a connu le chômage et la famine, le fascisme et l’humiliation nationale. Elle a vu la classe dirigeante collaborer et s’enrichir tandis que les masses luttaient contre l’invasion étrangère. Tous ces facteurs – combinés avec les immenses victoires d’une Armée Rouge auréolée du prestige de la révolution d’Octobre – ont transformé l’état d’esprit des masses laborieuses.
Les travailleurs d’Europe sont en train de rompre avec la politique bourgeoise parlementaire et le réformisme social-démocrate. Ils s’orientent vers la révolution et le communisme, bien qu’à ce stade ce soit malheureusement sous la forme caricaturale et déformée qu’en offrent les partis staliniens.
La guerre totale et la défaite ont accéléré la concentration du capital et la ruine des classes moyennes, en particulier dans les villes. Un grand nombre de petits-bourgeois ont été brutalement poussés dans les rangs de la classe ouvrière. Jetés dans les usines et dans les camps de travail forcé, ils se sont prolétarisés. A mesure que la classe ouvrière se radicalise, la petite bourgeoisie connaît une évolution analogue.
Comme toujours, les couches les plus opprimées de la population – les femmes et la jeunesse – ont porté le plus lourd fardeau de la guerre. En découle l’aspiration à un changement radical et à une solution communiste aux problèmes du moment, en particulier dans la jeunesse.
Les conditions objectives du renversement du capitalisme et de la transformation socialiste de la société sont donc clairement réunies. Mais il manque encore le facteur subjectif. Il n’y a pas encore de partis révolutionnaires de masse de la IVe Internationale. La tâche brûlante de nos camarades européens est de hisser les petits groupes et partis trotskystes à la tête des luttes de la classe ouvrière. Sans puissants partis trotskystes, les masses égarées par la social-démocratie et, en particulier, par le stalinisme, frapperont vainement leurs têtes contre les remparts du capitalisme.
Si les classes dirigeantes peuvent respirer, c’est seulement parce que les cadres de la IVe Internationale sont peu nombreux et isolés. La direction de la bourgeoisie est consciente des besoins de sa classe, malgré sa démoralisation. Elle doit à tout prix écraser la classe ouvrière, mais n’en a pas encore les forces.
L’expérience de la Grèce
Les événements en Grèce [3] ont ouvert une nouvelle phase de révolution et de contre-révolution en Europe. Une guerre civile a éclaté dans ce petit pays, où l’énergie de la lutte des classes s’était accumulée pendant des siècles et qui est plongé dans l’instabilité depuis trois décennies. Les impérialistes britanniques y ont mené une sanglante guerre d’intervention.
Durant les affrontements entre royalistes et républicains de la période précédente, la bourgeoisie a été aussi incapable d’agir résolument contre les propriétaires terriens féodaux que de régler les problèmes de la révolution démocratique. Elle a donc pavé la voie à la réaction monarchiste.
La restauration du roi Georges fut suivie par la dictature de Metaxás, qui représentait une tentative de rétablir la « tranquillité » et la « paix » entre les classes [4]. Cette « expérience » visait à atomiser la classe ouvrière et le mouvement paysan, qui menaçaient de renverser l’ancien régime et d’avancer vers la révolution socialiste – comme l’indiquaient les grèves ouvrières et les révoltes de différentes couches de la paysannerie. En raison de leurs intérêts financiers et stratégiques, les impérialistes britanniques considéraient la Grèce comme une sous-colonie, et apportèrent leur appui à la classe dirigeante grecque dans cette entreprise réactionnaire.
Avant la guerre, la brutalité de la dictature de Metaxás avait déjà miné l’autorité de la classe dirigeante grecque et nourri un mouvement populaire de révolte. Mais la collaboration de la bourgeoisie grecque avec l’occupant allemand cristallisa l’hostilité des masses et provoqua une véritable explosion après le retrait des troupes allemandes.
Les masses grecques ne pouvaient tolérer sans combat qu’on rétablisse le pouvoir de la vieille classe dirigeante et, plus encore, qu’on restaure la monarchie. Elles avaient mené une guerre terrible et sanglante contre les SS, et joué le rôle principal dans la libération de la Grèce. Elles avaient de facto le pouvoir entre leurs mains, à travers l’organisation militaire de l’ELAS. Il a donc suffi que la police du gouvernement grec tire sur des manifestants désarmés pour qu’éclate une insurrection armée. Sans préparation, sans organisation et sans perspective claire sur la façon de l’emporter, les courageux prolétaires et paysans grecs passèrent à l’action. Mais l’absence d’une direction révolutionnaire provoqua la défaite de la lutte.
La direction stalinienne détourna le mouvement vers les eaux familières du « Front populaire », et limita ses revendications sociales à ce qui était acceptable dans le carcan du parlementarisme bourgeois. Ce faisant, les dirigeants staliniens pavaient la voie de la défaite et la capitulation.
Les événements en Grèce démontrèrent une nouvelle fois que l’absence d’un parti révolutionnaire condamne les masses au désastre, surtout quand la lutte des classes prend la forme d’une guerre civile ouverte. Sans parti, les masses ne peuvent pas conquérir le pouvoir.
Abstraction faite de ses spécificités locales, l’expérience grecque soulève des problématiques et des leçons qui concernent toute l’Europe. La répression acharnée menée par Churchill fut dictée à la fois par des considérations de stratégie impérialiste et par le rapport de force interne entre les classes. La bureaucratie stalinienne dominant les Balkans grâce aux victoires de l’Armée Rouge, les Britanniques avaient besoin de garder fermement le contrôle de la Grèce pour défendre leurs intérêts impérialistes en Méditerranée.
Mais en Grèce, les impérialistes découvrirent combien il est difficile de mener une politique de répression militaire ouverte en Europe. La fraction la plus réaliste et modérée de la classe dirigeante britannique s’opposa à la répression brutale et aventuriste mise en œuvre par Churchill. Même dans un petit pays de 6 millions d’habitants, une telle politique présente des risques, comme la suite des événements l’a démontré. L’impérialisme britannique a été forcé de conclure un compromis avec les traîtres petits-bourgeois qui dirigeaient le Front de Libération Nationale.
Le gouvernement Plastíras et son successeur, le gouvernement Voúlgaris, sont autant de tentatives maladroites de restaurer l’équilibre de la société bourgeoise en Grèce [5]. Il y a clairement des éléments de bonapartisme et de dictature militaire dans cet assemblage. Mais le compromis réalisé après la capitulation de la direction stalinienne a dû rester modéré, dans sa forme, du fait de la lutte des masses et des protestations du prolétariat britannique. Cela a permis aux masses de conserver leurs organisations qui, si elles ne sont pas complètement intactes, sont loin d’être détruites.
Cet équilibre précaire ne peut durer indéfiniment. Soit la monarchie sera restaurée, ce qui conduira inévitablement à la destruction des organisations du prolétariat, soit la réaction se sentira encore trop faible et tentera de manœuvrer à travers une République. Mais même dans ce dernier cas, le régime actuel ne pourra pas se maintenir longtemps. Il sera balayé dès que les masses se remettront en mouvement, et la bourgeoisie tentera alors de se servir à nouveau du Front populaire pour manipuler le jeu politique. Ceci dit, les développements en Grèce dépendront largement des événements en Europe de l’Ouest, dans les Balkans et en Grande-Bretagne. Une chose est sûre : le régime grec ira d’une crise à l’autre dans les temps qui viennent.
La contre-révolution sous une forme « démocratique »
La Grèce donne à voir les premiers éclairs de l’orage révolutionnaire qui se prépare en Europe. La bourgeoisie mondiale en a tiré les conclusions qui s’imposent : la base de l’ancien système s’est effondrée de part et d’autre de l’Europe en ruines. Privée de Hitler et de Mussolini, la réaction a perdu tout appui stable sur le continent, du moins dans l’immédiat.
Sur fond d’effervescence et de radicalisation des masses, que l’esprit de révolte pousse directement sur la voie de l’insurrection – et alors que la petite bourgeoisie, trois fois ruinée, remplie de haine et de dégoût pour les trusts et les monopoles, s’arrache à l’influence de la réaction capitaliste –, les impérialistes anglo-américains doivent opérer des manœuvres complexes pour rétablir « l’ordre » et la domination du capital en Europe. Le bâton ne suffira pas, à ce stade, pour diriger les masses : il faudra recourir à toutes sortes de carottes, comme le « progrès », les « réformes » et la « démocratie », présentées comme des antidotes aux horreurs du totalitarisme. En Europe, le contrôle de la situation a néanmoins largement glissé des mains de la bourgeoisie. Ce sont les organisations de masse de la classe ouvrière qui auront le dernier mot.
A la chute de Mussolini, une partie des ouvriers, des soldats et des paysans italiens ont immédiatement constitué des organisations de type soviétique, marquant la réapparition du prolétariat sur la scène politique. Ici aussi, les prémices d’une situation de double pouvoir étaient évidentes. Mais à nouveau, le développement de la révolution a été freiné par l’attitude des vieux partis ouvriers. La conscience des masses est encore à un stade élémentaire : elles ne veulent plus du capitalisme ni de l’ancien régime ; elles aspirent à suivre l’exemple des travailleurs russes dans la révolution d’Octobre ; mais elles ne comprennent ni le rôle de frein que jouent les vieux partis ouvriers dans le développement de la lutte, ni la nécessité d’un parti trotskyste de masse.
On observe des embryons de crises révolutionnaires dans toute l’Europe de l’Ouest. L’effondrement de la répression totalitaire a fait surgir les forces qui se développaient sous la surface. En Belgique comme aux Pays-Bas, et même en Scandinavie, les masses résistent à l’oppression et se défient des vieilles cliques gouvernementales revenues d’exil.
En Europe de l’Est aussi, le processus moléculaire de la révolution est à l’œuvre. L’héroïque insurrection des travailleurs de Varsovie [6] à l’approche de l’Armée Rouge – même si elle fut déformée et détournée par le Comité de Londres – témoigne de l’humeur des masses polonaises. La trahison préméditée de Varsovie par la bureaucratie stalinienne souligna son rôle contre-révolutionnaire en Europe et dans le monde.
Si elle devait affronter des partis révolutionnaires de masse de la classe ouvrière en Europe, la bourgeoisie serait dans une position désespérée. Mais comme l’expliquait Lénine, tant que l’avant-garde révolutionnaire est faible, aucune situation n’est désespérée pour la bourgeoisie. La social-démocratie a sauvé le capitalisme après la dernière guerre. Aujourd’hui, le capital a à son service deux « Internationales » dirigées par des traîtres : les staliniens et les sociaux-démocrates. Ils jouent le rôle de mercenaires du capital – aux côtés des directions des syndicats, qui ont immédiatement resurgi après le départ des nazis.
Les SS n’ont pas réussi à contrôler l’Europe. Après cette expérience, la bourgeoisie a compris qu’elle ne pourrait pas dominer les masses par de telles méthodes. Dans les organisations sociales-démocrates et staliniennes, elle a trouvé un instrument adapté et volontaire pour canaliser le réveil révolutionnaire des masses dans les voies inoffensives de la collaboration de classe – à travers une forme de Front populaire encore plus dégénérée que l’ancienne.
La bourgeoisie va donc combiner la répression avec des réformes illusoires : tout en écrasant les organes embryonnaires de pouvoir ouvrier et en désarmant les masses, elle va proclamer son amour pour le gouvernement « représentatif » et les libertés « démocratiques ». C’est le seul moyen, pour elle, d’empêcher les masses révoltées de renverser le système capitaliste. Dans ses premières phases, après un bref intermède de gouvernement militaire, la contre-révolution capitaliste prendra une forme « démocratique ». La bourgeoisie combinera des concessions trompeuses avec la répression des forces révolutionnaires.
En Europe, la révolution à venir sera nécessairement prolétarienne. Mais dans ses premières étapes, ce sont forcément les vieilles organisations du prolétariat qui prendront la tête des masses. Celles-ci apprendront à travers l’expérience que les sommets de ces organisations représentent les intérêts de leur ennemi de classe. Bien qu’elles sachent clairement ce qu’elles veulent, les masses ne savent pas encore précisément comment y parvenir. Tous ces facteurs conduiront à une période de kerenskysme [7] dans les premiers temps de la révolution européenne.
L’impérialisme anglo-américain pressent que, depuis la disparition de Hitler, la chute de Franco est inévitable et qu’elle provoquera des troubles révolutionnaires à travers toute la péninsule ibérique. Face au mécontentement croissant des masses, les impérialistes négocient et manœuvrent déjà avec des fractions de la bourgeoisie espagnole, avec Franco et avec des politiciens en exil, dans le but de décapiter le mouvement révolutionnaire.
Une insurrection en Espagne aurait de puissantes répercussions dans le reste de l’Europe. C’est ce qui explique les tentatives de trouver un Badoglio [8] espagnol, pour préparer une alternative « tranquille » et « pacifique » au régime condamné de Franco. Qu’ils y parviennent ou non, ils ne pourront que retarder temporairement le mouvement des masses. Mais les représentants sérieux du capital financier ont appris bien plus de l’expérience des dernières décennies que ne l’ont fait les traîtres « dirigeants » de la classe ouvrière. Pour ces bourgeois, la transition d’un régime à l’autre est déterminée par ce qui sert le mieux les intérêts de la classe dirigeante.
Les bourgeoisies de Grande-Bretagne et d’Amérique ne sont pas en mesure d’imposer un joug totalitaire étranger aux peuples d’Europe, fût-ce temporairement. Le rôle du Kremlin est essentiel à cet égard. Tout en étant terrifié par la victoire de la révolution prolétarienne, le Kremlin a intérêt à préserver partout où c’est possible la plus grande liberté d’action pour ses relais, les partis communistes. La victoire de la réaction à travers l’Europe raviverait le danger d’une intervention impérialiste contre l’Union Soviétique. La politique de la bureaucratie soviétique consiste donc à garantir le règne du capital, tout en assurant l’existence du mouvement ouvrier pour qu’il lui serve de garde-fou contre la bourgeoisie.
Les masses européennes voient dans l’Union Soviétique un porte-drapeau du socialisme. Pour l’heure, les démocraties capitalistes sont obligées d’en tenir compte. Sur la base du maintien du capitalisme en Europe, elles acceptent de nouer des compromis avec la bureaucratie soviétique. Elles n’ont d’ailleurs pas d’autre choix.
Les expériences de la révolution russe, de la révolution allemande de 1918 et de la révolution espagnole de 1931 renforcent toutes ces conclusions. En Espagne, le soulèvement des masses avait conduit au renversement de la monarchie et à la proclamation de la République par la bourgeoisie. La coalition gouvernementale des républicains bourgeois et des socialistes défendait formellement un programme radical tout en réprimant les ouvriers et les paysans. Un tel gouvernement ne peut durer longtemps. Le régime de la République espagnole alla de crise en crise. Les flux et les reflux de la radicalisation et de la réaction culminèrent, au bout de cinq ans, dans une guerre civile sanglante et désespérée entre la bourgeoisie et le prolétariat.
Le processus des événements en Espagne se reproduira à l’échelle européenne. Les pays arriérés et les pays avancés sont tous frappés par la même crise, à divers degrés. De la Volga à la mer du Nord, de la mer Noire à la Baltique, presque toute l’Europe a été réduite à la ruine et au chaos. Il n’y a pas de base stable pour la démocratie bourgeoise. Même la relative « stabilité » que connaissait la République espagnole est inaccessible. Les événements d’Italie et de Grèce sont le présage de la période la plus révolutionnaire de l’histoire de l’Europe.
Le programme des Alliés pour l’Europe
Avec l’aggravation de la crise du capitalisme, les dispositions du programme que les Alliés prévoient pour l’Europe sont bien pires que celles du traité de Versailles. Alors que les nazis voulaient unifier le continent par la force pour en faire un gigantesque camp de concentration, les Alliés souhaitent atomiser et découper l’Europe, selon la méthode qui a conduit à la catastrophe après la dernière guerre. L’Europe sera la proie des impérialismes britannique et américain, tandis que certaines régions deviendront des satellites dans la sphère d’influence de la bureaucratie soviétique.
Même sous les auspices du capitalisme, une Europe unifiée serait un rival trop menaçant pour l’impérialisme britannique et américain. Et la bureaucratie soviétique est résolument opposée à l’unification – même partielle – du continent dans une fédération capitaliste, car cela poserait inévitablement les bases d’une nouvelle guerre contre l’URSS. C’est pourquoi Staline, de concert avec Truman [9] et Churchill, prône la balkanisation de l’Europe et le démembrement de l’Allemagne, qu’il considère comme le seul adversaire à sa taille dans une potentielle guerre continentale.
L’impérialisme américain est poussé par l’immensité de ses ressources et de ses capacités productives à « organiser » le monde entier, pour échapper à la contradiction entre ce qu’il est capable de produire et les limites de ce que son vaste marché intérieur peut absorber. L’Amérique cherche à remplacer l’Europe – et surtout l’impérialisme britannique décrépit – et à accaparer tous les marchés de la planète. Les pays coloniaux ne lui suffisent pas : l’Amérique veut étendre son emprise sur les marchés et les industries d’Europe, et imposer le règne du dollar aux monnaies et aux économies européennes.
Le capital financier américain compte profiter du chaos et de la désorganisation entraînés par la guerre en Europe pour rationner le continent, en lui fournissant des prêts, de la nourriture et des équipements. En temps de crise, cela lui donnera un moyen de pression pour menacer et corrompre les révolutions.
La sauvagerie de l’impérialisme anglo-américain en Allemagne n’est pas seulement dictée par un projet d’asservissement et d’exploitation, mais aussi par la crainte de la révolution prolétarienne. En quelques décennies, le peuple allemand a fait l’expérience de tous les types de régimes bourgeois. Son prolétariat et sa petite bourgeoisie vont inévitablement s’orienter vers la révolution socialiste.
C’est en Allemagne que la bourgeoisie va découvrir combien ses plans pour préserver l’ancien système sont utopiques. Toutes les tentatives de réprimer les fraternisations vont échouer dès lors qu’il faudra occuper durablement le pays. Les « Tommies » et les « Doughboys » [10] considèreront que leur mission en Europe est remplie. Ils réclameront d’être démobilisés et de pouvoir rentrer chez eux, pour profiter de ce monde meilleur que la bourgeoisie leur a promis. La lutte du prolétariat allemand contre les forces d’occupation, contre l’humiliation nationale et le démembrement de l’Allemagne, cette lutte pour la liberté nationale et sociale menée sous le joug de l’occupant, préparera une puissante résistance de la part des masses.
Avec leur programme réactionnaire d’asservissement national, les staliniens ne feront pas longtemps illusion auprès des masses allemandes. Le prolétariat allemand regroupera bientôt ses forces dans une direction révolutionnaire. L’expérience italienne montre combien les masses peuvent rapidement se relever de terribles défaites sous le coup des événements historiques. Les ressources et la disposition au combat du prolétariat semblent presque inépuisables.
La balkanisation de l’Allemagne et de l’Europe, l’occupation anglo-américaine à l’Ouest, les prétentions de la France et la domination de pantins bourgeois du Kremlin à l’Est auront de bien pires conséquences sur le continent torturé que n’en eut la « paix » de Versailles. A l’heure des aéroplanes et des divisions blindées, l’absurdité des frontières nationales, des barrières douanières et de la division de l’Europe en petits et grands Etats conduira au désastre. Les forces productives seront lentement étranglées et la culture européenne déclinera. Les grandes puissances – dont aucune n’est européenne, désormais – saigneront l’Europe pour parvenir à leurs fins. La période qui vient sera faite de guerres, de révolutions et de contre-révolutions – toutes intensifiées par l’expérience des décennies passées.
Il est possible que, grâce au répit que lui offrent le stalinisme et le réformisme traditionnel (c’est un facteur objectif qu’il faut prendre en compte), l’impérialisme mondial parvienne à « stabiliser » temporairement des régimes bourgeois démocratiques dans certains pays. Le stalinisme a besoin de garantir des conquêtes aux masses, notamment le rétablissement des syndicats, une relative liberté d’expression et de la presse (comme en Espagne en 1931) et le droit de vote – le tout sous une forme plus ou moins atténuée. Quant aux impérialistes, ils ont besoin d’un intermède « démocratique » avant de reprendre la voie de la réaction. Ils n’ont pas le choix : les secousses de la guerre et la débâcle du fascisme ont détruit toute base de masse pour la réaction, dans l’immédiat. Il serait difficile d’établir des dictatures militaires sans base sociale pour les soutenir. Et de tels régimes ne tiendraient pas longtemps après le départ des troupes britanniques et américaines. L’élan orageux des masses les force donc à utiliser leur arme de secours : les organisations ouvrières.
On ne peut pas exclure que les impérialistes anglo-américains et les bourgeoisies nationales parviennent ponctuellement à imposer d’emblée des dictatures militaires. Mais celles-ci ne pourront pas durer longtemps sans base sociale dans les masses. Sur fond d’instabilité et d’affrontements en Europe et dans le monde, ces régimes seront la proie de crises et de convulsions.
Cette analyse des événements ne doit pas nous conduire à des conclusions pessimistes, bien au contraire. Mais elle impose à la IVe Internationale d’utiliser la situation pour se préparer aux chocs qui attendent les impérialistes. Notre époque est marquée par de brusques tournants. Après la révolution de 1931, les événements évoluèrent très vite en Espagne [11] : les masses se soulevèrent, les réformistes trahirent, les anarcho-syndicalistes et les staliniens furent incapables de constituer une direction révolutionnaire (et en particulier d’avancer des mots d’ordre démocratiques et transitoires). S’ensuivit une brève accalmie, pendant laquelle la réaction se prépara à régler ses comptes avec les masses déçues et désespérées par leur direction. Puis les masses réagirent au fouet de la contre-révolution par une grève générale et une insurrection dans les Asturies et en Catalogne. La réaction ne parvint pas à se consolider. Les masses se réveillèrent, et le Front populaire fut formé pour les brider. Après les élections de février 1936, les ouvriers et les paysans s’élancèrent vers la révolution socialiste, sans que les réformistes et les staliniens ne parviennent à les contrôler. Finalement, Franco fit un coup d’Etat et les masses y répondirent par une insurrection.
Voilà un aperçu de ce qui attend l’Europe. Les cadres de la IVe Internationale doivent soigneusement étudier les leçons de ces événements. A chaque étape correspondent des mots d’ordre, une tactique, des méthodes d’agitation et de propagande, et des modes d’action des masses.
C’est sur ce fond de crise étendue à l’échelle du continent, débordant les frontières nationales archaïques, que seront créées les conditions objectives pour l’établissement des Etats-Unis socialistes d’Europe, seule solution aux tourments qui agitent tous les pays.
Les conséquences de la guerre, la lutte des peuples contre l’occupation nazie, l’exemple de la fédération d’URSS, la riposte à venir contre la domination des Alliés, l’inévitable réaction aux poisons du nationalisme et du chauvinisme, et la radicalisation des masses européennes fourniront une base subjective à notre propagande pour les Etats-Unis socialistes d’Europe, qui trouvera un écho dans les masses. Ce sera la colonne vertébrale du programme de la IVe Internationale : les Etats-Unis socialistes d’Europe comme seule alternative au déclin et à la désintégration des nations, à l’effondrement de la culture et de la civilisation dans tous les pays du continent.
Nos tâches en Europe
La IVe Internationale ne pénètrera les masses et ne construira le parti de la révolution socialiste que si elle adopte une tactique correcte face aux transformations de la situation et de la conscience.
Il faudrait toute une série de terribles défaites pour que la bourgeoisie parvienne à établir une dictature ouverte, semblable aux régimes fascistes de Hitler et Mussolini. Un nouveau cycle s’est ouvert, sur de nouvelles bases. Le déclin du système capitaliste a affaibli la bourgeoisie et son emprise sur les masses. Le monde fait face à un nouveau 1917-1921, mais à un niveau supérieur.
La dégénérescence des organisations ouvrières offre un répit aux capitalistes. Il faudrait que la série des révolutions échoue pour que la bourgeoisie tente à nouveau de sauver son système par la répression, en instaurant une réaction néo-fasciste. D’ici là, les masses auront été mises à l’épreuve. Le prolétariat abandonnera ses vieilles organisations si la IVe Internationale parvient, grâce à sa stratégie et à sa tactique, à fusionner avec le mouvement de masse des travailleurs.
La tâche fondamentale de la période est de bâtir des partis révolutionnaires de masse de la IVe Internationale. Nos camarades européens n’y parviendront pas dans l’immédiat – même s’ils devront, entre temps, défendre la formation d’organisations de combat ad hoc, et expliquer la nécessité de la dictature du prolétariat partout où ils le peuvent. Les masses cherchent certes une solution socialiste, mais il leur faudra d’abord passer par l’expérience de la trahison des staliniens et des sociaux-démocrates, pour comprendre que même leurs anciennes conditions de vie ne pourront être obtenues qu’à travers la dictature de la classe ouvrière.
La lutte pour les revendications démocratiques, économiques et transitoires n’est pas dépassée, ni devenue obsolète dans la période révolutionnaire qui s’annonce. Au contraire : elle jouera un rôle crucial pour construire l’armature de notre mouvement. Parallèlement à la propagande pour les soviets et le gouvernement des travailleurs, nous devrons mener une agitation en direction des vieilles organisations ouvrières qui jouissent encore de la confiance et du soutien des masses, les appeler à rompre leur alliance avec la bourgeoisie décadente et l’impérialisme allié, et appeler leurs chefs à traduire leurs paroles en actes.
Nos camarades doivent réclamer que les organisations de masse qui prétendent représenter les travailleurs mènent la lutte pour prendre le pouvoir. La IVe Internationale doit revendiquer l’instauration d’un « gouvernement des socialistes et des communistes », pour mobiliser les travailleurs sociaux-démocrates et communistes dans la lutte contre la classe capitaliste.
Il faudra également réclamer la tenue d’élections générales, sur la base du suffrage universel à partir de dix-huit ans. La bourgeoisie et les organisations réformistes ont beau bavarder sur les droits démocratiques, elles ont laissé le pouvoir entre les mains de cliques bourgeoises, souvent protégées par les baïonnettes alliées, sans consulter les masses ni recevoir de mandat de leur part. C’est pourquoi l’appel à des élections générales et à la convocation d’une Assemblée constituante doit jouer un grand rôle dans l’agitation de nos camarades aux premières étapes de la mobilisation révolutionnaire des masses.
Ces revendications doivent être liées à des mots d’ordre transitoires, dans les différentes industries et à chaque étape de la lutte. Nationalisation des banques sans compensation ! Saisie des mines, des chemins de fer, des cartels et des industries – sous contrôle ouvrier ! Expropriation des trusts qui collaboraient hier avec Hitler et collaborent aujourd’hui avec les impérialistes alliés ! Un plan de travaux publics ! L’échelle mobile des salaires et des heures de travail ! L’armement des travailleurs et la constitution de milices ouvrières !
Il n’est pas nécessaire de développer ici toutes les revendications que nous mettrons en avant au fil des développements de la situation, en suivant la politique de la IVe Internationale telle qu’elle est exposée dans le Programme de transition. Ces revendications n’entrent pas en contradiction avec le programme des soviets, ou des comités ouvriers, dans les usines et dans les rues. Mais sans elles, les groupes de la IVe Internationale risquent de dégénérer dans la stérilité et l’isolement sectaires. Ce sont des ponts qui nous relient aux masses, et sans lesquels nous aurons grand mal à organiser l’avant-garde.
C’est dans une telle période que se construira le parti de la IVe Internationale. Les partis staliniens et sociaux-démocrates ne retrouveront pas la stabilité d’avant-guerre. Ils seront confrontés à une série de crises et de scissions. Avec une tactique correcte, les sections de la IVe Internationale pourront grandir à leurs dépens. Néanmoins, d’éphémères courants et groupements centristes surgiront inévitablement dans de nombreux pays, étant données la faiblesse des organisations de la IVe Internationale et l’absence de porte-paroles faisant autorité comme Léon Trotsky. Mais notre autorité grandira à mesure que nos cadres apprendront à se former dans les luttes, et que les masses feront l’expérience du programme de la IVe Internationale.
[1] Le nom de la section britannique de la IVe Internationale, à l’époque.
[2] Napoléon Zérvas était le chef de l’EDES (Ligue nationale démocratique grecque), une organisation de résistance contre les nazis qui devint un instrument de l’impérialisme britannique et des monarchistes grecs lors de la guerre civile de 1944-1949. Georges Siantos dirigea le KKE (Parti Communiste Grec) de 1942 à 1945. Josip Broz, dit Tito, était le dirigeant des partisans dans la résistance yougoslave. Le Parti Communiste Yougoslave rompit avec Moscou en 1948. Le terme « maquis » désigne l’ensemble des groupes de résistance ruraux en France. En revanche, dans les villes comme dans les campagnes, les FTP (Francs-tireurs et partisans) communistes se distinguaient de l’Armée secrète, de droite.
[3] Début octobre 1944, une guerre de libération menée par les ouvriers et paysans grecs de l’ELAS (Armée de libération du peuple grec) – l’aile militaire du Front de Libération Nationale (EAM) dirigé par le Parti Communiste – mit fin à l’occupation allemande. Après le départ des forces allemandes d’Athènes, les troupes britanniques débarquèrent afin de restaurer la monarchie grecque et d’empêcher les masses en armes de garder le pouvoir. En décembre 1944, les forces britanniques commencèrent à désarmer l’ELAS, et une guerre civile éclata. Un armistice fut signé en février 1945, mais la guerre civile reprit de 1946 à 1949, faisant 158 000 morts.
[4] Georges II avait régné sur la Grèce de 1913 à 1924. Rétabli sur le trône en 1935, il nomma Ioannis Metaxás Premier ministre. Metaxás exerça des pouvoirs dictatoriaux de 1936 à 1941.
[5] Le général Nikólaos Plastíras, de l’Union du centre nationale progressiste, devint Premier ministre d’un gouvernement fantoche pro-britannique en décembre 1944. L’amiral Voúlgaris, qui lui succéda en avril 1945, était le commandant de la flotte grecque. Il avait dirigé la répression d’une mutinerie antifasciste dans les navires du port d’Alexandrie en avril 1944.
[6] En août 1944, les travailleurs de Varsovie se soulèvent contre l’occupation allemande. En deux jours, ils prennent le contrôle de la ville. L’armée russe, qui avait été stoppée par les Allemands à 24 km de Varsovie, ne tente pas d’avancer. Elle laisse les travailleurs se battre seuls pendant plusieurs semaines. Staline a décrit l’insurrection comme une « aventure irresponsable » et une « bagarre insensée dirigée par des aventuriers ». Les nazis reprirent le contrôle de Varsovie après 63 jours de résistance héroïque. 93 % de la ville fut détruite et 240 000 de ses habitants périrent. Le « Comité de Londres » était le gouvernement polonais en exil depuis 1940.
[7] Du nom d’Alexandre Kerensky, qui gouverna la Russie de juillet à octobre 1917 en s’appuyant sur diverses combinaisons de partis réformistes et capitalistes.
[8] Pietro Badoglio, général italien, devint Premier ministre après la chute de Mussolini en 1943. Il négocia l’armistice avec les Alliés en Italie du Sud, tout en désarmant les travailleurs du Nord qui avaient occupé les usines pour s’opposer à l’occupation allemande.
[9] Harry Truman, président démocrate des Etats-Unis de 1945 à 1953. Il développa la doctrine Truman, qui consistait à « aider » économiquement et militairement les pays menacés d’« interférence », et adopta en 1948 le plan Marshall d’aide économique pour empêcher la révolution en Europe.
[10] Termes argotiques désignant les soldats britanniques et américains.
[11] Après les élections municipales d’avril 1931, la nette victoire des partis républicains força le roi Alfonso à abdiquer. S’ensuivit une vague de grèves massive. Les Asturies se soulevèrent en 1934. Le Front populaire fut élu en février 1936. Franco se rebella en juillet 1936.