Histoire
- Détails
- Kassim
Jeanne Labourbe, de son vrai nom Marie Labourbe, est née en 1877 à Lapalisse, une petite ville de l’Allier. Issue d’une famille pauvre d’anciens communards, Marie commence à travailler à 14 ans comme repasseuse dans la blanchisserie d’un hôtel. C’est là qu’en 1896, elle apprend qu’on recherche une gouvernante française pour les enfants d’une famille bourgeoise de Tomachow, une petite ville industrielle de Pologne, qui appartient alors à la Russie tsariste. La jeune Marie Labourbe saute sur cette occasion de rompre avec sa misère. Elle répond à l’annonce et part pour la Russie.
Militante clandestine dans l’Empire tsariste
A Tomachow, elle se fait de nombreux amis polonais et commence aussi à fréquenter un des cercles marxistes clandestins qui se développent alors dans l’Empire tsariste. A cette époque, le développement du capitalisme stimulé par les investissements étrangers fait émerger en Russie des îlots d’industrie moderne perdus au milieu d’un océan d’arriération rurale. C’est tout particulièrement le cas dans les capitales Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi dans le Caucase et dans les provinces occidentales de l’Empire, notamment en Pologne. Un jeune et vigoureux mouvement ouvrier s’y développe. Des grèves éclatent et se multiplient, tandis que s’organisent de petits cercles marxistes d’ouvriers.
Marie Labourbe s’engage très vite dans l’action politique et participe notamment à un réseau qui aide des militantes à quitter le pays pour fuir la répression du régime tsariste. D’après certaines sources, elle aurait même alors rencontré Rosa Luxembourg qui venait de créer le premier parti marxiste polonais, la Social-Démocratie de Pologne et Lituanie.
Quelques années plus tard, Jeanne Labourbe revient brièvement en France passer un examen pour obtenir un diplôme d’institutrice et repart immédiatement en Russie. Son nouveau travail de professeur de français est une couverture parfaite pour son activité politique. Il lui permet en effet de voyager sans attirer l’attention entre les différentes villes de l’Empire où elle enseigne et de transmettre ainsi des messages et du matériel.
En 1905, la première révolution russe éclate. Des conseils ouvriers – les soviets – se constituent dans toutes les villes ouvrières du pays. Jeanne Labourbe y participe avec enthousiasme et prend souvent la parole durant des meetings dans les usines. Mais cette première révolution est un échec. Après avoir concédé quelques réformes démocratiques (qu’il reprendra très vite), le régime tsariste écrase dans le sang l’insurrection ouvrière de Moscou puis déchaîne une répression brutale à l’échelle de toute la Russie.
Marie Labourbe est arrêtée, et après un passage en prison, expulsée de Russie comme « élément indésirable ». Cela ne la décourage pas. Quelques mois plus tard, elle revient clandestinement en Russie et y rejoint les Bolcheviks, la tendance dirigée par Lénine qui s’oppose aux Mencheviks réformistes au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR). Pour tromper la police tsariste, Marie Labourbe adopte alors le prénom de « Jeanne », sous lequel elle va militer jusqu’à sa mort.
En février 1917, une nouvelle révolution balaie le tsarisme et porte au pouvoir un gouvernement provisoire bourgeois soutenu par les réformistes, tandis que des soviets réapparaissent. Dès ce moment-là, Lénine et Trotsky prônent la prise du pouvoir par la classe ouvrière organisée dans les soviets. Après de longs mois de lutte politique et d’explications patientes, en octobre 1917, les bolcheviks finalement majoritaires font approuver en octobre par le congrès des soviets de toute la Russie l’insurrection qui vient de renverser le gouvernement provisoire. La classe ouvrière russe a pris le pouvoir. Elle va devoir le défendre.
Si, à Petrograd, la prise du pouvoir a été relativement indolore, à Moscou où milite Jeanne Labourbe, la situation est plus difficile. Profitant des hésitations des dirigeants bolcheviks locaux, les partisans du gouvernement provisoire s’organisent en une « Garde blanche », en référence aux contre-révolutionnaires de la Révolution française, et massacrent les soldats de la garnison du Kremlin, qu’ils soupçonnent de sympathies révolutionnaires. Il faut quatre jours de combat pour que la Garde rouge des ouvriers et des soldats révolutionnaires de Moscou prenne le contrôle de la ville. La contre-révolution semble vaincue, mais elle va bénéficier d’une puissante aide extérieure.
A Odessa
Dès octobre 1917, la plupart des grandes puissances impérialistes, effrayées par la révolution russe, apportent une aide massive aux forces contre-révolutionnaires vaincues. L’argent et les armes coulent à flots sur les armées blanches. Des troupes britanniques débarquent dans le Caucase et dans la région d’Arkhangelsk, dans le nord de la Russie. Les Japonais et les Américains occupent l’Extrême-Orient russe. Les troupes allemandes envahissent l’Ukraine et les Pays baltes. Après la révolution allemande de novembre 1918 et la fin de la Première Guerre mondiale, l’armée française débarque à son tour en Ukraine pour y soutenir l’armée du général « blanc » Dénikine.
Cette nouvelle est un choc pour Jeanne Labourbe, qui participe alors à l’animation d’un groupe de militants français organisés au sein du parti communiste russe. Comme elle l’écrit elle-même, « l’idée que les fils des communards de 71, les descendants des révolutionnaires de 93, viennent étouffer la grande révolution russe est tout simplement insupportable ». Elle demande donc au comité central de l’envoyer clandestinement dans la zone occupée par les troupes françaises. Bien qu’elle soit précieuse pour le travail organisé à Moscou, sa demande est acceptée et Jeanne Labourbe traverse la ligne de front de la guerre civile, avec un groupe de propagandistes clandestins.
Au début de janvier 1919, elle est à Odessa. Cette ville ouvrière de la côte de la Mer Noire est alors occupée conjointement par les troupes blanches et par l’armée française. Malgré la terreur blanche qu’elles y font régner, le parti communiste a réussi à y maintenir un réseau de cellules clandestines. Ses militants ont même installé une imprimerie dans les immenses catacombes d’Odessa, qui sont tellement étendues que les agents blancs ne s’y aventurent jamais, de peur de se perdre.
A Odessa, Labourbe est une des principales animatrices du travail de propagande destiné aux soldats français. Elle et ses camarades les abordent et, dès que c’est possible, discutent avec eux et leur expliquent ce qu’est réellement la révolution russe et pourquoi leur gouvernement les a envoyés la combattre. Un café, le « Découverte des Dardanelles », sert même de salle de réunion clandestine.
Tous ceux qui ont connu alors Jeanne Labourbe soulignent son talent remarquable d’oratrice et de propagandiste, en même temps que son « flair » qui lui permet de repérer rapidement les soldats et les marins qui peuvent être gagnés au communisme. Une fois convaincus, ces hommes doivent à leur tour en convaincre d’autres, pour organiser des cellules clandestines au sein même de l’armée française.
Pour les y aider, un journal en français, Le Communiste, est édité clandestinement sous la direction de Jeanne Labourbe. Il publie des nouvelles sur le mouvement ouvrier français ou sur la situation en Russie, mais aussi des lettres de soldats et de marins français qui dénoncent le comportement de leurs officiers et affirment leur solidarité avec la révolution russe. Ce journal, ainsi que les tracts en français publiés par les communistes d’Odessa, tranchent avec le bourrage de crâne de la propagande officielle qui décrit la révolution russe comme une aventure barbare dirigée par des agents de l’Allemagne.
Ce travail de propagande a un succès certain. Dans ses souvenirs, le soldat Lucien Terion souligne la joie de ses camarades à chaque fois qu’il ramenait des tracts ou des journaux communistes. Dans un grand nombre de navires et de casernes, des « groupes d’action » communistes ont été créés, au grand dam des officiers français qui sentent monter l’hostilité de leurs hommes. Les services secrets français font donc de la lutte contre la propagande communiste et le groupe de Labourbe une priorité.
Ayant réussi à introduire un provocateur dans le réseau, ils arrivent à repérer l’appartement où se cache Jeanne Labourbe et ses camarades. Le soir du 1er mars 1919, des officiers français accompagnés par des officiers russes blancs en forcent la porte. Labourbe et plusieurs de ses camarades, arrêtés, sont amenés dans les locaux des services secrets français à Odessa, où ils sont longuement torturés sans rien avouer.
Les prisonniers sont finalement emportés de nuit dans un des cimetières d’Odessa pour y être assassinés. Le lendemain matin, leurs corps sont découverts par les travailleurs des alentours. Les funérailles rassemblent près de 7 000 personnes. Par crainte des dénonciations, aucun discours n’est prononcé. C’est silencieusement que la classe ouvrière d’Odessa rend hommage à ces militants tombés sous les coups de la terreur blanche.
A peine un mois plus tard, les troupes françaises démoralisées sont contraintes d’évacuer le port d’Odessa face à l’avance de l’Armée rouge. La propagande révolutionnaire organisée par Labourbe y a sans aucun doute aidé : des unités françaises ont même refusé de combattre les troupes rouges. Un mois plus tard, ce sont plusieurs navires français qui vont être secoués par les fameuses « Mutineries de la Mer Noire ». Sur la côte roumaine et en Crimée, des marins français se révoltent contre leurs officiers. Certains réclament de rentrer en France, d’autres veulent carrément passer du côté bolchevik et livrer leurs navires à l’Armée rouge.
Les mutineries sont finalement contenues, mais elles obligent le gouvernement français à mettre fin à son intervention militaire contre la Russie soviétique. Les généraux blancs sont furieux, car ils savent pertinemment que, sans l’appui français, ils ne peuvent résister à l’Armée rouge. A la fin avril 1919, l’Etat-major français est finalement contraint de négocier avec le gouvernement soviétique, pour pouvoir évacuer ses troupes encerclées en Crimée. Le même scénario s’est reproduit parmi les troupes britanniques devant Arkhangelsk. Partout, la propagande communiste organisée par des militants comme Jeanne Labourbe a rencontré un écho chez les soldats des corps expéditionnaires impérialistes.
La révolution de 1917 n’était pas qu’une « affaire russe ». C’était un épisode de la lutte des classes internationale entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. En sacrifiant sa vie pour aider la Russie soviétique à résister aux assauts de l’armée de sa propre bourgeoisie, Jeanne Labourbe a donné au monde un exemple concret d’internationalisme communiste.
- Détails
- La rédaction
Paris, février 1962. La perspective d’une fin de la guerre d’Algérie semble s’être éloignée depuis la suspension des pourparlers de paix, le 28 juillet 1961, entre le GPRA. (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) et le gouvernement français. Cependant, dans les arcanes du pouvoir, tout le monde s’accorde à dire que la seule issue possible est l’indépendance de l’Algérie. S’accrochant désespérément à leur rêve d’une Algérie française, les fascistes de l’OAS. (Organisation Armée Secrète), multiplient les attentats en Algérie et en Métropole. Cette stratégie de la terreur vise à mettre la pression sur le gouvernement français, qui se dit de plus en plus favorable à de nouvelles négociations avec le GPRA.
Face à ce « péril brun », les milieux de gauche se mobilisent autour du Comité Audin (Comité d’intellectuels luttant pour faire la lumière sur la disparition de Maurice Audin, militant du Parti Communiste Algérien), du PCF, de l’UNEF, et du PSU. Dans les universités, des journées de grève sont organisées avec succès, ce qui pousse de Gaulle à déclarer : « Le peuple n’a pas à se préoccuper du problème de l’OAS ; c’est aux forces de l’ordre d’agir ». Cependant, les forces de l’ordre ne sont pas aussi zélées dans leur lutte contre le terrorisme de l’OAS que dans la répression des sympathisants de la cause algérienne. Le 7 février 1962, dix attentats sont commis, à Paris, par l’OAS. Les cibles sont des universitaires, des élus du PCF, des officiers, des journalistes ainsi que le Ministre de la Culture, André Malraux. La bombe qui visait ce dernier blesse grièvement une enfant de quatre ans, Delphine Renard, qui perdra un œil et sera défigurée.
Cette vague d’attentats pousse la gauche à organiser un rassemblement, le 8 février 1962, place de la Bastille à Paris. Or, suite à l’état d’urgence décrété le 21 avril 1961, un arrêté préfectoral interdit toute manifestation sur la voie publique. Cependant, selon certains historiens (dont le Professeur Brunet), le préfet de Paris de l’époque, Maurice Papon, avait envisagé de tolérer la manifestation du 8 février. C’est le Général de Gaulle lui-même qui se serait opposé à ce que le rassemblement ait lieu, après l’avoir qualifié de « communiste », ce qui, dans sa bouche, signifiait clairement « subversif », voire « dangereux ». De plus, l’interdiction de cette manifestation flattait l’aile droite de ses partisans, en montrant que de Gaulle ne jouait pas le jeu des communistes dans la solution du conflit algérien.
Le jour de la manifestation, les consignes sont claires : il ne faut tolérer aucun rassemblement et « faire preuve d’énergie » dans la dispersion des manifestants. Cette « énergie », les policiers dépêchés sur place vont la fournir de façon dramatique. Le quadrillage de la manifestation est parfait ; c’est en direction d’une véritable toile d’araignée policière que se dirigent les manifestants, à partir de 18h00. 2845 CRS, gendarmes mobiles et policiers sont organisés en cinq divisions entourant le quartier de la Bastille, de la gare de Lyon aux métros Filles du Calvaire et Saint Ambroise, et de la rue Saint Antoine au boulevard Voltaire.
Côté manifestants, on souhaite un rassemblement pacifique ; un communiqué radio précise, le 8 février, que « les manifestants sont invités à observer le plus grand calme ». En outre, les organisateurs prennent la décision de ne pas défiler, estimant que la police ne chargerait pas un rassemblement statique.
A l’heure du rassemblement, les manifestants se heurtent aux forces de l’ordre. Certains sont reflués sur la rive gauche, alors que, sur la rive droite, la tension monte peu à peu. En effet, quelques affrontements se déclenchent boulevard Beaumarchais. La réponse policière est terrible. On matraque des manifestants, des passants, les hommes, les femmes et personnes âgées, jusque dans les cafés et les stations de métro. L’acharnement est tellement aveugle que même des policiers en civil seront blessés.
Mais c’est boulevard Voltaire et rue de Charonne que la répression est la plus violente. Alors que les organisateurs donnent le signal de dispersion, les forces de l’ordre, commandées par le Commissaire Yser, chargent le cortège. En effet, sur ordre de la salle de commandement, c’est-à-dire du Préfet Papon, il faut « disperser énergiquement » les manifestants. Les policiers chargent avec une telle brutalité et de façon si soudaine, qu’un mouvement de panique s’empare des manifestants, qui tentent de fuir vers la station de métro la plus proche.
Les premières cibles des forces de l’ordre sont des élus communistes, qu’ils frappent à la tête. Puis, c’est au tour des manifestants qui, portés par la foule, trébuchent dans les escaliers du métro et s’entassent les uns sur les autres. Au lieu d’aider les gens qui suffoquent, les policiers les frappent, les insultent, et n’hésitent pas à jeter sur eux les grilles d’acier qu’ils trouvent au pied des arbres, ou encore des grilles d’aération. Le bilan de cette agression fut de huit morts, dont un manifestant de quinze ans. Sept d’entre eux sont morts par étouffement, un des suites de blessures à la tête. Tous étaient communistes.
Au lendemain du drame, la presse, de façon unanime, stigmatise la responsabilité des forces de l’ordre. Le Ministre de l’Intérieur, Roger Frey, rejette quant à lui toute la responsabilité sur le Parti Communiste, qu’il accuse d’avoir tenu la manifestation malgré l’interdiction officielle. Au passage, le ministre assimile les manifestants aux fascistes de l’OAS, car ce sont là, explique-t-il, « deux ennemis de l’intérieur ». De son côté, la population française est largement choquée par ce déchaînement de répression : entre 500 000 et un million de parisiens assistèrent aux funérailles des victimes.
Cet épisode de la vie politique française témoigne une fois de plus de l’amnésie historique de l’État français, sur certains sujets. Pendant des années, le drame du 8 février 1962 sera relégué aux oubliettes de l’histoire officielle. Il faudra attendre quatre décennies pour voir la réouverture des dossiers sur la guerre d’Algérie, le début d’une prudente autocritique de la part de l’État, et pour que la lumière commence à se faire sur les événements qui ont coûté la vie aux huit victimes de cette terrible journée.
- Détails
- Jules Legendre
Il y a 100 ans, le 21 janvier 1924, mourait Vladimir Illitch Oulianov, mondialement connu sous le nom de Lénine comme le principal dirigeant du parti bolchevik et de la révolution d’Octobre 1917, en Russie.
Aujourd’hui (comme hier), les historiens et les journalistes bourgeois dépeignent Lénine comme un dictateur sanguinaire et un précurseur de Staline. La plupart des dirigeants réformistes du mouvement ouvrier ne s’élèvent pas au-dessus de cette calomnie. Ce faisant, tous cherchent à dissuader les jeunes et les travailleurs de se tourner vers les idées de Lénine. Et pour cause : elles sont toujours d’une actualité brûlante.
La naissance du marxisme russe
Lénine est né en 1870 dans une famille de petits notables de province. La Russie, alors très arriérée, est dirigée d’une main de fer par l’autocratie tsariste. Malgré l’abolition officielle du servage en 1861, son économie largement agricole est toujours dominée par une infime minorité de grands propriétaires terriens. Cependant, à partir des années 1870, une industrie capitaliste commence à se développer dans une poignée de villes grâce à l’afflux de capitaux provenant d’Europe occidentale et d’Amérique.
Dans ce contexte, le mouvement révolutionnaire russe est d’abord dominé par les idées des Narodniki (les « populistes »), qui font de la propagande auprès des paysans, sans grand succès, et organisent des attentats contre des dignitaires du régime. En 1881, ils parviennent même à assassiner le Tsar Alexandre II. Mais rien de tout cela n’ébranle l’Etat tsariste – au contraire : le terrorisme individuel renforce la répression. Dès lors, l’impasse du « populisme » pousse un nombre croissant de révolutionnaires russes à s’orienter vers les idées du marxisme.
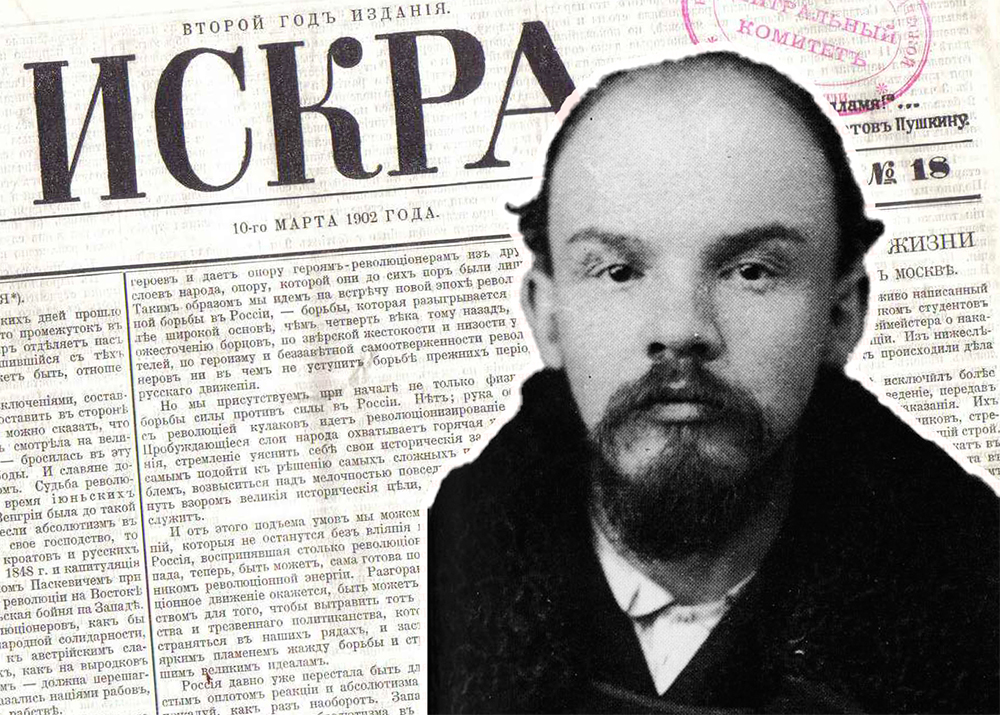 C’est ce que fait le jeune Vladimir Oulianov, qui fut d’abord populiste. Arrêté en 1895 et déporté en Sibérie, il est libéré en 1900 et part en exil. Il commence alors à jouer un rôle clé dans la direction du journal Iskra (« L’Etincelle ») et dans la lutte pour la création d’un parti marxiste unifié, le Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (POSDR).
C’est ce que fait le jeune Vladimir Oulianov, qui fut d’abord populiste. Arrêté en 1895 et déporté en Sibérie, il est libéré en 1900 et part en exil. Il commence alors à jouer un rôle clé dans la direction du journal Iskra (« L’Etincelle ») et dans la lutte pour la création d’un parti marxiste unifié, le Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (POSDR).
Le groupe de l’Iskra s’oppose alors au courant des « économistes », qui limitent les revendications des travailleurs aux seules questions économiques : les salaires, les conditions de travail, etc. Pour Lénine et les « Iskristes », le mouvement socialiste doit lier ces revendications immédiates à des mots d’ordre politiques dirigés contre l’ensemble du régime tsariste. Lénine insiste également pour donner au parti la forme d’une organisation disciplinée de « révolutionnaires professionnels » coordonnés autour d’un journal national et d’une direction centrale élue démocratiquement. C’est pour défendre ce programme contre les « économistes » que Lénine rédige en 1901 l’un de ses chefs-d’œuvre : Que faire ?
En 1903, le deuxième congrès du POSDR consacre la victoire du courant « Iskriste » sur les « économistes ». Mais à la surprise générale, ce congrès débouche aussi sur une scission des partisans de l’Iskra. Les divergences se cristallisent d’emblée sur la question des conditions d’appartenance au parti. Menés par Lénine, les bolcheviks (« majoritaires », en Russe) veulent restreindre la qualité de membres du parti à ceux qui « participent activement à l’une de ses organisations », tandis que les mencheviks (« minoritaires ») veulent l’étendre à tous ceux qui « adhèrent » à son programme et « coopèrent » avec lui.
Derrière cette divergence qui peut paraître secondaire, à première vue, se cache une opposition sur l’attitude à adopter vis-à-vis de la bourgeoisie russe : les mencheviks veulent élargir le périmètre du parti pour y inclure des intellectuels libéraux inactifs mais sympathisants, alors que les bolcheviks prônent une rupture nette avec ce milieu bourgeois. Sur le moment, cependant, la signification politique de la scission reste confuse aux yeux de la plupart des militants.
La révolution de 1905
Le dimanche 9 janvier 1905, à Saint-Pétersbourg, une manifestation pacifique de travailleurs est réprimée dans le sang par l’armée tsariste. Les centaines de morts du « Dimanche rouge » ouvrent une brèche irréparable dans l’autorité du régime. Des mobilisations de masse éclatent et prennent parfois une forme insurrectionnelle. Dans la capitale, les travailleurs russes créent les premiers soviets (« conseils ») de délégués élus et révocables, qui constituent l’embryon d’un Etat ouvrier.
Les divergences entre bolcheviks et mencheviks prennent alors une forme plus nette. Les deux tendances sont d’accord pour constater que, si le capitalisme a commencé à se développer en Russie, les tâches élémentaires d’une révolution bourgeoise n’y sont toujours pas réalisées : le régime reste autocratique ; des dizaines de millions de paysans sont privés de terres viables ; l’essentiel de l’industrie est entre les mains du capital occidental. Mais reste à savoir quelle classe doit mener la révolution – et c’est précisément cette question qui oppose les bolcheviks et les mencheviks.
Les mencheviks affirment que la bourgeoisie libérale doit diriger la révolution, prendre le pouvoir et réaliser une réforme agraire à la tête d’un Etat capitaliste moderne, démocratique. Dans cette perspective, la classe ouvrière doit se contenter d’appuyer, sur sa gauche, la soi-disant « bourgeoisie démocratique ».
A l’inverse, Lénine et les bolcheviks soulignent que la bourgeoisie russe est incapable de diriger « sa » révolution, car elle est étroitement liée aux grands propriétaires terriens, s’appuie sur l’Etat tsariste pour contenir le mouvement ouvrier et dépend des capitaux étrangers pour son industrie. Elle ne peut – et ne veut – lutter ni pour la réforme agraire, ni pour une véritable démocratie, ni contre l’impérialisme. Lénine affirme que seule une alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre peut prendre le pouvoir et mener à bien les tâches de la révolution bourgeoise. Il explique aussi qu’une révolution victorieuse, en Russie, déclencherait une vague révolutionnaire dans toute l’Europe.
La révolution de 1905 confirme pleinement l’analyse de Lénine. Effrayée par la mobilisation massive des travailleurs, la bourgeoisie « démocratique » trahit la révolution. En décembre 1905, à Moscou, une insurrection ouvrière est écrasée dans le sang, après quoi le régime déchaîne une répression brutale à l’échelle de tout l’Empire.
Deux polémiques
Dans ce contexte, nombre de militants cèdent au désespoir. Des bolcheviks se suicident ; d’autres rejettent le matérialisme marxiste et se tournent vers des doctrines idéalistes, voire mystiques. Lénine se lance alors dans une lutte pour défendre le matérialisme dialectique, c’est-à-dire le noyau théorique du parti. Dans son livre Matérialisme et empiriocriticisme (1909), il soumet à une critique implacable l’idéalisme et le subjectivisme que professent Bogdanov et d’autres « théoriciens » bolcheviks. Plus d’un siècle après sa publication, ce livre reste une arme puissante face aux différentes formes d’idéalisme et de subjectivisme qui sévissent dans la gauche française et internationale (« intersectionnalité », « post-colonialisme », etc.).
 C’est aussi dans ces années-là que Lénine polémique avec la grande marxiste polonaise Rosa Luxemburg sur l’attitude que doivent adopter les révolutionnaires vis-à-vis des revendications des nations opprimées. La Russie est alors une « prison des peuples » : le régime tsariste opprime de nombreuses nations – en Pologne, mais aussi dans les Pays baltes, dans le Caucase et en Asie centrale. Or Rosa Luxemburg considère que le droit à l’autodétermination de la Pologne, par exemple, est une revendication réactionnaire car, affirme-t-elle, cela contribuerait à séparer la classe ouvrière russe et la classe ouvrière polonaise, tout en renforçant l’autorité de la bourgeoisie polonaise. Lénine lui répond que la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples est, au contraire, un moyen pratique d’unir les différentes classes ouvrières dans une lutte commune – en montrant aux ouvriers polonais, par exemple, que les travailleurs russes sont prêts à les soutenir dans leur lutte contre l’oppression nationale. Lénine ajoute que cette position doit s’accompagner d’une critique sans faille des nationalistes bourgeois polonais, pour qui « l’indépendance » ne signifie que la liberté d’exploiter plus « librement » leur propre classe ouvrière. En 1917, c’est précisément cette politique qui a permis aux bolcheviks de gagner l’appui des travailleurs des nations opprimées.
C’est aussi dans ces années-là que Lénine polémique avec la grande marxiste polonaise Rosa Luxemburg sur l’attitude que doivent adopter les révolutionnaires vis-à-vis des revendications des nations opprimées. La Russie est alors une « prison des peuples » : le régime tsariste opprime de nombreuses nations – en Pologne, mais aussi dans les Pays baltes, dans le Caucase et en Asie centrale. Or Rosa Luxemburg considère que le droit à l’autodétermination de la Pologne, par exemple, est une revendication réactionnaire car, affirme-t-elle, cela contribuerait à séparer la classe ouvrière russe et la classe ouvrière polonaise, tout en renforçant l’autorité de la bourgeoisie polonaise. Lénine lui répond que la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples est, au contraire, un moyen pratique d’unir les différentes classes ouvrières dans une lutte commune – en montrant aux ouvriers polonais, par exemple, que les travailleurs russes sont prêts à les soutenir dans leur lutte contre l’oppression nationale. Lénine ajoute que cette position doit s’accompagner d’une critique sans faille des nationalistes bourgeois polonais, pour qui « l’indépendance » ne signifie que la liberté d’exploiter plus « librement » leur propre classe ouvrière. En 1917, c’est précisément cette politique qui a permis aux bolcheviks de gagner l’appui des travailleurs des nations opprimées.
La guerre et la révolution
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, en 1914, les dirigeants réformistes de la plupart des partis socialistes se rallient à leurs bourgeoisies respectives. Même Lénine n’avait pas anticipé une telle trahison des dirigeants de la IIe Internationale. Quand le journal des sociaux-démocrates allemands annonce qu’ils ont voté les crédits de guerre, Lénine refuse d’abord d’y croire. Puis, le premier choc passé, il se lance dans une défense acharnée de l’internationalisme révolutionnaire. Il fustige non seulement les « social-patriotes » qui ont ouvertement rallié leur propre bourgeoisie, mais aussi les dirigeants – tels Karl Kautsky – dont la propagande « pacifiste » vise à détourner les travailleurs de leurs tâches révolutionnaires. A la « lutte » purement verbale et passive pour une « paix » impérialiste, Lénine oppose la nécessité de « transformer la guerre impérialiste en une guerre civile contre la bourgeoisie ». Enfin, il souligne que l’effondrement de la IIe Internationale met à l’ordre du jour la création d’une IIIe Internationale, qui devra rompre résolument avec les dirigeants réformistes.
En février 1917, la révolution éclate en Russie et balaie en quelques jours l’édifice vermoulu du tsarisme. Des soviets émergent dans tout le pays, mais c’est un gouvernement provisoire composé de politiciens bourgeois qui prend formellement le pouvoir. Et pour cause : ce gouvernement est soutenu par les « socialistes-révolutionnaires » – héritiers des Narodniki – et les mencheviks, qui ensemble sont majoritaires dans les soviets. Quant aux dirigeants bolcheviks présents à Saint-Pétersbourg, dont Kamenev et Staline, ils apportent un soutien critique au gouvernement provisoire, qui refuse pourtant de mettre fin à la guerre, de partager la terre et de proclamer la République.
Depuis son exil en Suisse, Lénine fait entendre une toute autre voix. Le gouvernement provisoire, explique-t-il, prépare le terrain de la contre-révolution. Il faut donc orienter les travailleurs et les soldats vers la prise du pouvoir à travers les soviets, qui engageront alors la transformation socialiste de la société.
 En avril, Lénine parvient à rentrer en Russie à travers l’Allemagne, ce qui lui vaudra d’être accusé par ses ennemis d’être un « agent allemand ». A Saint-Pétersbourg, Lénine défend sa position dans ses célèbres Thèses d’avril. Il y développe ses perspectives et explique aussi la tâche qu’il assigne au parti : « expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement » son programme aux masses. S’appuyant sur sa base militante, Lénine parvient à changer l’orientation du parti bolchevik.
En avril, Lénine parvient à rentrer en Russie à travers l’Allemagne, ce qui lui vaudra d’être accusé par ses ennemis d’être un « agent allemand ». A Saint-Pétersbourg, Lénine défend sa position dans ses célèbres Thèses d’avril. Il y développe ses perspectives et explique aussi la tâche qu’il assigne au parti : « expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement » son programme aux masses. S’appuyant sur sa base militante, Lénine parvient à changer l’orientation du parti bolchevik.
Cet épisode est une illustration du rôle que peut jouer un individu dans certaines circonstances. Dans son Histoire de la révolution russe, Trotsky a bien décrit ce rapport entre Lénine et le parti bolchevik : « La dictature du prolétariat découlait de toute la situation. Mais encore fallait-il l’ériger. On ne pouvait l’instaurer sans un parti. Or, le parti ne pouvait accomplir sa mission qu’après l’avoir comprise. Pour cela justement, Lénine était indispensable. [...] De l’importance exceptionnelle que prit l’arrivée de Lénine, il découle seulement que les leaders ne se créent point par hasard, que leur sélection et leur éducation exigent des dizaines d’années, qu’on ne peut les supplanter arbitrairement, qu’en les excluant mécaniquement de la lutte on inflige au parti une plaie vive et que, dans certains cas, on peut le paralyser pour longtemps. »
Fin octobre 1917, alors que les Gardes rouges prennent le contrôle de la capitale, le deuxième congrès des Soviets, majoritairement bolchevik, vote le renversement du gouvernement provisoire et le transfert de « tout le pouvoir aux soviets ». Pour la première fois depuis la Commune de Paris, en 1871, la classe ouvrière s’empare du pouvoir d’Etat.
Pour les bolcheviks, la révolution d’Octobre n’est pas un événement russe, mais le premier maillon de la révolution socialiste mondiale. Dès l’été 1914, Lénine a commencé à préparer activement la fondation d’une nouvelle Internationale. En mars 1919, à Moscou, des délégués venus de 51 pays proclament la IIIe Internationale, l’Internationale communiste (IC). D’emblée, elle exerce une attraction immense sur le mouvement ouvrier international. De nombreux groupes et partis affluent vers elle : en Allemagne, un parti communiste, le KPD, est constitué en décembre 1918 ; en France, la majorité de la SFIO rejoint l’IC lors du Congrès de Tours (1920) ; l’année suivante, une minorité du Parti socialiste italien fait de même ; en Angleterre et ailleurs, de petits groupes se constituent en « partis communistes ».
En Europe, des révolutions éclatent contre les régimes bourgeois discrédités par la guerre mondiale. En Italie, en Allemagne, en Hongrie et ailleurs, les travailleurs se lancent dans l’action, mais sont trahis par les dirigeants réformistes qui, en Allemagne, vont jusqu’à organiser des milices contre-révolutionnaires.
Dans le même temps, les dirigeants des jeunes partis communistes multiplient les erreurs ultra-gauchistes. En Allemagne, par exemple, la direction du KPD boycotte les syndicats et les élections, puis se lance dans une série d’aventures sans espoir, dont le parti ressort très affaibli. Pour tenter de corriger ces erreurs, Lénine rédige en 1920 l’un de ses livres les plus célèbres, La maladie infantile du communisme (« le gauchisme »), dans lequel il s’efforce de transmettre l’expérience du bolchevisme à toute l’Internationale.
La lutte contre le stalinisme
Dans la foulée d’Octobre, la jeune Russie soviétique est assaillie de toutes parts : les puissances impérialistes y envoient leurs armées et appuient les forces contre-révolutionnaires des « Blancs ». De leur côté, les socialistes-révolutionnaires se rallient à la contre-révolution et organisent des attentats. Lénine lui-même sort grièvement blessé d’une tentative d’assassinat en 1918. Durant toute la guerre civile et la lutte contre l’intervention impérialiste, les efforts de Lénine et des bolcheviks sont concentrés sur la survie du régime soviétique. C’est l’époque du « communisme de guerre » et des combats titanesques de l’Armée rouge créée par Léon Trotsky.
Grâce aux sacrifices héroïques des travailleurs et des soldats russes, le régime sort victorieux de ces épreuves. Mais il est isolé et exsangue. L’économie est à genoux, la famine ravage des régions entières et, surtout, aucune révolution n’a triomphé en Europe occidentale. C’est sur cette base matérielle et dans ce contexte international que se développe la bureaucratie stalinienne. La lutte contre la dégénérescence bureaucratique de la révolution sera le dernier combat de Lénine.
Dès le début des années 1920, il tente de s’opposer à la mainmise croissante de la bureaucratie sur l’appareil d’Etat soviétique. Ce faisant, Lénine cherche à s’appuyer sur la participation et le contrôle de la classe ouvrière, mais celle-ci est affamée et politiquement épuisée. Lénine s’oppose aussi aux projets centralisateurs de Staline, qui cherche à imposer aux autres Républiques soviétiques leur rattachement à la Fédération de Russie. Lénine fustige et combat cette manifestation du « chauvinisme grand-russe qui caractérise la bureaucratie russe ».
 Au printemps 1922, Lénine subit une première attaque cérébrale. Lorsqu’il se remet au travail, quelques mois plus tard, il est frappé par le développement rapide de la bureaucratie. Il réalise aussi le rôle central qu’y joue Staline. Ce dernier est en train de devenir le principal chef et porte-parole de la bureaucratie. Dans son « Testament », rédigé en décembre 1922, Lénine propose de le relever de toutes ses responsabilités, pour le remplacer par quelqu’un de « plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades ». Lénine se prépare à lancer une véritable offensive politique contre la clique stalinienne, mais une nouvelle attaque cérébrale l’en empêche. Paralysé par la maladie, il meurt en janvier 1924.
Au printemps 1922, Lénine subit une première attaque cérébrale. Lorsqu’il se remet au travail, quelques mois plus tard, il est frappé par le développement rapide de la bureaucratie. Il réalise aussi le rôle central qu’y joue Staline. Ce dernier est en train de devenir le principal chef et porte-parole de la bureaucratie. Dans son « Testament », rédigé en décembre 1922, Lénine propose de le relever de toutes ses responsabilités, pour le remplacer par quelqu’un de « plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades ». Lénine se prépare à lancer une véritable offensive politique contre la clique stalinienne, mais une nouvelle attaque cérébrale l’en empêche. Paralysé par la maladie, il meurt en janvier 1924.
La direction stalinienne place son corps dans un mausolée et organise un véritable culte du dirigeant bolchevik. Mais c’est pour mieux trahir ses idées. Au lieu d’œuvrer à la révolution mondiale, les dirigeants staliniens se lancent officiellement dans la construction du « socialisme dans un seul pays ». Au lieu de permettre « au premier manœuvre ou à la première cuisinière venus [...] de participer à la gestion de l’Etat » (Lénine), le stalinisme met sur pied un appareil totalitaire dirigé par une bureaucratie pléthorique et privilégiée. A la politique d’égalité entre les nationalités défendue par Lénine succèdent les déportations de peuples entiers.
C’est à l’Opposition de gauche fondée par Léon Trotsky, en 1923, qu’est revenue la tâche de défendre les idées et les méthodes du bolchevisme et du léninisme – contre les crimes du stalinisme et contre les calomnies de la bourgeoisie. C’est cette tâche que la Tendance Marxiste Internationale poursuit aujourd’hui. L’objectif central de cet article, qui ne pouvait faire mieux que survoler son sujet, est d’encourager la jeunesse qui veut lutter contre le capitalisme à prendre le temps d’étudier l’œuvre magistrale de Lénine. C’est le meilleur moyen de répondre à la nouvelle fournée de mensonges et de bêtises que nos adversaires ne manqueront pas de lui décerner à l’occasion du centenaire de sa disparition.
- Détails
- Greg Oxley
La révolution russe fut l’un des plus grands événements de l’histoire de l’humanité. Les travailleurs qui, en février 1917, se sont révoltés contre le carnage de la première guerre mondiale, la famine, le chômage et l’exploitation, sont parvenus à renverser la monarchie en l’espace de quelques jours. Huit mois plus tard, pour la première fois de l’histoire – mis à part l’héroïque mais éphémère épisode de la Commune de Paris – la classe ouvrière a pris le pouvoir entre ses mains.
Organisés en « soviets », c’est-à-dire en assemblées de délégués démocratiquement élus et révocables à tout instant, les travailleurs, les soldats et les paysans pauvres ont tenté, dans des circonstances matérielles extrêmement difficiles, d’ériger une société entièrement nouvelle. A la place du despotisme tsariste, ils ont jeté les bases d’une société socialiste. Ils ont lancé un appel aux exploités du monde entier pour qu’ils suivent leur exemple. L’histoire de leur lutte mérite d’être connue et étudiée par tous les travailleurs du monde, car c’est une preuve concrète de la possibilité d’en finir avec le capitalisme ainsi que du potentiel révolutionnaire de notre classe.
La révolution de février
 La révolution a éclaté au cours de la première guerre mondiale, qui en fut la cause immédiate. Le massacre insensé dans les tranchées, conjugué à une grave crise économique, infligeait des souffrances insupportables aux soldats, aux travailleurs et aux paysans de l’Empire tsariste. Dans les villes comme dans les campagnes, la misère s’aggravait, cependant que l’opulence et la corruption régnaient à la Cour Impériale, dans l’aristocratie et la classe capitaliste. A Petrograd, à la fin de 1916, il n’y avait plus de viande et presque plus de farine. Une cinquantaine d’usines avaient fermé leurs portes faute de fuel ou d’électricité.
La révolution a éclaté au cours de la première guerre mondiale, qui en fut la cause immédiate. Le massacre insensé dans les tranchées, conjugué à une grave crise économique, infligeait des souffrances insupportables aux soldats, aux travailleurs et aux paysans de l’Empire tsariste. Dans les villes comme dans les campagnes, la misère s’aggravait, cependant que l’opulence et la corruption régnaient à la Cour Impériale, dans l’aristocratie et la classe capitaliste. A Petrograd, à la fin de 1916, il n’y avait plus de viande et presque plus de farine. Une cinquantaine d’usines avaient fermé leurs portes faute de fuel ou d’électricité.
Depuis le début de l’année 1917, Petrograd était au bord de la révolte. Le 9 janvier [1], à l’occasion du 12ème anniversaire de la révolution de 1905, le nombre de grévistes, à Petrograd, s’élevait à 145 000, soit près d’un tiers de la classe ouvrière de la capitale. Au milieu du mois de février, une manifestation impressionnante de grévistes défilait le long de la perspective Nevsky, scandant « Non à la guerre ! » et « A bas le gouvernement et le Tsar ! ».
Le début de la révolution peut être daté du 23 février 1917, qui était la journée internationale des femmes. Les rassemblements de femmes se sont transformés en manifestations. Elles protestaient contre le manque de pain et contre la guerre. Les femmes passaient d’usine en usine, exhortant les travailleurs à se mettre en grève. 130 000 grévistes répondirent à leur appel. Le 24, la police a ouvert le feu à différents endroits, mais les foules dispersées se regroupaient aussitôt. Le 25, à Petrograd, la grève était générale. Le 26, sur ordre direct du Tsar (« Nicolas le Sanglant »), la police a de nouveau tiré sur les manifestants, mais les soldats du régiment Pavlovsk, ayant reçu l’ordre de faire feu sur les ouvriers, ont tourné leurs armes contre la police. Le rapport de forces basculait en faveur des grévistes. Les soldats rallièrent en masse la cause révolutionnaire. La ville était en pleine insurrection.
Le général Ivanov a adressé une série de questions écrites au général Khabalov, qui était chargé de mener la répression. Les réponses de ce dernier résument assez bien la situation dans la capitale après trois jours de lutte :
Ivanov : Combien de soldats sont à vos ordres, et combien se rebellent ?
Khabalov : Je dispose de [...] quatre compagnies de la Garde, de cinq escadrons de cavalerie et de cosaques, et de deux postes d’artillerie. Le reste de la troupe est passé du côté des révolutionnaires, ou, de connivence avec eux, se déclare neutre. Des soldats se déplacent dans les quartiers [...] et désarment les officiers.
Ivanov : Dans quels quartiers l’ordre est-il maintenu ?
Khabalov : La ville toute entière est entre les mains des révolutionnaires. Le téléphone ne marche pas. Il n’y pas de communication possible entre les différents quartiers.
Ivanov : Quelle autorité gouverne la ville ?
Khabalov : Je ne saurais répondre à cette question.
Ivanov : Les ministères fonctionnent-ils ?
Khabalov : Les ministres ont été arrêtés par les révolutionnaires.
Ivanov : Quelles unités de police sont à votre disposition actuellement ?
Khabalov : Aucune.
Aucun parti n’a dirigé la révolution de février. Le mouvement de masse a trouvé ses dirigeants parmi les éléments les plus courageux et les plus fiables du mouvement ouvrier. Bon nombre de ces militants se considéraient certainement comme « bolcheviks », la tendance révolutionnaire du mouvement social-démocrate russe. Mais en tant que structure organisée, cette tendance n’a joué aucun rôle dirigeant dans les événements. A vrai dire, l’essor du mouvement révolutionnaire a pris de vitesse les dirigeants bolcheviks de la capitale.
Les « soviets », qui avaient surgi lors de la révolution de 1905, firent à nouveau leur apparition. De par sa nature même, une révolution soulève une masse immense d’hommes et de femmes qui entrent soudainement et pour la toute première fois dans l’arène où se jouent leurs destinées, sans y être préparés. Ce n’est qu’au prix de chocs, de défaites et de déceptions que cette masse insurgée parvient à élever sa conscience politique à la hauteur de ses tâches historiques – dont elle n’est, au commencement, qu’un agent inconscient ou semi-conscient. La guerre avait conféré à l’armée, et donc aux masses paysannes qui formaient le gros de ses effectifs, le rôle déterminant dans la vie des soviets. Les soldats-paysans ont choisi comme députés au soviet les officiers et les intellectuels qui, leur semblaient-ils, « s’y connaissaient » en politique. Le poids de l’armée réduisait d’autant celui des représentants éprouvés du mouvement ouvrier au profit d’éléments petit-bourgeois – avocats, médecins, journalistes, etc. Ceux-ci n’avaient jusqu’alors ni acquis ni souhaité acquérir la moindre expérience de la lutte, mais se sont néanmoins trouvés brusquement projetés aux avant-postes d’un puissant mouvement révolutionnaire. L’idéologie amorphe de ces « dirigeants » correspondait aux formules vaguement « démocratiques » et « humanitaires » du Parti Socialiste-Révolutionnaire et de l’aile modérée du Parti Social-Démocrate (les « mencheviks »). Par conséquent, ce sont ces derniers courants qui, dans la foulée de la révolution de février, composaient la grande majorité du Comité Exécutif du « Soviet des députés des travailleurs, des soldats et des paysans ».
Quant aux bolcheviks, bien qu’ils occupaient, en 1914, la première place au sein du mouvement ouvrier de la capitale, leur influence et leur implantation organisationnelle avaient été énormément réduites depuis le début de la guerre, sous l’impact de la répression et de la vague patriotique qui accompagnèrent les premiers mois de guerre. En outre, la marginalisation du parti de Lénine avait été aggravée par la volonté des travailleurs qui se reconnaissaient en lui de se rapprocher le plus possible des députés issus de l’armée et de la paysannerie. Ils craignaient une rupture entre le mouvement ouvrier et la paysannerie, laquelle rupture, pensaient-ils, avait été l’une des causes de la défaite de 1905.
Les travailleurs et les soldats en insurrection étaient les maîtres de la capitale, et la révolution gagnait rapidement les autres villes de l’Empire. Pris de panique, les Démocrates Constitutionnels (les « Cadets ») et autres représentants des capitalistes « libéraux » cherchaient désespérément à maintenir la monarchie, sans laquelle « l’ordre établi » - où ils occupaient une très bonne place - risquait de s’effondrer comme un château de cartes. Mais ils ne trouvaient pas un seul régiment pour soutenir le Tsar. Le 2 mars, un « gouvernement provisoire » a été formé en toute hâte, sous la présidence du Prince Lvov. L’objectif était de sauver la monarchie en remplaçant Nicolas II par son fils, sous l’autorité de son frère Mikhaïl comme Prince Régent. Mais cela s’avéra impossible. Mikhaïl, constatant la fureur révolutionnaire qui se pressait aux portes du pouvoir, a préféré se désister.
Composé de monarchistes notoires, de grands propriétaires terriens et d’industriels (Guchkov, Tereshchenko, Konovalov etc.) le gouvernement provisoire n’avait aucun soutien dans la capitale. Les travailleurs et les soldats ne faisaient confiance qu’aux dirigeants du soviet de Petrograd. Mais ici réside, précisément, le paradoxe de cette première phase de la révolution russe. Les travailleurs ont fait couler leur sang pour renverser le Tsar, et ils ont placé leur confiance dans les « socialistes modérés » qui dirigeaient le soviet. Mais ceux-ci, conscients de l’immense pouvoir concentré entre leurs mains, n’avaient qu’une seule idée en tête : s’en libérer au plus vite à la faveur du « gouvernement provisoire » capitaliste qui, à son tour, espérait un retournement de situation lui permettant de restaurer la monarchie !
Ainsi, la révolution de février, au lieu de transférer le pouvoir aux classes qui l’avaient accomplie – les travailleurs et les paysans en uniforme – a abouti à une situation de « double pouvoir ». Le pouvoir soviétique, à qui les forces révolutionnaires accordaient leur confiance et le commandement de leurs armes, coexistait avec ce qui restait du pouvoir de l’ancienne classe dirigeante. Le gouvernement provisoire ne disposait d’aucune autorité propre. Il était, pour ainsi dire, complètement suspendu en l’air. Son existence dépendait entièrement du soutien que lui accordaient les réformistes du Comité Exécutif du soviet, lesquels renonçaient à remettre en question les intérêts fondamentaux des capitalistes concernant la réforme agraire, les droits des minorités nationales, la monarchie et, surtout, la poursuite de la guerre.
Lénine et le Parti Bolchevik
Le 3 avril, Lénine arrive à Petrograd. Dès son arrivée, gare de Finlande, il fait un discours dans lequel il affirme que les objectifs de la révolution en cours sont socialistes. Ce discours fit l’effet d’une bombe parmi les dirigeants du Parti Bolchevik, dont la perspective n’allait pas, pour la plupart, au-delà d’une révolution « bourgeoise-démocratique ». La préparation de la conférence du parti fut consacrée à la question suivante : le parti doit-il s’orienter vers la conquête du pouvoir par la classe ouvrière ou se limiter à « compléter » une révolution bourgeoise ? Ceux – dans un premier temps largement majoritaires – qui étaient en faveur de la deuxième option se trouvaient défendre une position essentiellement identique à celle des socialistes-révolutionnaires et des mencheviks. Au contraire, dans ses célèbres Thèses d’avril , Lénine défendait l’idée que les tâches proprement bourgeoises-démocratiques – réforme agraire, renversement de l’aristocratie, abolition des vestiges féodaux et droits des nationalités – ne pouvaient être accomplis que par le renversement du gouvernement provisoire et la prise du pouvoir par la classe ouvrière, en alliance avec la paysannerie. D’où son mot d’ordre : « Tout le pouvoir aux soviets ! »
Lors de la conférence du 24-29 avril, au terme d’une lutte interne particulièrement âpre et en s’appuyant sur la base ouvrière du parti contre la « veille garde », Lénine a réussi à réorienter le programme et l’action du parti dans le sens des Thèses d’avril, qui reprenaient en substance le programme et les perspectives élaborées par Trotsky, à la veille de la révolution de 1905, dans sa théorie de la « révolution permanente ».
La nouvelle orientation du Parti Bolchevik allait avoir des conséquences décisives sur le cours ultérieur de la révolution. Pour l’heure, cependant, les bolcheviks étaient loin d’être majoritaires parmi les délégués du soviet. Lénine a donc recommandé de se tourner résolument vers les travailleurs et vers les soviets pour « expliquer patiemment » le programme et les objectifs socialistes du parti. Il fallait revendiquer la publication des traités secrets conclus entre les puissances de l’Entente, exiger que la guerre cesse immédiatement, que l’Exécutif soviétique cesse de soutenir le gouvernement provisoire et qu’il prenne le pouvoir en main.
Le gouvernement de coalition et la guerre
Les prix augmentaient, le pain manquait et la guerre se prolongeait. Devant l’inaction du gouvernement et des dirigeants du soviet, les travailleurs perdaient patience. L’influence des bolcheviks augmentait. Au cours du mois d’avril, manifestations et affrontements se succédèrent. L’opposition à la politique des « conciliateurs » mencheviks et socialistes-révolutionnaires grandissait dans tous les centres urbains. Les bolcheviks pouvaient désormais compter sur l’appui d’environ un tiers des travailleurs de Petrograd.
Au début du mois de mai, les dirigeants « conciliateurs » du soviet ont formé un gouvernement de coalition avec les monarchistes et les capitalistes du gouvernement provisoire. Les délégués du soviet accueillirent d’abord positivement cette démarche. Ils croyaient qu’ils allaient désormais pouvoir changer la politique du gouvernement. Mais au contraire, en entrant dans les ministères, les dirigeants du soviet assumaient la responsabilité directe de la politique pro-capitaliste du gouvernement, y compris la poursuite de la guerre.
En 1918, Trotsky écrivait : « La révolution était née directement de la guerre, et la guerre devint la pierre de touche de tous les partis et de toutes les forces révolutionnaires. [...] Les soldats mourant dans les tranchées ne pouvaient évidemment pas conclure que la guerre, à laquelle ils participaient depuis près de trois ans, avait subitement pris une autre tournure par le seul fait qu’à Petrograd quelques personnalités nouvelles, s’appelant socialistes-révolutionnaires ou mencheviks, étaient entrés au gouvernement. »
Les puissances de l’Entente exigeaient avec insistance une nouvelle offensive russe, et la coalition au pouvoir s’était secrètement engagée à leur donner satisfaction. Mais des engagements, il fallait rapidement passer aux actes. Une vague de propagande visant à faire accepter l’idée d’une nouvelle offensive fut lancée dans la presse et dans les soviets, conjuguée à une campagne de haine et de calomnie dirigée contre les bolcheviks. Au sein de l’armée et de la marine, le gouvernement tentait par tous les moyens de restaurer la « discipline » et l’autorité des généraux tsaristes. Mais la colère des soldats, des marins et des travailleurs était à son comble. Ils ne voulaient plus de cette guerre. Pour donner un caractère aussi organisé et puissant que possible à cette colère, les bolcheviks envisageaient l’organisation, pour le 10 juin, d’une manifestation armée à Petrograd. L’objectif était de faire pression sur les ministres issus du soviet pour qu’ils rompent avec les « ministres capitalistes » et prennent directement le pouvoir.
Cependant, face à la puissance de la campagne contre cette manifestation, menée conjointement par les socialistes-révolutionnaires, les mencheviks, les capitalistes « libéraux » et les contre-révolutionnaires, et compte tenu de la position encore minoritaire des bolcheviks dans le Congrès des soviets de Russie, qui s’était réuni à partir du 3 juin, les bolcheviks ont dû renoncer. Le ministre « de gauche » Tseretelli voulut forcer son avantage et se prononça aussitôt pour le désarmement des travailleurs et des éléments de la garnison adhérant aux idées des bolcheviks. Mais ceci s’avéra impossible. Les soviets avaient accepté de s’opposer à la manifestation, mais ne suivaient pas le gouvernement au point de désarmer les opposants à la guerre. Le Congrès des Soviets a convoqué une manifestation – sans armes – pour le 18 juin, afin de dédommager les travailleurs de la capitale de l’interdiction de la manifestation du 10. Or, cette manifestation – qui fut particulièrement puissante, puisque sous l’autorité officielle des soviets – allait marquer un grand pas en avant pour le Parti Bolchevik. Partout, les revendications inscrites sur les banderoles et les tracts reprenaient les mots d’ordre des bolcheviks : « A bas les traités secrets ! », « Arrêtez la guerre ! », « A bas les dix ministres capitalistes ! », « Tout le pouvoir aux soviets ! ». Comme le remarquait Trotsky, revenu dans la capitale au début du mois de mai, « cette manifestation prouva non seulement à nos ennemis, mais aussi à nous-mêmes, que nous étions beaucoup plus fort que nous le supposions. »
C’est dans ce contexte que le ministre « socialiste » Kerensky a ordonné, le jour même de la manifestation, le lancement de la nouvelle offensive militaire sur le front. Ce n’était pas une coïncidence. Le gouvernement voulait effacer l’impact psychologique et politique de la manifestation, et noyer l’influence grandissante des bolcheviks sous une vague de ferveur chauvine. Il plaçait son espoir dans la réussite de l’offensive, dont il espérait qu’elle permettrait de rétablir la discipline au sein de l’armée et de restaurer l’autorité du gouvernement à Petrograd. Mais l’offensive tourna court, et une grave crise gouvernementale a précipité le départ des ministres « Cadets » du gouvernement. C’était l’occasion parfaite de rompre avec les représentants du capitalisme au gouvernement. Mais les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks issus des soviets avaient peur de gouverner seuls, ce qui leur aurait laissé comme seuls points d’appui la classe ouvrière et les soldats révolutionnaires. Aussi se sont-ils empressés d’intégrer d’autres ministres capitalistes au gouvernement, et ont alors annoncé la formation d’un deuxième gouvernement de coalition.
Cette annonce a déchaîné l’indignation des ouvriers et des soldats de la capitale, dont une fraction importante s’apprêta à organiser une manifestation armée contre le gouvernement. Lénine et Trotsky n’étaient pas favorables à cette action. Ils comprenaient que Petrograd était en avance sur le reste du pays. Même à Petrograd, l’ensemble de la garnison n’était pas encore au même niveau d’exaspération que les travailleurs, les marins et les soldats – notamment ceux des régiments de mitrailleurs – qui voulaient marcher les armes à la main contre le gouvernement. Les éléments les plus révolutionnaires allaient trop loin, trop vite. Les bolcheviks s’efforçaient d’empêcher une action prématurée qui risquait de finir dans un bain de sang. Mais ils ne purent pas l’arrêter. Les manifestants se regroupaient massivement à partir du 3 juillet. Le 4, ils étaient près de 500 000, sans dirigeants, sans organisations. Dans la nuit, le Comité central du parti bolchevik décida de se placer à la tête de la manifestation, dans le but de l’empêcher de se transformer en une insurrection prématurée.
Cependant, Kerensky ramenait vers la capitale des troupes fiables. L’heure était à la répression. Des cosaques et des policiers ont été lancés contre les manifestants, tuant plusieurs centaines de personnes. Une vague d’arrestations et d’assassinats a déferlé sur la ville. Lénine a dû regagner la clandestinité. Trotsky a été incarcéré. La presse et les locaux des bolcheviks ont été saccagés.
Les « journées de juillet » démontraient qu’à Petrograd, les réformistes avaient perdu le soutien des travailleurs et des soldats. Mais elles montraient aussi qu’ils disposaient encore de réserves de soutien dans le reste du pays. Dans la capitale, les deux tiers des délégués ouvriers envoyés au soviet étaient désormais des bolcheviks. La majorité des marins et des soldats soutenaient également la politique de Lénine. Mais certains régiments vacillaient encore, se déclarant « neutres ». Toujours est-il que pas une seule unité de la garnison de Petrograd n’accepta de se battre pour le compte du gouvernement et des dirigeants réformistes du soviet.
La contre-révolution mise en échec
La révolution de février, bloquée dans son élan, puis trahie par des dirigeants « conciliateurs », a donc été suivie par une offensive contre-révolutionnaire. Derrière l’écran de la « coalition », les généraux tsaristes se préparaient à prendre leur revanche en noyant la révolution dans le sang. Cependant, la révolution n’avait pas encore dit son dernier mot, et les effets de la défaite de juillet n’allaient pas durer longtemps. Les nouvelles du front étaient mauvaises. Après quelques modestes succès, l’offensive s’est enlisée. Le carnage futile se poursuivait. Le général tsariste Kornilov a ordonné l’exécution de déserteurs et a rétabli la peine de mort pour les actes d’insubordination. Il exigeait également l’interdiction des grèves dans l’industrie et sur les chemins de fer. Kornilov considérait la répression menée contre les bolcheviks par Kerensky comme une « division dans le camp révolutionnaire », dont il comptait profiter pour prendre le pouvoir et imposer une dictature militaire. Cependant, Kerensky est entré « amicalement » en contact avec Kornilov dans le but de mener une action commune. Mais Kornilov n’entendait nullement partager le pouvoir, ce qui a poussé Kerensky à dénoncer le « complot contre-révolutionnaire » fomenté par Kornilov. Le 25 août, les régiments contre-révolutionnaires ont commencé leur marche sur la capitale.
L’avance de Kornilov a donné une nouvelle et puissante impulsion à la révolution, transformant radicalement la situation dans la capitale. Chacun comprenait que si Kornilov était victorieux, les travailleurs de Petrograd subiraient le même sort que les Communards de 1871 aux mains des Versaillais. Devant la gravité de la situation, le Comité Exécutif du soviet n’avait d’autre choix que de faire appel à la classe ouvrière de Petrograd. Il a dû aussi inviter le Parti Bolchevik - contre lequel il menait jusqu’alors une campagne de calomnie et de répression - à participer au « comité de lutte contre la contre-révolution » qui devait diriger la lutte armée contre Kornilov. Trotsky est sorti de prison pour s’occuper de la défense de Petrograd. Pour lui, comme pour Lénine, malgré la politique contre-révolutionnaire et répressive du gouvernement provisoire et du Comité Exécutif du soviet, il était absolument indispensable de faire un front unique avec eux face à la contre-révolution tsariste. Ceci ne signifiait nullement que les bolcheviks soutenaient le gouvernement provisoire. Mais il fallait écarter la menace imminente et mortelle que représentait Kornilov avant de s’occuper du sort de Kerensky et des autres « conciliateurs ».
Les régiments et milices bolcheviks étaient les plus énergiques, courageux et disciplinés dans le combat contre Kornilov. Leur participation s’est avérée décisive. Les cheminots faisaient dérailler les trains acheminant les troupes et les équipements des forces aux ordres de Kornilov. Bon nombre de détachements contre-révolutionnaires, au contact des agitateurs bolcheviks, ont renoncé au combat. L’assaut contre-révolutionnaire échoua lamentablement.
Après la défaite de Kornilov, la composition des soviets, à Petrograd et dans l’ensemble du pays, évolua rapidement. Les délégués pro-bolcheviks augmentaient en nombre au détriment des conciliateurs. De partout, la pression montait en faveur d’une rupture avec le gouvernement provisoire. Début septembre, il n’y avait plus qu’une bien faible majorité, au Comité Exécutif des soviets, en faveur du gouvernement, avec 97 voix pour Kerensky et 86 en faveur de la prise du pouvoir par le soviet. Une semaine plus tard, un vote des délégués au soviet de Petrograd donnait 229 voix en faveur d’un « gouvernement des travailleurs et des paysans », avec 115 voix contre et 51 abstentions. Le 9 septembre, sur 1000 délégués, le vote pro-coalition ne recevait que 414 voix, avec 519 contre et 67 abstentions. A Petrograd, dans le soviet et les comités d’usine, les bolcheviks étaient clairement majoritaires.
L’insurrection du 24-25 octobre 1917, qui a déposé le gouvernement provisoire et établi le pouvoir des soviets, a coïncidé avec l’ouverture du deuxième Congrès des soviets de Russie. Sous la direction de Trotsky, elle a été menée avec rapidité et efficacité. Les bolcheviks avaient gagné, au cours de plusieurs mois de lutte, une majorité décisive au sein des soviets, qui étaient les organisations représentatives incontestées de la classe ouvrière. La prise de pouvoir par les soviets fut pacifique. En cette heure décisive, personne ne voulait se battre pour Kerensky, qui quitta Petrograd dans une voiture mise à sa disposition par l’ambassade américaine.
Le lendemain, dans le journal Rabotchi i Soldat, le Congrès a publié une Déclaration aux travailleurs, soldats et paysans qui résume bien la signification de la révolution d’octobre : « Le gouvernement provisoire est renversé. La majorité de ses membres est déjà arrêtée. Le pouvoir des Soviets proposera une paix immédiate et démocratique à tous les peuples et l’armistice immédiat sur tous les fronts. Il assurera la remise sans indemnité des terres des propriétaires fonciers, des apanages et des monastères à la disposition des comités paysans. Il défendra les droits des soldats en procédant à la démocratisation totale de l’armée. Il établira le contrôle ouvrier de la production. Il assurera la convocation de l’Assemblée constituante. Il assurera à toutes les nations qui peuplent la Russie le droit véritable à disposer d’elles-mêmes ».
[1] Nous utilisons les dates du calendrier russe de l’époque, en décalage de 13 jours par rapport au calendrier européen. Ainsi, la « révolution de février » en Russie a eu lieu, selon le calendrier occidental, en mars, et la révolution d’octobre, en novembre.
- Détails
- Charline B.
Il y a 50 ans, le 11 septembre 1973, un coup d’Etat dirigé par le général Augusto Pinochet renversait le gouvernement de Salvador Allende, consacrant l’échec de la révolution chilienne et plongeant le pays dans une dictature brutale qui dura près de deux décennies et dont la classe ouvrière chilienne ne s’est pas complètement remise, aujourd’hui encore.
Comme pour toutes les révolutions ouvrières, nous devons en tirer les grandes leçons concernant toutes les questions fondamentales de notre mouvement. A l’époque, les communistes du monde entier débordaient d’optimisme. Leurs dirigeants parlaient de « la voie chilienne vers le socialisme », comme d’un processus exceptionnel, absolument original, que l’expérience et les leçons du passé ne pouvaient pas éclairer. Or, dès 1971, les erreurs de la direction du mouvement préparaient le terrain d’un coup d’Etat contre-révolutionnaire. Le 21 septembre 1971, notre camarade Alan Woods écrivait un article intitulé : Chili : menace de catastrophe, dans lequel il anticipait les processus fondamentaux qui préparaient une défaite de la révolution.
Le mouvement ouvrier chilien
Dès le début du XXe siècle, le capitalisme dominait le Chili. Ses matières premières, l’étendue de ses terres cultivables et le développement de son industrie maritime en faisaient un pays riche. La bourgeoisie et les grands propriétaires terriens, unis par une multitude de liens économiques et familiaux, constituaient un seul bloc réactionnaire – lui-même soumis aux impérialistes. Aussi la bourgeoisie chilienne était-elle incapable d’accomplir les deux tâches fondamentales de la révolution « bourgeoise démocratique » : 1) la réforme agraire, le pays comptant des centaines de milliers de paysans sans terre et une poignée de grands propriétaires terriens ; 2) l’émancipation du pays de la domination impérialiste – britannique d’abord, puis nord-américaine. L’industrie du cuivre, colonne vertébrale de l’économie chilienne, était largement contrôlée par les impérialistes.
En conséquence, la classe capitaliste chilienne ne jouait – et ne pouvait jouer –aucun rôle progressiste. C’est à une autre classe, la classe ouvrière, que revenait la responsabilité de faire avancer la société. De fait, bien avant la révolution de 1970-73, les travailleurs chiliens ont joué un rôle de premier plan dans la vie économique et politique du pays, indépendamment de la bourgeoisie et contre la bourgeoisie, arrachant souvent des concessions par leurs luttes.
L’histoire du mouvement ouvrier chilien est riche et passionnante. Arrêtons-nous simplement, ici, sur la naissance des deux grands partis de la classe ouvrière chilienne. Créé en 1912, le Parti Ouvrier Socialiste chilien adhère en 1922 à la IIIe Internationale fondée en 1919 par Lénine et Trotsky. Il devient alors le Parti Communiste Chilien (PCCh). Mais dans la deuxième moitié des années 20, le PCCh est rapidement affecté par la dégénérescence stalinienne de l’Internationale Communiste. Il se bureaucratise et défend la ligne absurde de la « troisième période », dont la théorie du « social fascisme » caractérisait toutes les tendances du mouvement ouvrier – sauf les communistes – comme « fascistes »…
En 1933, en réaction à la dégénérescence du PCCh et sous l’impact d’une radicalisation des masses frappées par la crise de 1929, le Parti Socialiste (PS) est créé sur des bases programmatiques et théoriques très radicales. Mais dès 1938, dans le cadre de la politique stalinienne des « Fronts Populaires », le PS fait alliance avec le Parti Radical (un parti bourgeois). Au fil des concessions programmatiques et sous la pression de ses « alliés », le programme du PS est graduellement vidé de tout ce qui portait atteinte au capitalisme chilien.
La Démocratie Chrétienne
Les investissements étrangers au Chili eurent au moins une conséquence positive : en développant les forces productives, ils renforçaient la taille et le poids social de la classe ouvrière. Au début des années 60, celle-ci est devenue, de loin, la force dominante du pays : 70 % de la population active est salariée. Dans le même temps, la lutte des classes s’intensifiait.
En 1964, la droite traditionnelle chilienne est complètement discréditée, car elle s’est avérée incapable de moderniser le pays et de l’arracher à la domination impérialiste. Lors des élections de 1964, les capitalistes et les impérialistes se tournent alors vers la Démocratie Chrétienne, un parti bourgeois qui, cependant, use d’une démagogie « sociale ». Ce parti est l’ultime recours de la classe dirigeante face à la gauche. Son chef, Eduardo Frei, est soutenu par les Etats-Unis et toute la droite contre le candidat commun du PCCh et du PS, Salvador Allende.
Frei remporte les élections. Elu sur un discours très à gauche, il engage un début de réforme agraire extrêmement limitée et prend quelques mesures superficielles en faveur d’une « chilénisation » du cuivre : l’Etat prend davantage de parts dans cette industrie, mais sans pour autant nuire sérieusement aux intérêts nord-américains. Quant à la classe ouvrière, ses revendications restent insatisfaites. Les soulèvements ouvriers sont brutalement réprimés. La lutte des classes, cependant, continue de s’intensifier. Le gouvernement pro-capitaliste d’Eduardo Frei est rapidement discrédité. Cette situation débouche sur la victoire électorale de l’« Unité Populaire », en 1970, avec à sa tête Salvador Allende.
L’Unité Populaire
L’Unité Populaire (UP), coalition du PS, du PCCh et de quelques petits partis, dont le Parti Radical, remporte les élections du 4 septembre 1970, mais avec une faible avance qui ne permet pas à Allende d’avoir une majorité au Congrès. La droite, dont la Démocratie Chrétienne, est divisée, mais totalise plus de 58 % des voix.
La droite exige alors d’Allende qu’il souscrive à certaines conditions pour pouvoir former un gouvernement. Ce « pacte de garanties constitutionnelles » interdit notamment la formation de milices ouvrières, la nomination de membres des forces armées qui n’ont pas été formés dans les académies militaires et l’impossibilité d’effectuer tout changement dans le commandement de l’armée sans l’accord préalable du Congrès. Autrement dit, ce « pacte » prévoit que l’Etat – « un détachement d’hommes en armes en défense de la propriété » (Marx) – reste sous le contrôle de la bourgeoisie.
Allende est un martyr de notre cause. Mais le fait est qu’en acceptant ce « pacte » concocté par la droite chilienne, Allende et ses partenaires de l’UP ont commis une grave erreur. L’appareil d’Etat n’est pas au-dessus des classes, impartial ; c’est un instrument de domination aux mains de la classe dirigeante. La signature de ce pacte était une première manifestation du crétinisme parlementaire des dirigeants de l’UP, qui ont perdu un temps fou à « débattre » avec les députés de droite de la « légalité constitutionnelle » des mesures gouvernementales – pendant que les mêmes députés de droite préparaient, hors du Congrès, le renversement violent du gouvernement et l’écrasement de la révolution dans le sang. Telle était la soi-disant « voie chilienne vers le socialisme – en réalité, une voie vers le désastre.
Ajoutons que les dirigeants du PCCh, fort de leur théorie des « deux étapes » (« démocratie » d’abord, puis socialisme un jour, plus tard…) étaient les partisans les plus fanatiques du « respect de la légalité constitutionnelle ». Le secrétaire général du PCCh, Luis Corvalán, vantait régulièrement « l’aile progressiste de la bourgeoisie » (en réalité inexistante) et les soi-disant « traditions démocratiques de l’armée chilienne », le tout dans le but de convaincre les masses révolutionnaires de l’impossibilité… d’un coup d’Etat.
Si la participation aux élections du mouvement ouvrier chilien permettait à la révolution chilienne de se couvrir de la légalité parlementaire bourgeoise, l’obstination de la direction du mouvement à respecter scrupuleusement cette légalité, lorsque cela revient à se lier les mains face à l’ennemi, était une erreur majeure.
Allende répètera malheureusement cette erreur à plusieurs reprises, s’embourbant dans des manœuvres parlementaires avec la Démocratie Chrétienne au lieu de prendre les mesures qui auraient permis de transférer le pouvoir aux ouvriers. En réalité, l’élection de septembre 1970 n’était qu’un pâle reflet du rapport réel entre les classes : près de 75 % de la population était salariée. Une partie des travailleurs avaient appuyé avec beaucoup d’enthousiasme le candidat Allende ; une autre partie, qui avait voté pour la Démocratie Chrétienne, vota pour l’Unité Populaire aux élections municipales de 1971 (51 % des voix pour l’UP). Des mesures plus radicales contre la bourgeoisie auraient sûrement permis de rallier encore plus largement la classe ouvrière.
Les réalisations du gouvernement de l’UP
La campagne électorale d’Allende annonçait 40 grandes mesures. Et de fait, le gouvernement met rapidement en œuvre des réformes profondes. Il commence par nationaliser la grande industrie textile. Puis, surtout après les élections municipales de 1971, les réformes s’accélèrent sous la pression des masses : nationalisation du cuivre (80 % des exportations du pays), des mines de charbon et de nitrates, mais aussi des télécommunications. Les loyers et des biens de première nécessité sont plafonnés ; les salaires sont augmentés de 40 à 60 %.
Après un temps d’hésitation, la réforme agraire avance à grands pas – à l’initiative, surtout, de comités de paysans qui se saisissent des terres, expropriant les latifundistes. Mais les dirigeants de l’UP se méfient des organisations paysannes, les accusant d’être manipulées par des groupes « gauchistes ». Le gouvernement freine la formation des « conseils paysans », qui auraient changé l’organisation de la production. Or, faire accepter cette nécessaire réorganisation par la voie légale, c’est-à-dire via le Congrès, était impossible. Malgré cela, le gouvernement parvient à mettre fin au système latifundiaire en 1972.
L’enthousiasme de la classe ouvrière et des paysans pauvres était énorme. Cela se manifestait notamment par la multiplication d’organes du pouvoir ouvrier dans les usines et dans les quartiers ouvriers : conseils d’administration d’entreprises, associations populaires, commandos communaux, groupes de contrôle de l’approvisionnement, etc. L’euphorie gagnait même la base militante du « centre », qui scissionna sur la question : « pour ou contre la révolution » ?
A ce moment-là, dans le courant de l’année 1971, toutes les conditions étaient réunies, dans la société chilienne, pour une transformation profonde de la société : les dirigeants socialistes et communistes formaient le gouvernement légitime du pays et avaient le soutien de la base des forces armées. Un référendum pour changer la Constitution aurait permis la transition « pacifique » chère à l’Unité Populaire. Mais par une confiance aveugle en la bonne volonté de l’ennemi de classe, les chefs de l’UP ont laissé les leviers de l’appareil d’Etat aux mains de la bourgeoisie.
C’est donc une situation de double pouvoir qui s’est développée dans le pays. D’un côté, l’appareil d’Etat restait sous le contrôle des capitalistes, qui sabotaient l’économie, organisaient la pénurie, protégeaient leurs intérêts de classe et réprimaient les « excès » des masses. Mais d’un autre côté, des organes de pouvoir populaire se développaient dans les usines, les quartiers, les campagnes : « cordons industriels », « comités de ravitaillement et de contrôle des prix » luttant contre la pénurie et le marché noir, etc.
La révolution socialiste nécessitait le développement et l’armement de ces organes démocratiques, leur coordination au niveau local et national – et le transfert effectif du pouvoir entre leurs mains. La direction de l’Unité Populaire – et en particulier les dirigeants du PCCh – s’y refusait, ce qui a permis à la contre-révolution de se mettre en marche.
La contre-révolution
Dès 1971, la réaction s’organise et se prépare à frapper. D’abord par le sabotage parlementaire : grâce à la majorité simple dont la droite dispose au Congrès, elle obtient la destitution de deux hauts fonctionnaires et sept ministres d’Allende, en trois mois à peine. Puis la bourgeoisie organise le sabotage de l’économie nationale : elle organise la pénurie et le marché noir, ainsi que des manifestations comme la « marche des casseroles vides ». Des campagnes dans la presse – qui est encore sous le contrôle des capitalistes – désignent Allende comme le responsable du chaos généralisé. Des groupes armés agissent dans la rue, organisant des attentats et semant la terreur. Dans les campagnes, des violences sévissent et des militants paysans sont assassinés. En octobre 1972, une grève des transporteurs financée par les Etats-Unis – qui organisent aussi un embargo contre le Chili – bloque le pays pendant trois semaines, menant le Chili au bord d’une guerre civile.
En mars 1973, les élections législatives renforcent encore l’Unité Populaire (43,4 %). Une partie de l’opposition crie à la fraude et mobilise dans la rue. Le MAPU, le MIR (deux partis de l’UP) et une fraction du PS appellent alors à un approfondissement de la révolution et à la constitution d’une Assemblée Révolutionnaire pour remplacer le congrès. Lors d’un discours d’Allende au Stade national, la base militante de l’UP crie : « assez de conciliations, c’est l’heure de lutter ! » En vain.
La réaction organise et finance des grèves dans la mine d’El Teniente, ce qui aboutit à une manifestation de masse à la mi-juin 1973. Le 29 juin, une tentative de coup d’Etat est menée par le deuxième régiment blindé de l’armée, qui attaque le palais présidentiel de La Monéda. Cette tentative échoue grâce à la mobilisation des masses et faute d’un soutien suffisant – à ce stade – au sein de l’armée. Les travailleurs se mobilisent et manifestent devant le palais présidentiel pour réclamer des armes pour se défendre. Mais le gouvernement continue de s’y refuser. Le Président demande aux travailleurs de se remettre au travail. Cette réaction rassure et renforce la réaction.
En août, le patronat des transports organise une deuxième grève. La petite bourgeoisie commence à basculer vers la droite et des manifestations s’organisent sous la coupe de l’organisation fasciste « Patrie et Liberté ». Le 23 août, Allende nomme Pinochet à la tête de l’armée, sous la pression de la droite, et intègre deux militaires au gouvernement. Une grande manifestation est organisée le 4 septembre, date anniversaire de l’accession au pouvoir de l’Unité Populaire, qui réunit 800 000 personnes à Santiago. Encore une fois, les travailleurs demandent des armes au gouvernement.
Le 9 septembre, le Secrétaire Général du Parti Socialiste, Carlos Altamirano, appelle à l’affrontement et demande que l’on arme le peuple. Allende lui répond qu’il va organiser un référendum. Le rapport de force, encore sensiblement favorable à la révolution, aurait sans doute permis à l’Unité Populaire de faire adopter le référendum. C’est pour cela que la classe dominante frappe deux jours plus tard, le 11 septembre 1973, par un coup d’Etat d’une violence inédite en Amérique latine.
La dictature de Pinochet
Le général Augusto Pinochet prend le pouvoir, dissout le parlement et traque tous les militants de gauche : ils sont emprisonnés, torturés, assassinés. La violence de la répression est à la hauteur de la puissance du mouvement ouvrier chilien.
Le coup d’Etat débouche sur un régime de type bonapartiste. Il ressemble, à certains égards, à un régime fasciste : arrestations et assassinats massifs, camps de concentration... Mais en réalité, le régime de Pinochet n’a pas la base sociale du fascisme : il s’appuie essentiellement sur les forces répressives de l’appareil d’Etat. C’est pour cette raison qu’il est assez rapidement gagné par une instabilité chronique qui aboutira à son renversement, à la fin des années 80.
Le gouvernement de Pinochet subit de plein fouet la crise de 1974-76. L’impérialisme mondial (FMI, Banque Mondiale, etc.) vole alors à son secours et lui accorde des prêts importants. En échange, Pinochet doit appliquer dès 1975 un programme d’austérité qui fait du Chili le « laboratoire du néo-libéralisme », selon une expression consacrée, avec des conséquences dramatiques pour l’économie nationale – et surtout pour la classe ouvrière chilienne, qui subit la faim, la misère et le chômage. De nombreux cadres ouvriers ayant travaillé dans la clandestinité ont témoigné, depuis, de l’humiliation insoutenable du peuple chilien pendant cette période.
Leçons
La révolution chilienne a marqué l’histoire de l’Amérique latine et a eu un impact colossal sur l’ensemble du mouvement ouvrier international. Nous avons apporté quelques éléments qui prouvent que ce sont les erreurs des dirigeants socialistes et communistes qui ont mené à la catastrophe. C’est une leçon très importante, car elle rappelle le rôle crucial du « facteur subjectif » (le parti et sa direction) dans une révolution.
Le gouvernement de l’Unité Populaire aurait dû – et aurait pu – exproprier la totalité des grands groupes capitalistes, organiser la planification de l’économie et placer le pouvoir effectif – le pouvoir d’Etat – entre les mains des travailleurs et des paysans. Au lieu de cela, malgré la nationalisation des secteurs stratégiques de l’économie, une « économie mixte » était mise en place, qui laissait à la réaction la possibilité de désorganiser l’économie chilienne.
Surtout, comme le rappelle le sous-titre de l’excellent documentaire de Patricio Guzman, La Bataille du Chili, la révolution chilienne fut « la lutte d’un peuple sans armes ». Celles-ci sont restées sous le contrôle de la bourgeoisie. Sachons analyser cette défaite, ses causes profondes, pour préparer les victoires futures.
- Détails
- Révolution
La Commune de Paris fut l’un des plus grands épisodes de l’histoire de la classe ouvrière française. Entre le soulèvement du 18 mars et la « Semaine sanglante », fin mai, Paris fut dirigé par les organes démocratiques des travailleurs, qui ont tenté de réorganiser la société sur des bases entièrement nouvelles – sans exploitation ni oppression. Les leçons de ces événements sont toujours d’une très grande actualité.
Vingt ans auparavant, Napoléon III avait pris le pouvoir lors du coup d’Etat militaire, le 2 décembre 1851. Au début, son régime semblait inébranlable. Les organisations ouvrières étaient réprimées. Mais vers la fin des années 1860, le régime impérial était sérieusement affaibli par l’épuisement de la croissance économique, les répercussions des guerres (en Italie, en Crimée, au Mexique) et la résurgence du mouvement ouvrier. Seule une nouvelle guerre – et une victoire rapide – pouvait retarder la chute de « Napoléon le Petit ». En juillet 1870, il déclara la guerre à la Prusse de Bismarck.
La guerre et la révolution
La guerre mène souvent à la révolution. Et pour cause : la guerre arrache subitement les peuples à leur routine quotidienne et les jette dans l’arène des grandes actions historiques. Les masses examinent beaucoup plus attentivement qu’en période de paix le comportement des chefs d’Etat, des généraux et des politiciens. C’est particulièrement vrai en cas de défaite. Or, l’offensive militaire lancée par Napoléon III tourna vite au fiasco. Le 2 septembre, près de Sedan, l’Empereur fut arrêté par l’armée de Bismarck, en même temps que 75 000 soldats. A Paris, des manifestations massives réclamaient la fin de l’Empire et la proclamation d’une République démocratique.
Sous cette pression de la rue, l’opposition républicaine « modérée » proclama la République le 4 septembre. Un « Gouvernement de Défense Nationale » fut installé. Ministre des Affaires étrangères, le républicain bourgeois Jules Favre déclara pompeusement que « pas un pouce de terrain et pas une pierre de nos forteresses » ne seraient cédés aux Prussiens.
Les troupes allemandes encerclèrent rapidement Paris et placèrent la ville en état de siège. Dans un premier temps, la classe ouvrière parisienne accorda son soutien au nouveau gouvernement, au nom de « l’unité » contre l’ennemi étranger. Mais le cours ultérieur des événements brisa cette unité et fit apparaître au grand jour les intérêts de classe contradictoires qu’elle recouvrait.
En réalité, le Gouvernement de Défense Nationale ne croyait ni possible, ni même désirable de défendre Paris. En dehors de l’armée régulière, une milice forte de 200 000 hommes, la Garde Nationale, se déclara prête à défendre la ville. Mais ces travailleurs armés à l’intérieur de Paris constituaient une menace bien plus grande pour les intérêts des capitalistes français que l’armée étrangère aux portes de la cité. Le gouvernement pensait qu’il était préférable de capituler dès que possible face à Bismarck. Cependant, étant donné l’état d’esprit combatif de la Garde Nationale, le gouvernement ne pouvait pas déclarer publiquement ses intentions. Le ministre et général Trochu comptait sur les effets économiques et sociaux du siège pour briser la résistance des travailleurs parisiens. Le gouvernement voulait gagner du temps ; tout en se déclarant favorable à la défense de Paris, il engagea des négociations secrètes avec Bismarck.
Les semaines passant, l’hostilité des travailleurs parisiens envers le gouvernement augmentait. Des rumeurs sur des négociations avec Bismarck circulaient. Le 8 octobre, la chute de Metz provoqua une nouvelle manifestation de masse. Le 31 octobre, plusieurs contingents de la Garde Nationale attaquèrent et occupèrent temporairement l’Hôtel de Ville. A ce stade, cependant, la masse des travailleurs n’était pas encore prête à une offensive décisive contre le gouvernement. Isolée, l’insurrection s’essouffla rapidement.
Dans Paris, le siège avait des conséquences désastreuses. Il était urgent de le briser. Après l’échec de la sortie en direction du village de Buzenval, le 19 janvier 1871, le général Trochu n’eut d’autre choix que de démissionner. Il fut remplacé par Vinoy, qui déclara d’emblée qu’il n’était plus possible de vaincre les Prussiens. Il était clair pour tous, désormais, que le gouvernement voulait capituler – ce qu’il fit le 27 janvier.
Parisiens et « ruraux »
Aux élections de l’Assemblée Nationale, en février, les votes de la paysannerie donnèrent une majorité écrasante aux candidats monarchistes et conservateurs. La nouvelle Assemblée nomma Adolphe Thiers – un réactionnaire endurci – à la tête du gouvernement. Un conflit entre Paris et l’Assemblée « rurale » était inévitable. Mais en relevant la tête, le danger contre-révolutionnaire donna une puissante impulsion à la révolution parisienne. Les manifestations armées de la Garde Nationale se multipliaient, massivement soutenues par les couches les plus pauvres de la population. Les travailleurs en armes dénonçaient Thiers et les monarchistes comme des traîtres et en appelaient à la « guerre à outrance » pour la défense de la République.
L’Assemblée Nationale provoquait constamment les Parisiens. Le siège avait mis de nombreux travailleurs au chômage ; les indemnités versées aux gardes nationaux étaient tout ce qui les séparait de la famine. Or, le gouvernement supprima les indemnités payées à chaque garde qui ne pouvait prouver qu’il était incapable de travailler. Il décréta également que les arriérés de loyer et toutes les créances devaient être réglés dans les 48 heures. Ces mesures, et d’autres encore, frappèrent de plein fouet les plus pauvres, mais aboutirent aussi à une radicalisation des classes moyennes.
La capitulation du gouvernement face à Bismarck et la menace d’une restauration monarchiste menèrent à une transformation de la Garde Nationale. Un « Comité Central de la Fédération de la Garde Nationale » fut élu, représentant 215 bataillons équipés de 2000 canons et 450 000 fusils. De nouveaux statuts furent adoptés, stipulant « le droit absolu des Gardes nationaux d’élire leurs dirigeants et de les révoquer aussitôt qu’ils perdraient la confiance de leurs électeurs ». Ce Comité Central et les structures correspondantes, au niveau des bataillons, préfiguraient les soviets de travailleurs et de soldats qui firent leur apparition, en Russie, au cours des révolutions de 1905 et 1917.
La nouvelle direction de la Garde Nationale eut rapidement l’occasion de tester son autorité. Alors que l’armée prussienne s’apprêtait à entrer dans Paris, des dizaines de milliers de Parisiens armés se rassemblèrent avec l’intention d’attaquer les envahisseurs. Le Comité Central intervint pour empêcher un combat inéquitable et pour lequel il n’était pas encore préparé. En imposant sa volonté sur cette question, le Comité Central démontrait que son autorité était reconnue par la majorité de la Garde Nationale et des Parisiens. Les forces prussiennes occupèrent une partie de la ville pendant deux jours, puis s’en retirèrent.
Le 18 mars
 Aux « ruraux » de l’Assemblée, Thiers avait promis de restaurer la monarchie. Mais sa tâche immédiate était de mettre un terme à la situation de « double pouvoir » qui existait à Paris. Les canons sous le contrôle de la Garde Nationale – et en particulier ceux des hauteurs de Montmartre – symbolisaient la menace contre « l’ordre » capitaliste. Le 18 mars, à 3 heures du matin, 20 000 soldats et gendarmes furent envoyés, sous le commandement du général Lecomte, pour saisir ces canons. Cela se fit sans trop de difficultés. Cependant, les commandants de l’expédition n’avaient pas pensé aux attelages nécessaires pour déplacer les canons. A 7 heures, les attelages n’étaient toujours pas arrivés. Dans son Histoire de la Commune, Lepelletier décrit ce qui se passa : « Bientôt, le tocsin se mit à sonner et l’on entendait, dans la chaussée Clignancourt, les tambours battre la générale. Rapidement, ce fut comme un changement de décor dans un théâtre : toutes les rues menant à la Butte s’emplirent d’une foule frémissante. Les femmes formaient la majorité ; il y avait aussi des enfants. Des gardes nationaux isolés sortaient en armes et se dirigeaient vers le Château-Rouge. »
Aux « ruraux » de l’Assemblée, Thiers avait promis de restaurer la monarchie. Mais sa tâche immédiate était de mettre un terme à la situation de « double pouvoir » qui existait à Paris. Les canons sous le contrôle de la Garde Nationale – et en particulier ceux des hauteurs de Montmartre – symbolisaient la menace contre « l’ordre » capitaliste. Le 18 mars, à 3 heures du matin, 20 000 soldats et gendarmes furent envoyés, sous le commandement du général Lecomte, pour saisir ces canons. Cela se fit sans trop de difficultés. Cependant, les commandants de l’expédition n’avaient pas pensé aux attelages nécessaires pour déplacer les canons. A 7 heures, les attelages n’étaient toujours pas arrivés. Dans son Histoire de la Commune, Lepelletier décrit ce qui se passa : « Bientôt, le tocsin se mit à sonner et l’on entendait, dans la chaussée Clignancourt, les tambours battre la générale. Rapidement, ce fut comme un changement de décor dans un théâtre : toutes les rues menant à la Butte s’emplirent d’une foule frémissante. Les femmes formaient la majorité ; il y avait aussi des enfants. Des gardes nationaux isolés sortaient en armes et se dirigeaient vers le Château-Rouge. »
Les soldats furent encerclés par une foule sans cesse croissante. Les habitants du quartier, les gardes nationaux et les hommes de Lecomte étaient pressés les uns contre les autres. Certains soldats fraternisaient ouvertement avec les gardes. Dans une tentative désespérée de réaffirmer son autorité, Lecomte ordonna à ses hommes de tirer sur la foule. Personne ne tira. Les soldats et les gardes nationaux poussèrent alors des acclamations et s’étreignirent mutuellement. Très vite, Lecomte et Clément Thomas furent arrêtés. Des soldats en colère les exécutèrent peu après. Clément Thomas était connu pour avoir fait tirer sur les travailleurs insurgés en juin 1848.
Thiers n’avait pas prévu la défection des troupes. Pris de panique, il s’enfuit de Paris. Il ordonna à l’armée et aux administrations d’évacuer complètement la ville et les forts environnants. Il voulait éloigner l’armée de la « contagion » révolutionnaire. Une partie des soldats – certains ouvertement insubordonnés, chantant et scandant des slogans révolutionnaires – se retirèrent dans le désordre vers Versailles.
Avec l’effondrement du vieil appareil d’Etat à Paris, la Garde Nationale prit tous les points stratégiques de la ville sans rencontrer de résistance significative. Le Comité Central n’avait joué aucun rôle dans ces événements. Et pourtant, le soir du 18 mars, il découvrit que, malgré lui, il était devenu le gouvernement de facto d’un nouveau régime révolutionnaire basé sur le pouvoir armé de la Garde Nationale.
Vacillations du Comité Central
La première tâche que la majorité des membres du Comité Central se fixa fut de se débarrasser du pouvoir. Après tout, disaient-ils, nous n’avons pas de « mandat légal » pour gouverner ! Au terme de longues discussions, le Comité Central accepta avec réticence de rester à l’Hôtel de Ville pour les « quelques jours » pendant lesquels des élections municipales (communales) pourraient être organisées.
Le problème immédiat auquel le Comité Central faisait face était l’armée en route pour Versailles, sous la direction de Thiers. Eudes et Duval proposèrent de faire immédiatement marcher la Garde Nationale sur Versailles, de façon à briser ce qui restait de force à la disposition de Thiers. Mais ils ne furent pas écoutés. La majorité du Comité Central jugeait préférable de ne pas « apparaître comme les agresseurs ». Le Comité Central était composé, dans sa majorité, d’hommes honnêtes mais très modérés, trop modérés.
L’énergie du Comité Central fut absorbée dans de longues négociations sur la date et les modalités des élections communales. Elles furent finalement fixées au 26 mars. Thiers utilisa ce temps précieux à son avantage. Avec l’aide de Bismarck, l’armée regroupée à Versailles fut massivement renforcée en effectifs et en armes, dans le but de lancer une attaque contre Paris.
A la veille des élections, le Comité Central de la Garde Nationale publia une déclaration remarquable qui résume l’esprit d’abnégation et de probité qui caractérisait le nouveau régime : « Notre mission est terminée. Nous allons céder la place dans notre Hôtel de Ville à vos nouveaux élus, à vos mandataires réguliers. » Le Comité Central n’avait qu’une seule consigne à donner aux électeurs : « Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous des ambitieux et des parvenus [...] Défiez-vous des parleurs, incapables de passer à l’action [...] »
Le programme de la Commune
La Commune nouvellement élue remplaça le commandement de la Garde Nationale comme gouvernement officiel du Paris révolutionnaire. La majorité de ses 90 membres peut être décrite comme « républicaine de gauche ». Les militants de l’Association Internationale des Travailleurs (dirigée, entre autres, par Karl Marx) et les blanquistes (hommes énergiques, mais politiquement confus) représentaient ensemble près d’un quart des élus de la Commune. Les quelques élus de droite démissionnèrent de leurs postes sur divers prétextes.
Sous la Commune, tous les privilèges des hauts fonctionnaires de l’Etat furent abolis. On décréta notamment qu’ils ne devaient pas percevoir davantage, pour leur service, que le salaire d’un ouvrier qualifié. Ils étaient aussi révocables à tout moment.
Les loyers furent gelés. Les fabriques abandonnées furent placées sous le contrôle des travailleurs. Des mesures furent prises pour limiter le travail de nuit et garantir la subsistance des pauvres et des malades. La Commune déclara vouloir ainsi « mettre un terme à la concurrence anarchique et ruineuse entre les travailleurs au profit des capitalistes ». La Garde Nationale fut ouverte à tous les hommes aptes au service militaire – et organisée sur des principes strictement démocratiques. Les armées permanentes « séparées du peuple » furent déclarées illégales.
L’Eglise fut séparée de l’Etat et la religion déclarée « affaire privée ». Les logements et les bâtiments publics furent réquisitionnés pour les sans-logis, l’éducation publique ouverte à tous, de même que les lieux de culture et d’apprentissage. Les travailleurs étrangers étaient considérés comme des alliés dans la lutte pour une « république universelle ». Des réunions avaient lieu nuit et jour ; des milliers d’hommes et de femmes ordinaires y discutaient de la façon dont devaient être organisés les différents aspects de la vie sociale dans l’intérêt du « bien commun ». Les caractéristiques de la société nouvelle qui prenait forme, à Paris, étaient clairement socialistes.
La défaite
 Il est vrai que les communards ont commis de nombreuses erreurs. Marx et Engels leur ont reproché – à juste titre – de ne pas avoir pris le contrôle de la Banque de France, qui continuait à verser des millions de francs à Thiers, lequel s’en servait pour armer et réorganiser ses forces.
Il est vrai que les communards ont commis de nombreuses erreurs. Marx et Engels leur ont reproché – à juste titre – de ne pas avoir pris le contrôle de la Banque de France, qui continuait à verser des millions de francs à Thiers, lequel s’en servait pour armer et réorganiser ses forces.
De même, la menace des Versaillais fut clairement sous-estimée par la Commune, qui non seulement ne tenta pas de les attaquer – du moins jusqu’à la première semaine d’avril –, mais ne s’est même pas sérieusement préparée à se défendre. Le 2 avril, un détachement communard se dirigeant vers Courbevoie fut attaqué et repoussé vers Paris. Les prisonniers aux mains des forces de Thiers furent exécutés. Le jour suivant, sous la pression de la Garde Nationale, la Commune lança une attaque contre Versailles. Mais malgré l’enthousiasme des bataillons communards, le manque de préparation militaire et politique condamnait à l’échec cette sortie tardive. Les dirigeants de la Commune croyaient que, comme le 18 mars, l’armée de Versailles rallierait la Commune à la simple vue de la Garde Nationale. Il n’en fut rien.
Ce revers fit déferler sur Paris une vague de défaitisme. L’optimisme résolu des premières semaines fit place au pressentiment d’une défaite imminente, ce qui accentua les divisions à tous les niveaux du commandement militaire. Finalement, l’armée de Versailles entra dans Paris le 21 mai. A l’Hôtel de Ville, la Commune était dépourvue, au moment décisif, d’une stratégie militaire sérieuse. Elle cessa tout simplement d’exister, abdiquant toutes ses responsabilités au profit d’un Comité de Salut Public totalement inefficace.
Les Gardes nationaux furent postés au combat « dans leurs quartiers », sans commandement centralisé. Cette décision empêcha toute concentration de forces communardes capable de résister à la poussée des troupes versaillaises. Les communards combattirent avec un immense courage, mais furent graduellement repoussés vers l’est de la cité, et finalement vaincus le 28 mai. Les derniers communards qui résistaient furent fusillés dans le 20e arrondissement, devant le « Mur des Fédérés », que l’on peut encore voir au cimetière du Père-Lachaise. Au cours de la « Semaine sanglante », les forces de Thiers massacrèrent au moins 30 000 hommes, femmes et enfants, puis firent autour de 20 000 victimes supplémentaires dans les semaines suivantes.
L’Etat ouvrier
La Commune de Paris fut le premier gouvernement ouvrier de l’histoire. Dans La Guerre Civile en France, Marx expliqua que la Commune avait prouvé la chose suivante : les travailleurs « ne peuvent pas (…) se contenter de prendre l’appareil d’Etat existant et de faire fonctionner cet instrument pour son propre compte. La première condition pour conserver le pouvoir politique, c’est de (…) détruire cet instrument de domination de classe ». Précisément, les communards ont tenté de construire un nouvel Etat – un Etat ouvrier – sur les ruines de l’Etat capitaliste (à Paris). Ce faisant, ils ont montré quelles sont les caractéristiques fondamentales d’un Etat ouvrier : pas de bureaucratie ; pas d’armée séparée du peuple ; pas de fonctionnaires privilégiés ; élection et révocabilité de tous les officiels, etc.
Les communards n’eurent pas le temps de consolider leur pouvoir. Leur isolement – dans une France encore largement paysanne – leur fut fatal. Aujourd’hui, à l’inverse, c’est le salariat qui domine d’une façon écrasante. Les bases économiques de la révolution socialiste sont beaucoup plus mûres qu’au XIXe siècle. A nous, donc, de faire advenir la société socialiste, libre et démocratique, pour laquelle les communards se battirent et moururent.
- Détails
- Rob Sewell
Cet article fut publié une première fois le 21 janvier 2014, à l’occasion du 90e anniversaire de la mort de Lénine, sur le site In Defence of Marxism.
Il y a 90 ans, le 21 janvier 1924, Vladimir Lénine, le grand marxiste et dirigeant de la révolution russe, est décédé des suites de complications dues à une tentative d’assassinat antérieure. Dès lors, une campagne continue visant à calomnier son nom et déformer ses idées a été lancée, allant des historiens bourgeois et apologistes de la bourgeoisie jusqu’aux différents réformistes, libéraux et groupes anarchistes. Leur tâche est de discréditer Lénine, le marxisme et la révolution russe, tout cela dans les intérêts du règne « démocratique » des banquiers et capitalistes.
Une récente biographie du professeur Robert Service, Lenin, A Political Life, The Iron Ring [simplement Lénine, en version française], affirme que :
« Bien que ce volume tienne à être un récit objectif [!] et multidimensionnel, nul ne peut écrire sur Lénine avec détachement. Son intolérance et sa répression ne cessent de m’horrifier. »
Un autre historien « objectif », Anthony Read, va encore plus loin, affirmant, sans aucune preuve, que Lénine était en minorité au Congrès du Parti de 1903 et qu’il a simplement choisi le nom « bolchevik » (le mot russe pour « majorité »), car « Lénine ne manquait jamais une occasion de favoriser l’illusion du pouvoir. Par conséquent, dès ses tout débuts, le bolchevisme fut fondé sur un mensonge, créant un précédent qui allait être suivi pour les 90 années à venir. »
M. Read continue sa diatribe : « Lénine n’avait pas le temps pour la démocratie, n’avait aucune confiance dans les masses et aucun scrupule dans l’usage de la violence. » (The World on Fire, 1919 and the Battle with Bolshevism, pp. 3-4, Jonathan Cape, 2008)
Il n’y a rien de neuf avec ces fausses affirmations qui s’appuient non pas sur les écrits de Lénine, mais plutôt sur les épanchements des professeurs Orlando Figes et Robert Service, deux « experts » sur les « démons » de Lénine et de la révolution russe. Remplis de haine, ils véhiculent le mensonge selon lequel Lénine aurait créé le stalinisme.
De même, les staliniens, ayant fait de Lénine une icône inoffensive, ont également diffamé ses idées afin de servir leurs crimes et leurs trahisons. La veuve de Lénine, Kroupskaïa, avait l’habitude de citer les paroles de son époux :
« Il est arrivé plus d’une fois dans l’histoire que la doctrine de grands révolutionnaires soit déformée après leur mort. Les hommes en ont fait des icônes inoffensives et, tout en entourant leur nom d'une certaine auréole, ils émoussent le tranchant révolutionnaire de leur doctrine. »
En 1926, Kroupskaïa affirmait que « si Lénine était vivant, il serait certainement dans les prisons de Staline ».
Lénine était sans aucun doute l’un des plus grands révolutionnaires de notre temps, ses efforts culminant avec la victoire d’octobre 1917 et ses écrits transformant le cours de l’histoire mondiale. Pour la révolution socialiste, Lénine est passé de la parole aux actes. Il est devenu, du jour au lendemain, « l’homme le plus détesté et le plus aimé sur terre ».
La jeunesse de Lénine
Né à Simbirsk, près de la Volga, en 1870, Lénine allait vivre les années de grands bouleversements en Russie. Ce pays semi-féodal était dirigé par le despotisme tsariste. L’intelligentsia révolutionnaire, face à ce despotisme, était attirée vers les méthodes terroristes de la Volonté du Peuple (Narodnaya Volya). En effet, le frère aîné de Lénine, Alexandre, fut pendu pour sa participation à la tentative d’assassinat du Tsar Alexandre III.
Suite à cette tragédie, Lénine entra à l’université et fut rapidement expulsé pour ses activités. Cela ne fit qu’augmenter sa soif de politique et l’amena à entrer en contact avec des cercles marxistes. Cela mena à une étude du Capital de Marx, qui circulait alors en petit nombre, puis de l’Anti-Dühring d’Engels.
Il entra en contact avec les exilés du Groupe pour l’Émancipation du Travail, mené par George Plekhanov, le père du marxisme russe, que Lénine regardait comme son père spirituel. Il déménagea, à l’âge de 23 ans, de Samara à Saint-Pétersbourg afin d’y former l’un des premiers groupes marxistes.
« C’est ainsi, entre l’exécution de son frère et son déménagement vers Saint-Pétersbourg, au cours de ces six années de dur labeur à la fois longues et courtes, que fut formé le futur Lénine », explique Trotsky. « Tous les traits fondamentaux de sa personnalité, son regard sur la vie et son mode d’action étaient déjà formés durant l’intervalle entre la dix-septième et la vingt-troisième année de sa vie. »
Des investissements étrangers massifs stimulèrent le développement du capitalisme et permirent l’émergence d’une petite classe ouvrière vierge. L’émergence de cercles d’étude et l’impact des idées marxistes menèrent à des tentatives d’établir un Parti social-démocrate révolutionnaire russe.
Lénine rencontra Plekhanov en Suisse en 1895 et, à son retour, il fut arrêté, emprisonné puis exilé. Le Premier congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR) eut lieu en 1898, mais il y eut un raid policier et les participants furent arrêtés.
Marxisme et bolchevisme
À la fin de son exil, Lénine concentrait ses efforts sur la mise sur pied d’un journal marxiste : Iskra, « L’étincelle ». L’Iskra devait établir le marxisme en tant que force dominante de la gauche. Introduit clandestinement en Russie, le journal servit à unir les cercles en un parti national unifié sur de solides bases politiques et théoriques.
C’est lors de cette période que Lénine écrivit sa célèbre brochure Que faire?, dans laquelle il défendait l’idée d’un parti composé de révolutionnaires professionnels, d’individus dédiés à la cause.
En 1903 se tint le Deuxième congrès du POSDR, qui fut essentiellement le congrès de fondation. C’est là que les camarades de l’Iskra s’établirent comme courant dominant du parti. Cependant, une scission ouverte eut lieu, lors des dernières procédures à propos de questions organisationnelles, entre Lénine et Martov, tous deux éditeurs de l’Iskra. La majorité autour de Lénine allait être connue sous le nom de « bolcheviks », et la minorité autour de Martov sous celui de « mencheviks ».
Plusieurs mythes entourent cette scission qui prit par surprise la plupart des participants, incluant Lénine. Il n’y avait aucun désaccord politique à cette époque. Ceux-ci allaient émerger plus tard seulement. Lénine tenta de réconcilier les factions, mais échoua. Il qualifia plus tard la scission d’« anticipation » de différences importantes qui allaient surgir ultérieurement.
Ces différences émergèrent sur la question des perspectives pour la révolution en Russie. Toutes les tendances voyaient la révolution à venir comme étant « démocratique-bourgeoise » et qu’elle aurait pour tâche de balayer le vieux régime féodal et de paver la voie au développement capitaliste. Les mencheviks, cependant, affirmaient que dans cette révolution, les travailleurs auraient à se subordonner à la direction de la bourgeoisie. Les bolcheviks, quant à eux, croyaient que la bourgeoisie libérale ne pouvait mener à bien la révolution puisqu’elle était liée au féodalisme et à l’impérialisme, et qu’en conséquence les travailleurs devraient mener la révolution avec l’appui des paysans. Ils formeraient ensemble une « dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie », qui provoquerait la révolution socialiste en Occident. En retour, cette révolution viendrait en aide à la révolution russe. Trotsky défendait une troisième position : il était d’accord avec Lénine sur le fait que les travailleurs dirigeraient la révolution, mais il croyait qu’ils ne devraient pas s’arrêter à mi-chemin, mais devraient plutôt continuer avec des mesures socialistes, et commencer la révolution socialiste mondiale. En fin de compte, les événements de 1917 confirmèrent le pronostic de Trotsky, celui de la « révolution permanente ».
L’internationalisme
La Révolution de 1905 fut une manifestation concrète du rôle dirigeant de la classe ouvrière. Tandis que les libéraux se mettaient aux abris, les travailleurs mirent sur pied des soviets, dans lesquels Lénine y vit l’embryon du pouvoir ouvrier. Dans ces conditions, le POSDR grossit énormément et cela fit se rapprocher les deux factions du parti.
La défaite de la Révolution de 1905, cependant, fut suivie d’une période de réaction impitoyable. Le parti faisait face à des difficultés immenses et devenait de plus en plus isolé des masses. Les bolcheviks et les mencheviks s’éloignaient davantage tant au niveau politique qu’organisationnel, jusqu’à ce qu’en 1912 les bolcheviks se constituent en un parti indépendant.
Au cours de ces années, Trotsky était un « conciliateur » entre les bolcheviks et les mencheviks. Il se tenait à l’écart des deux factions tout en prônant « l’unité ». Cette attitude conduisit à d’importants conflits avec Lénine, qui défendait l’indépendance politique des bolcheviks. Ces conflits furent utilisés plus tard par les staliniens pour discréditer Trotsky, et ce malgré l’instruction de Lénine, contenue dans son testament, de ne pas invoquer le passé non-bolchevik de Trotsky contre lui.
Le réveil du mouvement ouvrier après 1912 témoignait d’un appui grandissant aux bolcheviks, qui revendiquaient l’appui de l’écrasante majorité des travailleurs russes. Cette croissance allait cependant être freinée par la Première Guerre mondiale.
La trahison d’août 1914 et la capitulation des dirigeants de la IIe Internationale furent un revers terrible pour le socialisme international. Cela signifiait la mort effective de cette Internationale.
La petite poignée d’internationalistes du monde se regroupa lors d’une conférence antiguerre tenue à Zimmerwald en 1915, où Lénine appela à la formation d’une nouvelle Internationale ouvrière. Ce furent des jours difficiles; les forces du marxisme étaient complètement isolées. Les perspectives révolutionnaires semblaient plutôt sombres en effet. En janvier 1917, Lénine s’adressa à une petite réunion des Jeunesses socialistes suisses à Zurich. Il nota que la situation allait finir par changer, mais qu’il ne vivrait pas pour voir la révolution. Et pourtant, un mois plus tard, la classe ouvrière russe renversait le tsarisme et une situation de double pouvoir était créée. En l’espace de neuf mois, Lénine se trouvait à la tête d’un gouvernement de Commissaires du Peuple.
La révolution russe
Alors à Zurich, Lénine passait au peigne fin les journaux afin de se tenir au courant des dernières nouvelles de la Russie. Il vit que les soviets, dominés alors par les dirigeants des socialistes-révolutionnaires (SR) et des mencheviks, avaient rendu le pouvoir au Gouvernement provisoire, mené par le Prince Lvov, un monarchiste. Il envoya immédiatement un télégramme à Kamenev et Staline, qui vacillaient : « Aucun appui au Gouvernement provisoire ! Aucune confiance en Kerensky ! »
Écrivant pendant son exil, Lénine avertit :
« Notre révolution est bourgeoise : aussi les ouvriers doivent-ils soutenir la bourgeoisie, disent les Potressov, les Gvozdev, les Tchkhéidzé, comme le disait hier encore Plekhanov.
Notre révolution est bourgeoise, disons-nous, nous marxistes : aussi les ouvriers doivent-ils ouvrir les yeux au peuple sur les mensonges des politiciens bourgeois, lui apprendre à ne pas croire aux paroles, à compter uniquement sur ses forces, son organisation, son union, son armement… vous devez accomplir des prodiges d'organisation prolétarienne et populaire pour préparer votre victoire dans la seconde étape de la révolution. »
Dans sa lettre d’adieux destinée aux travailleurs suisses, Lénine expliqua la tâche clé : « faire de notre révolution le prologue de la révolution socialiste mondiale. »
Lorsque Lénine retourna en Russie le 3 avril 1917, il rédigea ses Thèses d’avril : une seconde révolution russe doit être une étape vers la révolution socialiste mondiale ! Il fit une sortie résolue contre la vieille garde du parti qui retardait sur les événements et il se battit pour réarmer le parti bolchevique.
« Quiconque, aujourd'hui, ne parle que de la ‘‘dictature démocratique révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie’’ retarde sur la vie, est passé de ce fait, pratiquement, à la petite bourgeoisie contre la lutte de classe prolétarienne, et mérite d'être relégué aux archives des curiosités prérévolutionnaires ‘‘bolcheviques’’ (aux archives des ‘‘vieux bolcheviks’’, pourrait-on dire). »
Il réussit à gagner l’appui de la base et put ainsi surmonter la résistance de la direction du parti, qui, ironiquement, l’accusait de « trotskysme ». En réalité, Lénine était arrivé à la position de Trotsky, celle de la révolution permanente, par sa propre voie.
En mai, Trotsky fut de retour en Russie après avoir été emprisonné par les Britanniques au Canada. « Deux ou trois jours après mon arrivée à Petrograd, j’ai lu les Thèses d’avril de Lénine. C’était exactement ce dont la révolution avait besoin », expliqua Trotsky. Sa ligne de pensée était identique à celle de Lénine. Avec l’assentiment de Lénine, Trotsky se joignit à l’organisation interdistrict avec comme objectif de la gagner au bolchevisme. Il entra en collaboration étroite avec les bolcheviks, se décrivant lui-même en tous lieux comme « nous, les bolcheviks-internationalistes ».
La prise du pouvoir
Le 1er novembre 1917, lors d’une rencontre du Comité de Petrograd, Lénine affirma qu’une fois que Trotsky eut été convaincu de l’impossibilité d’une union avec les mencheviks, « il n'y a pas eu de meilleur bolchevik ». Revenant sur la révolution deux ans plus tard, Lénine écrivit : « Au moment de la conquête du pouvoir, lorsque fut créée la République des soviets, le bolchevisme avait attiré à lui tout ce qu'il y avait de meilleur dans les tendances de la pensée socialiste proches de lui. »
« Ce n'est pas Lénine qui est venu à moi, c'est moi qui suis allé à Lénine », affirma Trotsky avec modestie. « Je l'ai rejoint plus tard que bien d'autres. Mais je m'enorgueillis de penser que je ne l'avais pas moins bien compris que les autres. »
Dans les mois qui ont précédé la révolution, Lénine avait appelé les soviets dominés par les mencheviks et les SR à rompre avec les ministres capitalistes et à prendre le pouvoir, ce qu’ils refusèrent obstinément de faire. Cependant, les slogans bolcheviques – Le pain, la terre et la paix ! Tout le pouvoir aux soviets ! – gagnèrent rapidement un appui chez les masses. Les manifestations de masse en juin reflétaient ce virage. Cela incita le nouveau premier ministre Kerensky à lancer une campagne de répression contre les bolcheviks. Les « Journées de juillet » virent les bolcheviks contraints à la clandestinité. Une campagne hystérique fut attisée contre eux, on les traitait « d’agents allemands », ce qui força Lénine et Zinoviev à se cacher et mena aux arrestations de Trotsky, Kamenev, Kollontai et d’autres leaders bolcheviques.
En août, le général Kornilov tenta d’imposer sa propre dictature fasciste. Craignant Kornilov et cherchant désespérément à obtenir de l’aide, le gouvernement remit Trotsky et d’autres bolcheviks en liberté. Les travailleurs et soldats bolcheviques saisirent l’occasion et infligèrent une défaite à la contre-révolution de Kornilov.
Cela fît s’accroître l’appui aux bolcheviks, qui gagnèrent la majorité dans les soviets de Petrograd et de Moscou. « Nous étions les vainqueurs », affirma Trotsky au sujet des élections au Soviet de Petrograd. Cette victoire fut décisive, et représenta un tremplin important vers la victoire d’Octobre.
Lénine, qui se cachait en Finlande, devenait de plus en plus impatient à l’égard des dirigeants bolcheviques. Il craignait que les dirigeants fussent en train de tergiverser. « Les événements nous prescrivent si clairement notre tâche que tout atermoiement devient positivement un crime », expliquait Lénine dans une lettre au Comité central. « Attendre est un crime envers la révolution. » En octobre, le Comité central prit la décision de prendre le pouvoir. Zinoviev et Kamenev votèrent contre et émirent une déclaration publique qui faisait état de leur opposition à toute insurrection et qui enjoignait le parti à se tourner vers l’Assemblée constituante !
Trotsky, en tant que président du Comité militaire révolutionnaire du Soviet de Petrograd, réagit rapidement afin d’assurer un transfert du pouvoir sans heurt, le 25 octobre 1917. La révolution remporta la victoire sans effusion de sang et le jour suivant, le 26 octobre, ses résultats furent annoncés au Deuxième Congrès des Soviets de Russie. Cette fois, les bolcheviks comptaient sur 390 délégués sur un total de 650, soit une majorité claire. En guise de protestation, les mencheviks et les SR de droite claquèrent la porte. Lénine, s’adressant au Congrès, déclara devant les délégués triomphants : « Nous entreprendrons la construction de l’ordre socialiste. » Le Congrès entreprit de mettre sur pied un nouveau gouvernement soviétique avec Lénine à sa tête. Méprisés quelque quatre mois auparavant, les bolcheviks étaient maintenant acclamés par les travailleurs révolutionnaires.
En quelques jours, des décrets furent émis par le gouvernement de Lénine : une proposition de paix et d’abolition de la diplomatie secrète, la terre aux paysans, le droit des nations à l’autodétermination, le contrôle ouvrier et la révocabilité de tous les représentants, l’égalité des hommes et des femmes, et la séparation complète de l’Église et de l’État.
Lorsque le Troisième Congrès des Soviets de janvier 1918 proclama la fondation de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, des portions importantes de la Russie étaient toujours occupées par les Empires centraux, les nationalistes bourgeois et les généraux des Armées blanches.
Cinq jours après la révolution, le nouveau gouvernement fut attaqué par des forces cosaques dirigées par le général Krasnov. L’attaque fut repoussée et le général fut livré au gouvernement par ses propres hommes. Cependant, il fut relâché après avoir donné sa parole qu’il ne reprendrait pas les armes. Sans surprise, il brisa cette promesse et se dirigea vers le sud afin de diriger l’Armée blanche cosaque. De manière similaire, une fois libérés du Palais d’Hiver, les militaires cadets organisèrent un soulèvement.
L’an I
La révolution était beaucoup trop généreuse et confiante à ses débuts. « On nous reproche de pratiquer la terreur, mais ce n'est pas la terreur des révolutionnaires français qui guillotinaient des gens désarmés, et j'espère que nous n'irons pas jusque-là », affirma Lénine en novembre. « Je l'espère parce que nous sommes forts. Quand nous appréhendions des gens, nous leur disions qu'ils seraient relâchés s'ils s'engageaient à ne pas saboter. Et l'on prend de tels engagements. »
Cette candeur a été reconnue par Victor Serge, un ancien anarchiste devenu bolchevik, qui écrivit dans son livre L’an I de la révolution russe :
« Les Blancs massacrent les travailleurs de l’Arsenal et du Kremlin : les Rouges libèrent leur ennemi mortel, le général Krasnov, sur parole […]. La révolution a fait l’erreur de se montrer magnanime avec le leader de l’agression cosaque. Il aurait dû être fusillé sur-le-champ. [Au lieu de cela] il put se rendre dans la région du Don et la mettre à feu et à sang. »
Le pouvoir soviétique eut à peine le temps de s’établir que les impérialistes se mirent en marche pour écraser la révolution dans le sang. En mars 1918, Lénine fit déplacer le gouvernement à Moscou puisque Petrograd était devenue vulnérable à une agression allemande.
Peu après, des troupes britanniques atterrirent à Mourmansk accompagnées de forces américaines et canadiennes ; les Japonais posèrent le pied à Vladivostok avec des bataillons britanniques et américains. Les Britanniques saisirent également le port de Bakou afin de mettre la main sur le pétrole. Les forces françaises, grecques et polonaises atterrirent dans les ports d’Odessa et Sébastopol, dans la Mer noire, et se lièrent aux Armées blanches. L’Ukraine fut occupée par les Allemands. Au total, ce sont 21 armées étrangères qui sont intervenues sur différents fronts pour affronter les forces du gouvernement soviétique. La révolution luttait pour sa survie. Elle était cernée, affamée et infestée de conspirateurs.
La Terreur blanche
La direction du parti SR approuvait le principe d’intervention étrangère afin de « restaurer la démocratie ». Les mencheviks tenaient une position contre-révolutionnaire similaire, ce qui les plaçait dans le camp ennemi. Ils collaborèrent avec les Blancs et acceptèrent de l’argent du gouvernement français afin de mener leurs activités.
À l’été 1918, il y eut des tentatives d’assassinat sur Lénine et Trotsky. Le 30 août, on tira sur Lénine, mais il réussit à échapper à la mort. Le même jour, Ouritsky fut assassiné, tout comme l’ambassadeur allemand. Volodarsky fut également tué. Le complot destiné à faire sauter le train de Trotsky fut heureusement déjoué. C’est cette Terreur blanche qui contribua au déclenchement de la Terreur rouge pour défendre la révolution.
La Terreur blanche a été minimisée par les capitalistes, qui mettaient le blâme sur les Rouges. Les atrocités des Blancs « étaient généralement l’œuvre de généraux blancs et de seigneurs de guerre individuels, et n’étaient pas systématiques ou n’entraient pas dans le cadre d’une politique officielle », explique Anthony Read afin d’excuser ces atrocités. « Mais elles égalaient et parfois surpassaient celles de la Terreur rouge. » Dans les faits, en tant que stratégie, la Terreur blanche surpassait toujours la Terreur rouge en termes de brutalité, ce qui est dans la nature des forces contre-révolutionnaires.
De manière intéressante, Read poursuit en décrivant les méthodes du baron Roman Von Ungern-Sternberg. « Aucun bolchevik, par exemple, n’aurait pu égaler le baron Roman Von Ungern-Sternberg, général blanc germano-balte né en Estonie, qui fut envoyé par le Gouvernement provisoire en Extrême-Orient russe, où il proclama être la réincarnation de Gengis Khan et fit tout ce qu’il put pour surpasser le conquérant mongol en termes de brutalité. Antisémite fanatique, il déclara en 1918 qu’il avait l’intention d’exterminer tous les Juifs et les Commissaires de Russie, une tâche dont il s’acquitta avec un grand enthousiasme. Il encourageait ses hommes à massacrer tous les Juifs se trouvant sur leur passage en utilisant diverses méthodes toutes aussi brutales les unes que les autres, comme de les écorcher vifs. Il est aussi reconnu pour avoir mené des chevauchées de terreur nocturne en traînant des torches humaines à cheval au galop à travers la steppe, et pour avoir promis de ‘‘faire une avenue de pendus s’étirant de l’Asie jusqu’à l’Europe’’. »
C’était là le sort qui attendait les travailleurs et les paysans russes si la contre-révolution avait remporté la victoire. C’est ce qui est arrivé à Spartacus et son armée d’esclaves lorsqu’ils sont tombés aux mains de l’État esclavagiste romain. L’alternative au pouvoir soviétique n’était pas la « démocratie », mais la brutale et sanguinaire barbarie fasciste. C’est pourquoi tous les efforts de l’Armée rouge et de la Tcheka furent déployés afin de remporter la guerre civile et défaire la contre-révolution.
Le gouvernement soviétique n’avait d’autre choix que de combattre le feu par le feu, et de lancer un appel révolutionnaire aux troupes des armées étrangères. Comme l’expliqua Victor Serge :
« Les masses laborieuses utilisent la terreur contre les classes minoritaires de la société. Elles ne font que terminer le travail des forces politiques et économiques nouvelles. Lorsque des mesures progressistes rallient des millions de travailleurs à la cause de la révolution, la résistance des minorités privilégiées n’est pas difficile à briser. La Terreur blanche, en revanche, est réalisée par ces minorités privilégiées contre les masses laborieuses, lesquelles doivent être massacrées, décimées. Les Versaillais (le nom donné aux forces contre-révolutionnaires ayant écrasé la Commune de Paris) ont tué en une seule semaine à Paris plus de personnes que la Tcheka en trois ans dans toute la Russie. »
Une période de « communisme de guerre » fut imposée aux bolcheviks, une période où le grain était réquisitionné de force aux paysans afin de nourrir les travailleurs et les soldats. L’industrie, ravagée par le sabotage, la Guerre mondiale et la guerre civile, était dans un état d’effondrement complet. Le blocus impérialiste paralysait tout le pays. La population de Petrograd tomba de 2 400 000 habitants en 1917 à 574 000 en août 1920. La typhoïde et le choléra tuèrent des millions de personnes. Lénine qualifia cette situation de « communisme dans une forteresse assiégée ».
Le 24 août 1919, Lénine écrivait : « l’industrie est au point mort. Il n’y a pas de nourriture, pas de pétrole, pas d’industrie. » Face au désastre, les soviets ont dû compter sur les sacrifices, le courage et la volonté de la classe ouvrière pour sauver la révolution. En mars 1920, Lénine affirmait que « la détermination de la classe ouvrière, son adhérence inflexible au mot d’ordre ‘‘plutôt mourir que capituler !’’ n’est pas qu’un facteur historique, il est le facteur décisif de la réussite ».
Les conséquences de la guerre civile
Sous la direction de Lénine et de Trotsky, qui avait organisé l’Armée rouge à partir de rien, les soviets remportèrent la victoire, mais au prix de très lourds sacrifices. Les pertes humaines au front, la famine, les maladies, tous ces facteurs s’ajoutèrent à l’effondrement économique.
À la fin de la guerre civile, le gouvernement bolchevique fut forcé de faire un pas en arrière et d’introduire la Nouvelle politique économique (NEP). Elle permettait aux paysans de disposer de leurs surplus de grains sur le libre marché et contribua à la croissance de fortes tendances capitalistes, à travers l’émergence des Nepmen et des koulaks. C’était seulement un moment de répit.
Considérant le bas niveau culturel – 70% de la population était analphabète – le régime soviétique devait s’appuyer sur les anciens officiers, fonctionnaires et administrateurs tsaristes, qui étaient opposés à la révolution. « Si l’on gratte n’importe où la surface de l’État soviétique, l’on trouvera partout le vieil appareil d’État tsariste en dessous », affirma sans détour Lénine. Avec l’isolement continu de la révolution, il s’agissait là d’un grand danger d’une dégénérescence bureaucratique de la révolution. La classe ouvrière était systématiquement affaiblie par la crise. Les soviets cessèrent simplement de fonctionner et, dans cette situation, les carriéristes et les bureaucrates remplirent le vide.
Malgré des mesures mises en place pour combattre la menace bureaucratique, la seule planche de salut pour la révolution résidait dans la victoire de la révolution mondiale qui aurait permis une assistance matérielle de l’Occident.
Au début de 1919, Lénine avait fondé la IIIe Internationale comme outil afin de répandre la révolution à l’international. C’était l’école du bolchevisme. Des partis communistes de masse furent établis en Allemagne, en France, en Italie, en Tchécoslovaquie et dans d’autres pays.
Malheureusement, la vague révolutionnaire ayant suivi la Première Guerre mondiale fut vaincue. La révolution en Allemagne en 1918 fut trahie par les sociaux-démocrates. Les jeunes républiques soviétiques en Bavière et en Hongrie furent écrasées dans le sang par la contre-révolution. La vague révolutionnaire d’occupations d’usines en Italie en 1920 avait également été vaincue. Encore une fois, en 1923, tous les yeux étaient rivés sur l’Allemagne, qui était au beau milieu d’une crise révolutionnaire. Cependant, les mauvais conseils fournis par Zinoviev et Staline menèrent à une défaite tragique.
Cela porta un coup terrible au moral des travailleurs russes, qui avaient tenu bon jusque-là. En même temps, la défaite renforça la réaction bureaucratique dans l’État et le Parti. Une fois Lénine réduit à l’impuissance après une série d’attaques cérébrales, Staline émergea progressivement comme figure de proue de la bureaucratie. En fait, le dernier combat de Lénine fut mené en bloc avec Trotsky contre Staline et la bureaucratie. Staline battit en retraite, mais une nouvelle attaque cérébrale laissa Lénine paralysé et muet.
Juste avant cette attaque, Lénine avait écrit un testament. Dans ce document, il affirme que Staline, « devenu secrétaire général [ce à quoi Lénine s’opposait – RS], a concentré entre ses mains un pouvoir illimité, et je ne suis pas sûr qu'il puisse toujours s'en servir avec assez de circonspection. D'autre part, le camarade Trotsky […] ne se fait pas remarquer seulement par des capacités éminentes. Il est peut-être l'homme le plus capable de l'actuel Comité central ». Lénine mit en garde contre le danger d’une scission dans le parti.
Le stalinisme
Deux semaines plus tard, Lénine ajouta un complément à son testament après que Staline eut grossièrement invectivé et harcelé Kroupskaïa pour avoir aidé Trotsky et d’autres à communiquer avec Lénine. Lénine rompit toutes relations personnelles avec Staline. « Staline est trop brutal, et ce défaut parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, communistes, ne l'est plus dans les fonctions de secrétaire général », affirma-t-il. Il demanda instamment que Staline soit démis de ses fonctions à cause de sa déloyauté et de sa tendance à abuser du pouvoir.
Mais le 7 mars 1923, Lénine subit une autre attaque cérébrale qui le rendit totalement invalide. Il allait demeurer dans cet état jusqu’à sa mort, le 21 janvier 1924. Le retrait de Lénine de la vie politique donna à Staline un pouvoir accru, qu’il utilisa à son plein avantage, en particulier pour supprimer le testament de Lénine.
C’est sur les épaules de Trotsky que reposait alors la tâche de défendre l’héritage de Lénine, que Staline était en train de trahir. La victoire du stalinisme est essentiellement due à des facteurs objectifs, avant tout l’effroyable arriération économique et sociale de la Russie, ainsi que son isolement.
La défaite ultérieure de la révolution mondiale en Grande-Bretagne, et particulièrement en Chine, eut pour conséquence de démoraliser davantage les travailleurs russes, épuisés par des années de luttes. Sur la base de cette terrible fatigue, la bureaucratie, menée par Staline, consolida son emprise. Le corps de Lénine, malgré les protestations de sa veuve, fut placé dans un mausolée.
C’est un mensonge monstrueux que de laisser entendre que le stalinisme est le prolongement du régime démocratique de Lénine, comme le disent les apologistes du capitalisme. En réalité, une rivière de sang sépare les deux. Lénine fut l’initiateur de la révolution d’Octobre ; Staline en fut le fossoyeur. Tous deux n’avaient rien de commun.
Nous terminerons cet hommage avec les justes paroles de Rosa Luxemburg :
« Tout ce qu'un parti peut apporter, en un moment historique, en fait de courage, d'énergie, de compréhension révolutionnaire et de conséquence, les Lénine, Trotsky et leurs camarades l'ont réalisé pleinement. L'honneur et la capacité d'action révolutionnaire, qui ont fait à tel point défaut à la social-démocratie, c'est chez eux qu'on les a trouvés. En ce sens, leur insurrection d'Octobre n'a pas sauvé seulement la révolution russe, mais aussi l'honneur du socialisme international. »
90 ans après sa mort, nous rendons hommage à ce grand homme, à ses idées et son courage. Lénine combinait la théorie avec l’action et personnifiait la révolution d’Octobre. Lénine et les bolcheviks ont changé le monde ; notre tâche, en cette époque de crise du capitalisme, est de terminer le travail.
- Détails
- Révolution
Dans les années précédant la révolution de 1917, la question de la nature de la future révolution russe était vivement débattue au sein du Parti social-démocrate russe (POSDR). Les divergences portaient sur le rôle que la classe ouvrière serait appelée à jouer. La théorie de « la révolution permanente », élaborée par Léon Trotsky dès 1904, était une anticipation brillante du processus réel qui s’est déroulé en Russie – d’abord lors de la révolution de 1905, puis surtout lors de la révolution de 1917. Depuis, cette théorie est l’une des pierres angulaires du marxisme.
La théorie des étapes
Le cours général de l’histoire de la plupart des pays capitalistes industrialisés nous permet de diviser leur évolution en un certain nombre d’étapes historiques successives. La classe capitaliste a pris forme graduellement, dans le cadre du système féodal, jusqu’au stade où elle ne pouvait plus progresser sans détruire l’ordre féodal lui-même. C’est ce qui a déterminé la longue série de révolutions bourgeoises qui se sont déroulées, en Europe, entre le XVIIe et le XIXe siècle.
Ces révolutions répondaient au besoin de « libérer » la main-d’œuvre rurale du servage pour la mettre à la disposition de la classe capitaliste, sous la forme de travailleurs salariés – et de créer, à la place des économies locales et fragmentées de l’Ancien régime, des Etats et des marchés véritablement nationaux, dotés de lois conformes aux intérêts de la classe capitaliste, ainsi que de monnaies et de langues communes. Telles étaient les tâches fondamentales des révolutions bourgeoises qui se sont déroulées en Grande-Bretagne en 1642-1651 et, en Europe continentale, entre le début de la Révolution française (1789) et la fin du XIXe siècle.
Au début du XXe siècle, la quasi-totalité des dirigeants de l’Internationale Socialiste considérait que la Russie – et, en général, les pays tardivement industrialisés – devait suivre une évolution semblable aux pays européens, avec un train de retard. La Russie, pensaient-ils, se dirigeait vers une révolution bourgeoise « classique », qui transférerait le pouvoir entre les mains de la bourgeoisie. Selon ce schéma, la classe ouvrière russe ne pourrait envisager de conquérir le pouvoir que plusieurs décennies plus tard, lorsque les rapports de production capitalistes et la démocratie bourgeoise se seraient pleinement développés.
La position de Trotsky
Le jeune Trotsky rejetait ce point de vue. Procédant d’une analyse des rapports entre les classes sociales, il soutenait qu’au lieu de suivre le schéma classique qu’avaient connu la Grande-Bretagne ou la France, la Russie évoluait d’une façon particulière. Le rôle de l’impérialisme interdisait à un pays comme la Russie de suivre, étape par étape, l’évolution qu’avait connue l’Europe occidentale. En effet, dans sa quête de nouveaux marchés, le capitalisme des pays les plus avancés s’installait dans les pays moins développés, comme la Russie. Ce faisant, il modifiait profondément la structure de classe de ces sociétés.
A ce propos, Trotsky écrivait : « L’évolution de la Russie se caractérise avant tout par son retard. Un retard historique ne signifie pas, pourtant, une simple répétition de l’évolution des pays avancés, avec un délai de cent ou deux cents ans, mais engendre une formation sociale tout à fait nouvelle, “combinée”, dans laquelle les dernières conquêtes de la technique et de la structure capitalistes s’implantent dans les rapports sociaux de la barbarie féodale et pré-féodale, les transforment et se les subordonnent, créant ainsi une relation originale entre les classes. Il en va de même dans le domaine des idées. Précisément par suite de son retard historique, la Russie se trouva être le seul pays européen où le marxisme, en tant que doctrine, et la social-démocratie, en tant que parti, aient pris un grand développement avant la révolution bourgeoise. Il est naturel aussi que ce soit en Russie que le problème des rapports entre la lutte pour la démocratie et la lutte pour le socialisme ait subi l’élaboration théorique la plus approfondie. » [1]
En Russie, les formes de production les plus modernes – grandes usines, technologie industrielle, etc. – ont été introduites de l’extérieur par le capitalisme étranger et se sont greffées sur les formes de production pré-capitalistes. A côté des rapports sociaux primitifs et féodaux, une classe capitaliste et un salariat modernes émergeaient, comme ceux qui existaient dans les pays industrialisés d’Europe occidentale. Cependant, la bourgeoisie nationale était beaucoup trop faible pour prétendre jouer un rôle indépendant. Elle craignait la révolution qu’elle sentait venir. Après la frayeur que lui avait causée la révolution de 1905, elle se jeta dans les bras du régime tsariste, dans l’espoir de prévenir une nouvelle révolution. Les capitalistes russes devaient faire face à l’émergence du mouvement ouvrier non pas après, mais avant l’accomplissement de la révolution bourgeoise. Alors qu’en Grande-Bretagne, plus de deux siècles séparaient la révolution bourgeoise et la possibilité d’une révolution socialiste, les deux révolutions étaient inextricablement mêlées en Russie.
La théorie de la révolution permanente était une perspective, une tentative de prévoir, dans ses grandes lignes, le développement de la révolution russe. Même si on admettait que les tâches révolutionnaires qui se posaient, en Russie, étaient celles de la révolution bourgeoise, la bourgeoisie était trop faible pour les accomplir. En conséquence, il n’y avait qu’une seule classe qui, en s’emparant du pouvoir, serait capable de supprimer les vestiges du système féodal, de rendre la terre aux paysans, de libérer le pays de l’impérialisme et de mettre fin à l’oppression nationale : c’était la classe du salariat urbain, en alliance avec la paysannerie pauvre.
Une fois au pouvoir, expliquait Trotsky, le salariat ne saurait se limiter à des mesures dans le cadre du capitalisme, mais prendrait des mesures de type socialiste, telles que l’expropriation des capitalistes étrangers et nationaux. Par ailleurs, dans les limites d’un seul pays, le nouveau pouvoir ne pourra pas résoudre les problèmes auxquels il se trouvera confronté. La révolution devra nécessairement se développer au-delà des frontières nationales, et notamment dans les pays les plus industrialisés. La révolution commence dans le cadre d’un seul pays, mais ne peut aboutir qu’en devenant internationale. D’où la « permanence » de la révolution.
La position de Lénine
 Comme Trotsky, Lénine insistait sur le caractère contre-révolutionnaire de la bourgeoisie russe. Par contre, les mencheviks – la tendance réformiste du POSDR – justifiaient leur soutien à la bourgeoisie libérale par la « théorie des étapes ». Puisque la révolution à venir est de type bourgeois, disaient-ils, elle doit être dirigée par les capitalistes libéraux. Le socialisme n’est pas à l’ordre du jour. La classe ouvrière doit accepter de subordonner ses revendications aux intérêts de la bourgeoisie libérale. Une lutte pour le socialisme ne peut qu’effrayer les capitalistes et les pousser dans le camp de la contre-révolution, disaient les mencheviks.
Comme Trotsky, Lénine insistait sur le caractère contre-révolutionnaire de la bourgeoisie russe. Par contre, les mencheviks – la tendance réformiste du POSDR – justifiaient leur soutien à la bourgeoisie libérale par la « théorie des étapes ». Puisque la révolution à venir est de type bourgeois, disaient-ils, elle doit être dirigée par les capitalistes libéraux. Le socialisme n’est pas à l’ordre du jour. La classe ouvrière doit accepter de subordonner ses revendications aux intérêts de la bourgeoisie libérale. Une lutte pour le socialisme ne peut qu’effrayer les capitalistes et les pousser dans le camp de la contre-révolution, disaient les mencheviks.
Lénine et Trotsky rejetaient catégoriquement cette analyse. Ils refusaient la dilution du programme du parti ouvrier au nom d’une alliance avec la bourgeoisie libérale. Cependant, jusqu’en 1917, Lénine pensait que l’avènement d’un gouvernement ouvrier, en Russie, était impossible sans la victoire préalable des travailleurs dans un ou plusieurs des pays d’Europe occidentale. Les événements de 1917 ont modifié ses idées sur cette question. Son ralliement à la théorie de la révolution permanente a trouvé son expression dans ses célèbres Thèses d’avril. Ecrites dans le feu de la révolution de 1917, les Thèses d’avril fixaient le cap vers la conquête du pouvoir par la classe ouvrière, avec comme mot d’ordre central : « Tout le pouvoir aux Soviets ! »
Les Soviets, dans lesquels les bolcheviks sont devenus majoritaires, en septembre 1917, ont pris le pouvoir le mois suivant. L’Etat soviétique a supprimé tous les titres et privilèges de l’aristocratie, exproprié les grands propriétaires terriens et rendu la terre aux paysans. Il a lutté pour en finir avec l’oppression des minorités nationales. Il a socialisé l’industrie, en la plaçant sous le contrôle direct des travailleurs. Il a vaincu l’offensive armée – intérieure et impérialiste – qui visait à restaurer la monarchie en Russie. Il a réclamé la fin immédiate et sans annexions de la guerre mondiale. Il a publié les traités secrets signés entre l’ancien régime et ses alliés, pour montrer aux travailleurs du monde entier quels étaient les véritables enjeux de la guerre impérialiste.
En même temps, Lénine et Trotsky ne se faisaient aucune illusion quant à la possibilité de construire le socialisme dans un pays sous-développé et isolé. Ils ont fait immédiatement appel aux travailleurs de tous les pays pour qu’ils suivent l’exemple des travailleurs russes et renversent le capitalisme dans leurs pays respectifs. Les dirigeants du gouvernement révolutionnaire savaient que sans une extension de la révolution, la démocratie soviétique ne survivrait pas. En 1919, la IIIe Internationale a été fondée. Le nom de la nouvelle Internationale était très significatif : « Internationale Communiste, parti de la révolution mondiale ».
L’émergence du stalinisme
Le cours ultérieur des événements a confirmé – négativement – le bien-fondé de la perspective internationaliste de Lénine et de Trotsky. L’échec de la révolution en Europe a scellé le sort du pouvoir ouvrier en Russie. Après les défaites des révolutions allemande (1918-23) et chinoise (1924-27), entre autres, l’isolement de la révolution russe a mené à l’épuisement des forces sociales qui l’avaient accomplie. Le pays était dévasté par les conséquences de la guerre mondiale, de la guerre civile, des guerres d’intervention étrangère et du blocus économique. La réaction qui en résultait s’est traduite par l’ascension politique d’une caste bureaucratique et par le démantèlement progressif de la démocratie soviétique. La théorie du « socialisme dans un seul pays », adoptée par Staline, était l’expression des intérêts particuliers de cette caste, qui ne s’intéressait plus à la victoire du socialisme à l’étranger, mais seulement à la consolidation et à l’extension de ses privilèges et de son pouvoir.
- Détails
- Francesco Giliani
Le destin posthume du dirigeant communiste Antonio Gramsci (1891-1937) est un cas flagrant d’embaumement de la pensée politique d’un marxiste révolutionnaire. Très rares sont ceux qui le critiquent, y compris parmi les réformistes les plus acharnés. En Italie, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la bureaucratie stalinienne du Parti Communiste Italien (PCI) a utilisé Gramsci pour justifier chaque tournant à droite de sa politique, y compris le « Compromis historique », c’est-à-dire l’alliance du PCI avec la Démocratie Chrétienne, prônée à l’apogée de la lutte des classes des années 1970.
Plus récemment, la déformation du concept gramscien d’« hégémonie » a permis aux politologues Ernesto Laclau et Chantal Mouffe de théoriser leur « populisme de gauche » – qui est embrassé, entre autres, par des dirigeants de Podemos (en Espagne) et de la France insoumise.
Le débat autour des Cahiers de Prison de Gramsci est la clé pour comprendre qu’il n’ait jamais été renié par des intellectuels de gauche qui, dans le même temps, ne cessent d’attaquer le marxisme révolutionnaire (et en particulier Lénine). Mais avant d’aborder cette question, il est nécessaire de retracer la trajectoire de Gramsci avant son emprisonnement par le régime fasciste de Mussolini, en 1926. Les « gramsciens » d’aujourd’hui se gardent bien de le faire.
L’Ordre Nouveau et la naissance du PCdI
Etudiant en Lettres à Turin, Gramsci adhère en 1913 au Parti Socialiste Italien (PSI). Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le PSI ne sombre pas dans l’Union Sacrée, bien que sa stratégie – « ni adhérer » à la guerre, « ni la saboter » – soit vacillante, en quête d’un moyen terme entre les réformistes et les révolutionnaires.
La révolution d’Octobre 1917 et la fin de la guerre débouchent, en Italie, sur une vague de grèves et d’occupation de terres et d’usines. C’est le Biennio Rosso de 1919-20. Le PSI décuple ses effectifs militants. Le syndicat socialiste, la CGIL, atteint les deux millions de membres.
Gramsci et son groupe de Turin sont au cœur de la bataille. Ils publient l’hebdomadaire L’Ordine Nuovo (ON). Ce journal traduit dans la situation italienne le mot d’ordre « Tout le pouvoir aux Soviets », qui avait couronné la stratégie bolchevique en Russie. En septembre 1920, les militants de l’ON défendent et organisent l’occupation des usines, dont celles de la FIAT, qui dure trois semaines. Ils deviennent aussi les théoriciens de la gestion ouvrière : d’après Gramsci, les conseils d’usine, surgis spontanément des luttes, doivent se coordonner et devenir les organes du pouvoir ouvrier, aussi bien dans le contrôle de la production que dans l’organisation de la nouvelle société.
Gramsci conditionne la victoire du processus révolutionnaire à la réalisation de deux tâches : 1) le développement d’organes de lutte qui concentrent la masse des travailleurs ; 2) la formation, au sein du PSI, d’une direction communiste qui rompe avec toutes les tendances réformistes et « centristes » (oscillant entre réformisme et révolution). En janvier 1921, Gramsci et son groupe participent activement à la scission du PSI, qui donne naissance au Parti Communiste d’Italie (PCdI). 58 000 militants du PSI et la totalité de sa jeunesse adhèrent au nouveau parti, reconnu comme section officielle par l’Internationale Communiste (IC).
La même année 1921, dans son rapport sur la situation mondiale au IIIe Congrès de l’IC, Léon Trotsky trace la perspective d’une phase temporaire de reflux de la vague révolutionnaire et souligne la nécessité de conquérir la majorité des travailleurs, avant tout grâce à la tactique du « front unique ». Il s’agit de combiner la propagande communiste générale et l’unité d’action avec les organisations réformistes, sur des objectifs partiels (contre le chômage et la vie chère, etc.). L’IC explique que le front unique est indispensable face aux assauts armés des fascistes contre les organisations ouvrières (syndicats, coopératives, partis, municipalités socialistes). Mais le PCdI refuse d’appliquer cette politique, sous l’influence de son fondateur, Amadeo Bordiga.
Force et limites du Congrès de Lyon
Entre 1922 et 1924, Gramsci est envoyé à l’étranger pour participer aux instances internationales de l’IC. A cette occasion, grâce à ses discussions avec les dirigeants de l’IC, dont Trotsky, il prend la mesure des erreurs ultra-gauchistes du PCdI (abstentionnisme électoral par principe, refus du front unique) et décide d’engager une lutte fractionnelle contre Bordiga. Cette lutte est couronnée d’un succès total au Congrès (clandestin) du PCdI à Lyon, en 1926.
Mais les années 1925 et 1926 sont aussi marquées par un développement de la bureaucratisation de l’IC, sous la houlette de Zinoviev. En URSS, la lutte fait rage entre l’opposition de gauche, dirigée par Trotsky, et la troïka Staline-Zinoviev-Kamenev. Dans le PCdI, la fraction majoritaire de Gramsci cherche d’abord à se tenir au-dessus de la mêlée. Mais Gramsci finit par accepter les thèses de la troïka, puis de Staline, à la fin de l’année 1926.
Ainsi, au Congrès de Lyon, la position de Gramsci l’emporte. Mais ses thèses politiques sont surtout le reflet de la phase révolutionnaire précédente de l’IC. Au fond, elles affirment que : a) la nature de la révolution à venir en Italie est socialiste, et ses forces motrices sont la classe ouvrière, les salariés agricoles et les paysans ; b) la transformation sociale est un processus qui nécessite une rupture révolutionnaire, donc une insurrection de masse préparée et organisée par le parti ; c) la défaite du Biennio Rosso avait pour cause l’absence d’un parti véritablement révolutionnaire ; d) le PCdI doit conquérir l’hégémonie parmi les exploités, y compris par une bataille tenace dans les organisations de masse pour des revendications immédiates.
La limite la plus importante du Congrès de Lyon reste que Gramsci y soutient la campagne internationale de « bolchevisation » du parti à la sauce Zinoviev, c’est-à-dire une lutte administrative menée contre le « fractionnisme », sanctions disciplinaires à l’appui. Gramsci a donc sa part de responsabilité dans la bureaucratisation du parti italien et de l’IC. Cependant, en octobre 1926, il s’oppose à la chasse aux sorcières contre Trotsky et Zinoviev (qui rallie temporairement l’opposition de gauche, en 1926).
Le casse-tête des Cahiers de prison
Elu député en 1924, Gramsci est emprisonné en novembre 1926. Pendant les dix années qui suivent, sa production est vaste, quoique fragmentaire. Publiés en 1948, les Cahiers de prison ont été écrits sous le contrôle strict de la censure fasciste. Cela explique pourquoi Gramsci utilise parfois un langage ambigu, plus sociologique que politique. Par exemple, le marxisme devient la « philosophie de la praxis ». On peut aisément comprendre la situation objective de Gramsci. Mais ses réflexions sur « l’hégémonie » ont été utilisées par les dirigeants du PCI et par une pléthore d’académiciens pour avancer l’idée que Gramsci aurait défendu une conception gradualiste de la conquête du pouvoir.
Tout d’abord, il faut relever que le concept d’hégémonie faisait partie du patrimoine théorique du marxisme russe depuis le début du siècle. Dans les thèses du IVe congrès de l’IC (1922), ce concept est élargi jusqu’à inclure la domination que la bourgeoisie exerce sur les travailleurs en régime capitaliste. Ce fut d’ailleurs le point de départ de la réflexion gramscienne. La question se liait à la nature de la révolution socialiste dans les pays capitalistes avancés, où la bourgeoisie était plus solide que celle, retardataire, de la Russie de 1917. Selon le passage le plus cité des Cahiers : « En Orient, l’Etat était tout, la société civile était primitive et sans forme ; en Occident, entre l’Etat et la société civile, il existait un juste rapport, et derrière la faiblesse de l’Etat on pouvait voir immédiatement la solide structure de la société civile. L’Etat était seulement une tranchée avancée derrière laquelle se trouvait une chaîne solide de fortifications et de casemates ». (Cahiers de prison, VII, § 16).
On pourrait souligner qu’en 1917, dans les villes industrielles de Russie, la société n’était pas « gélatineuse », comme Gramsci le suppose. Toujours est-il que ce passage des Cahiers est descriptif et ne contient nulle part l’idée que la révolution est impossible en Occident. Pourtant, c’est bel et bien ce qu’on a mis dans la bouche de Gramsci.
Gramsci affirme que, dans les pays capitalistes développés, le parti doit conquérir davantage de soutien que dans la Russie de 1917, puisque son ennemi de classe dispose d’un nombre plus important d’outils – y compris idéologiques – pour maintenir son consensus. En un sens, c’est vrai dans les régimes de démocratie parlementaire. Mais il ne faut pas oublier que consensus et coercition sont les deux facettes d’une même médaille. A chaque époque, les stratèges de la classe capitaliste cherchent à trouver le bon dosage entre les deux. Mais il n’en découle aucune remise en question de la théorie marxiste de l’Etat.
« Hégémonie culturelle » ?
Enfin, contrairement à une idée courante dans certains milieux de gauche, Gramsci n’a jamais été le partisan d’une lutte avant tout « culturelle », dans la perspective de transformer, de l’intérieur et sans rupture, le capitalisme. Cette perspective n’est pas celle de Gramsci, mais celle de politiciens et d’intellectuels qui s’efforcent de tirer Gramsci vers le réformisme. Chez eux, la lutte pour l’« hégémonie culturelle » se traduit par un renoncement à la théorie, au programme et au parti révolutionnaires, sous prétexte de mener un travail « culturel » en profondeur.
Des partisans de la lutte pour « l’hégémonie culturelle » soulignent qu’on ne peut pas renverser le capitalisme sans avoir gagné les masses à cet objectif. C’est l’évidence même. Simplement, la lutte pour gagner les masses n’est pas « une lutte pour le sens et pour la construction du récit quotidien de la société sur elle-même », comme l’écrit un « gramscien » contemporain [1]. C’est une lutte indissociable de la construction du parti révolutionnaire, de son enracinement dans la jeunesse, les entreprises, les syndicats et d’autres organisations de masse.
Gramsci est resté, jusqu’à la fin de sa vie, convaincu de la nécessité de la révolution et du parti, en Occident comme en Orient. Le pessimisme qui, parfois, ressort de certaines pages des Cahiers, ne fait pas et ne fera jamais de Gramsci la caution théorique d’une lutte purement « culturelle » contre le capitalisme.
[1] Lenny Benbara dans un article publié sur Le Vent Se Lève (lvsl.fr).
- Détails
- Fred Weston et Parson Young
Rosa Luxemburg fut une brillante militante et théoricienne du marxisme révolutionnaire. Elle a joué un rôle clé dans la lutte contre la dégénérescence opportuniste de la social-démocratie allemande [1], ainsi que dans la fondation du Parti Communiste allemand (KPD). Cependant, après son assassinat, certains de ses écrits ont été utilisés – par des adversaires du marxisme – pour donner une fausse interprétation de ses idées. Aujourd’hui encore, des réformistes, des anarchistes et des libéraux se revendiquent d’un « luxemburgisme » fictif, dont ils font une arme contre les idées et les méthodes du bolchevisme.
Spontanéité et direction
Ils prétendent notamment que Rosa Luxemburg aurait opposé la « spontanéité des masses » à la conception « léniniste » du parti révolutionnaire. Pour ce faire, ils commencent par caricaturer le parti bolchevik, qu’ils présentent comme un parti monolithique, sans démocratie interne, et qui cherchait à imposer sa volonté aux masses. En réalité, ce parti reposait sur une grande liberté de discussion, qui visait à trancher démocratiquement les questions de programme, de méthode et de tactique – et à construire un parti discipliné, capable de renverser le capitalisme. Quant à son attitude face aux mobilisations des masses, nous allons voir en quoi elle consistait réellement.
Quelles étaient les véritables positions de Rosa Luxemburg sur la « spontanéité » des masses – et sur le rapport entre l’activité des masses et celle du parti ? Sa brochure Grève de masse, parti et syndicat (1906) est souvent citée, à tort, comme une preuve de son opposition aux bolcheviks et de son rejet de la nécessité d’une direction révolutionnaire. A l’époque, une vague de grèves balayait l’Allemagne, dans le prolongement de la Révolution russe de 1905. Or, il y avait en Allemagne de puissants syndicats et un parti socialiste de masse, le SPD (ce qu’il n’y avait pas en Russie). Rosa Luxemburg et l’aile révolutionnaire du SPD soutenaient ces grèves et exigeaient que le parti y intervienne, mais les dirigeants opportunistes du parti adoptaient une attitude passive – voire méprisante – envers ce mouvement spontané, qu’ils jugeaient « prématuré ». Selon eux, seules les luttes planifiées par le parti avaient une chance de réussir ; les autres étaient « vouées à l’échec ».
Luxemburg polémiquait contre cette position des dirigeants du SPD, contre leur refus de mener une lutte révolutionnaire. Elle ne niait pas la nécessité d’une direction. Au contraire, elle insistait pour que le SPD joue un rôle politique dirigeant dans la vague de grèves. Comme elle l’écrivait : « Il est hors du pouvoir de la social-démocratie de déterminer à l’avance l’occasion et le moment où se déclencheront les grèves de masse en Allemagne, parce qu’il est hors de son pouvoir de faire naître des situations historiques au moyen de simples résolutions de congrès. Mais ce qui est en son pouvoir et ce qui est de son devoir, c’est de préciser l’orientation politique de ces luttes lorsqu’elles se produisent et de la traduire par une tactique résolue et conséquente. » [2]
Quant aux bolcheviks et à Lénine, ils partageaient cette position générale de Rosa Luxemburg. Lénine insistait régulièrement sur le fait que les révolutionnaires ne doivent pas lancer des ultimatums aux masses, mais gagner les masses lorsqu’elles se mettent en mouvement. Par exemple, c’est la stratégie qu’il développe dans ses Thèses d’avril, en 1917 : il faut « expliquer aux masses que les Soviets des députés ouvriers sont la seule forme possible de gouvernement révolutionnaire, et que, par conséquent, notre tâche, tant que ce gouvernement se laisse influencer par la bourgeoisie, ne peut être que d’expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement aux masses les erreurs de leur tactique, en partant essentiellement de leurs besoins pratiques. »
Ainsi, Luxemburg et Lénine étaient d’accord sur le fait que le rôle du parti n’est pas d’imposer un plan préétabli aux masses. Celles-ci se mettent en mouvement à leur propre rythme, et le rôle des révolutionnaires est d’intervenir dans ces mobilisations pour y apporter un programme et une direction, ce que Luxemburg désigne comme une « orientation politique ».
Certes, il y avait des différences entre les positions de Lénine et de Luxemburg. Mais ces différences ne portaient pas sur la nécessité, pour une révolution, de se doter d’une organisation et d’une direction. Dans son livre sur Rosa Luxemburg, notre camarade Marie Frederiksen explique : « Une divergence apparaît lors du congrès de 1907 du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (POSDR) (…) Luxemburg y critique les bolcheviks, qui auraient accordé trop d’importance aux aspects techniques de l’insurrection lors de la révolution de 1905. Selon elle, ils auraient dû se concentrer sur l’apport d’une direction politique au mouvement. (…) Sur la base de son expérience dans le SPD, Luxemburg considère l’insistance sur les aspects pratiques de l’organisation comme la marque d’une direction conservatrice, qui tend à freiner le mouvement des masses. (…) Elle en vient à considérer que les aspects techniques, pratiques, de l’organisation sont en eux-mêmes négatifs, et que le mouvement des masses réglera de lui-même les problèmes techniques de l’organisation et de la direction. » [3]
Il est clair que Luxemburg ne nie pas la nécessité d’une direction politique, pas plus que Lénine ne rejette la spontanéité des masses. Leur divergence porte sur l’importance que les révolutionnaires doivent accorder aux aspects pratiques de cette intervention politique dans les luttes de masse.
Sur cette question, l’histoire donna tort à Luxemburg. La révolution d’Octobre 1917 prouva que c’est précisément l’existence du parti bolchevik, avec ses cadres disciplinés, politiquement éduqués, attentifs aux questions « techniques » et « pratiques », qui a permis aux ouvriers russes de prendre le pouvoir. D’ailleurs, pendant la dernière période de sa vie, Rosa Luxemburg en est arrivée précisément à ces conclusions : elle s’est attelée à la construction d’un parti semblable au parti bolchevik, le KPD. En exagérant ses divergences avec Lénine sur cette question, les « héritiers » de Rosa Luxemburg veulent faire oublier les conclusions auxquelles elle est elle-même parvenue.
Bolchevisme et menchevisme
Selon une autre idée largement diffusée, Rosa Luxemburg se serait opposée aux « méthodes dictatoriales » du léninisme. Ce mythe s’appuie principalement sur l’un de ses écrits de 1904 : Questions d’organisation de la social-démocratie russe. Elle y critique Lénine et les bolcheviks ; elle leur reproche des tendances à « l’ultra-centralisme » et au « blanquisme », c’est-à-dire à l’idée qu’il serait possible d’organiser une révolution socialiste sous le contrôle total d’un petit groupe secret de dirigeants révolutionnaires.
Cette critique de Luxemburg reposait essentiellement sur des informations mensongères fournies par les mencheviks, ainsi que sur certaines formulations du livre de Lénine, Que faire ?, dont lui-même reconnut plus tard qu’elles étaient exagérées. D’ailleurs, l’hostilité de Luxemburg aux bolcheviks ne dura pas. Dès 1906, elle publia un article pour les défendre contre ces mêmes accusations de « blanquisme » – et pour critiquer l’opportunisme des mencheviks : « Si aujourd’hui les camarades bolcheviks parlent de dictature du prolétariat, ils ne lui ont jamais donné l’ancienne signification blanquiste (...). Au contraire, ils ont affirmé que l’actuelle révolution peut trouver son terme quand le prolétariat, toute la classe révolutionnaire, se sera emparée de la machine d’Etat. (...) Aujourd’hui, il s’agit de savoir si c’est, à l’heure actuelle, la tactique que recommandent le camarade Plekhanov et avec lui les camarades mencheviks qui est juste, une tactique qui vise à travailler le plus possible avec la Douma, avec les éléments qui y sont représentés, ou au contraire la tactique que nous appliquons tout comme les camarades bolcheviks, une tactique qui s’appuie sur le principe que le centre de gravité est situé en dehors de la Douma, dans l’apparition active des masses populaires révolutionnaires. » [4]
Un an plus tard, dans un discours qu’elle prononce lors du cinquième Congrès du POSDR, auquel participent les bolcheviks et les mencheviks, elle défend à nouveau les bolcheviks, cette fois-ci contre des accusations de « rigidité » et d’« étroitesse » sur les questions d’organisation : « (...) ces caractéristiques désagréables (...) représentent la mentalité typique de ce courant du socialisme qui est contraint de défendre les principes fondamentaux de l’indépendance politique du prolétariat face à un courant hostile, lui aussi puissant. La rigidité est la forme que prend nécessairement une aile de la tactique social-démocrate lorsque l’autre aile est une gelée informe qui rampe dans toutes les directions sous la pression des événements. » [5]
Contrairement à ce qu’affirment aujourd’hui ses prétendus « héritiers », Luxemburg se tenait fermement aux côtés des bolcheviks dans la lutte pour la défense de « l’indépendance politique du prolétariat » – contre le réformisme et l’opportunisme des mencheviks.
La Révolution russe
Un autre texte de Rosa Luxemburg est souvent cité pour appuyer l’idée qu’elle était hostile à la révolution d’Octobre et aux bolcheviks. Il s’agit de La Révolution russe, rédigé en 1918. Le fait est qu’elle y formule plusieurs critiques sévères de l’action des bolcheviks pendant la révolution de 1917. Mais ceux qui mobilisent ce texte contre le bolchevisme « oublient » – une fois de plus – de le replacer dans son contexte. Luxemburg a écrit ce texte lorsqu’elle était en prison, et n’avait accès qu’à des informations très parcellaires sur la situation en Russie.
Lorsqu’elle fut libérée de prison par la Révolution allemande de novembre 1918, elle refusa de publier ce document, précisément parce qu’elle le jugeait erroné sur plusieurs points. Ce texte fut malgré tout publié, plusieurs années après sa mort, à l’initiative de Paul Levi, qui était son ancien avocat. Paul Levi venait d’être exclu de l’Internationale Communiste pour en avoir sévèrement violé la discipline. En publiant ce texte de Luxemburg, il cherchait à justifier son ralliement au réformisme social-démocrate.
En outre, ce texte de Luxemburg était une critique constructive, « entre camarades ». Par-delà ses critiques, Luxemburg y affirme son soutien à la révolution d’Octobre et aux bolcheviks. Elle écrit notamment : « Tout ce qu’un parti peut apporter, en un moment historique, en fait de courage, d’énergie, de compréhension révolutionnaire et de conséquence, les Lénine, Trotsky et leurs camarades l’ont réalisé pleinement. L’honneur et la capacité d’action révolutionnaire, qui ont fait à tel point défaut à la social-démocratie, c’est chez eux qu’on les a trouvés. En ce sens, leur insurrection d’Octobre n’a pas sauvé seulement la révolution russe, mais aussi l’honneur du socialisme international. »
Enfin, Rosa Luxemburg était consciente du fait que les défaillances du régime soviétique russe n’étaient pas le fruit des idées ou de la volonté de Lénine et Trotsky, mais la conséquence de l’isolement de la révolution russe. C’est ce qu’elle affirme explicitement dans ce texte : « Tout ce qui se passe en Russie s’explique parfaitement : c’est une chaîne inévitable de causes et d’effets dont les points de départ et d’arrivée sont la carence du prolétariat allemand et l’occupation de la Russie par l’impérialisme allemand. Ce serait exiger de Lénine et de ses amis une chose surhumaine que de leur demander encore, dans des conditions pareilles, de créer, par une sorte de magie, la plus belle des démocraties, la dictature du prolétariat la plus exemplaire et une économie socialiste florissante. Par leur attitude résolument révolutionnaire, leur énergie sans exemple et leur fidélité inébranlable au socialisme international, ils ont vraiment fait tout ce qu’il était possible de faire dans des conditions si terriblement difficiles. »
Quant à ses propres critiques, elle en relativise elle-même l’importance pour se placer, encore une fois, aux côtés des bolcheviks, contre les réformistes qui les attaquent : « Ce qui importe, c’est de distinguer dans la politique des bolcheviks l’essentiel de l’accessoire, la substance de l’accident. Aujourd’hui, alors que nous sommes à la veille des luttes décisives dans le monde entier, le problème le plus important du socialisme est précisément la question brûlante du moment : non pas telle ou telle question de détail de la tactique, mais la capacité d’action du prolétariat, la combativité des masses, la volonté de réaliser le socialisme. Sous ce rapport, Lénine, Trotsky et leurs amis ont été les premiers qui aient montré l’exemple au prolétariat mondial ; ils sont jusqu’ici encore les seuls qui puissent s’écrier avec Hutten : “J’ai osé !”
« C’est là ce qui est essentiel, ce qui est durable dans la politique des bolcheviks. En ce sens, il leur reste le mérite impérissable d’avoir, en conquérant le pouvoir et en posant pratiquement le problème de la réalisation du socialisme, montré l’exemple au prolétariat international, et fait faire un pas énorme dans la voie du règlement de comptes final entre le Capital et le Travail dans le monde entier. En Russie, le problème ne pouvait être que posé. Et c’est dans ce sens que l’avenir appartient partout au “bolchevisme”. »
L’Assemblée constituante
Dans le même texte de 1918 (La Révolution russe), Rosa Luxemburg critique la dissolution de l’Assemblée constituante russe par les bolcheviks, en janvier 1918. Pour les « disciples » de Luxemburg, c’est l’occasion de rallier le chœur de tous ceux – réformistes, libéraux, etc. – qui s’appuient sur cette dissolution pour accuser les bolcheviks d’avoir été des « ennemis de la démocratie ».
Cependant, il faut commencer par rappeler que, jusqu’en 1917, les bolcheviks ont soutenu la revendication d’une Assemblée constituante, c’est-à-dire d’un parlement bourgeois, car avant la Révolution russe, un tel parlement aurait marqué un énorme progrès par rapport au despotisme tsariste. Mais lorsqu’elle fut dissoute (après la révolution d’Octobre), l’Assemblée constituante ne représentait plus les masses de Russie, qui s’étaient déjà dotées d’une forme supérieure de gouvernement : les soviets. Placée sous le contrôle permanent des masses, la démocratie ouvrière des soviets était infiniment plus démocratique que le plus démocratique des parlements bourgeois – en particulier dans une époque révolutionnaire, lorsque l’opinion des masses évolue très rapidement.
Représentante du passé, l’Assemblée constituante russe est devenue, dès son ouverture, le point de ralliement de tous les éléments contre-révolutionnaires. En la dissolvant, les bolcheviks n’ont pas réprimé « la démocratie » ; ils ont, au contraire, défendu la démocratie ouvrière incarnée par les soviets. Ce processus est d’ailleurs clairement démontré par l’évolution ultérieure des membres de l’Assemblée constituante. Une partie d’entre eux a tenté de la maintenir malgré sa dissolution, et ce faisant s’est immédiatement placée sous la protection des généraux « blancs » (contre-révolutionnaires), auxquels ils ont accordé leur patronage et les pleins pouvoirs pour mener la guerre civile contre la révolution.
Des réformistes affirment que Luxemburg défendait le parlementarisme bourgeois contre le pouvoir soviétique, au nom d’une « démocratie » abstraite, se situant au-dessus des classes sociales. C’est complètement faux. Rappelons les faits. En novembre 1918, la Révolution allemande a renversé l’Empire du Kaiser, mis fin à la guerre de 14-18 et placé les dirigeants réformistes au pouvoir, en Allemagne. Ces derniers préparaient l’élection d’une « Assemblée nationale », semblable à l’Assemblée constituante de Russie. Ils l’opposaient aux conseils d’ouvriers et de soldats qui s’étaient formés dans le cours de la révolution allemande. Alors, quelques mois après avoir achevé La Révolution russe et pris la décision de ne pas le publier, Rosa Luxemburg écrivit un article intitulé « L’Assemblée nationale », dans lequel on peut lire : « L’Assemblée Nationale est un héritage suranné des révolutions bourgeoises, une cosse vide, un résidu du temps des illusions petites-bourgeoises sur le “peuple uni”, sur la “liberté, égalité, fraternité” de l’Etat bourgeois. Celui qui, aujourd’hui, recourt à l’Assemblée Nationale, celui-là veut, consciemment ou inconsciemment, faire reculer la révolution jusqu’au stade historique des révolutions bourgeoises ; c’est un agent camouflé de la bourgeoisie, ou un idéologue inconscient de la petite-bourgeoisie. »
Est-ce que, soudainement, Rosa Luxemburg s’est mise en tête de détruire « la démocratie » ? Pas du tout ! Comme Lénine et Trotsky en Russie, elle défendait les véritables organes de la démocratie ouvrière – les conseils ouvriers – contre la confusion et la régression que représentait le mot d’ordre d’« Assemblée nationale ». Ici aussi, l’expérience pratique de la révolution a fait évoluer Rosa Luxemburg vers les mêmes positions que les bolcheviks.
Contrairement au portrait qu’en brossent ses « disciples », Rosa Luxemburg n’était pas une « spontanéiste » à moitié anarchiste ; elle n’était pas une adversaire résolue du bolchevisme. Elle était une marxiste révolutionnaire conséquente, qui a consacré sa vie au mouvement ouvrier et ses derniers mois à la construction d’un Parti Communiste, dans l’espoir de mener la révolution allemande à la victoire. Tel est le véritable héritage de Rosa Luxemburg, que nous revendiquons pleinement !
[1] Avant la Révolution russe de 1917, les marxistes se désignaient eux-mêmes comme « sociaux-démocrates ». Après la Première Guerre mondiale, seuls les réformistes ont conservé cette appellation.
[2] Grève de masse, parti et syndicat (1906)
[3] Marie Frederiksen, The Revolutionary Legacy of Rosa Luxemburg, Wellred Books, 2022
[4] « Blanquisme et social-démocratie », 1906
[5] « Deux discours au cinquième Congrès du POSDR », 1907














